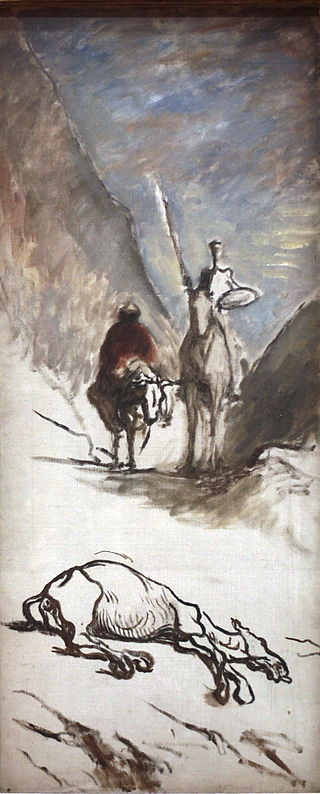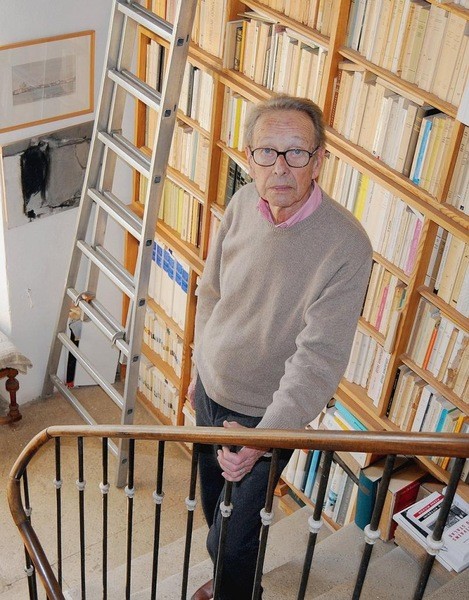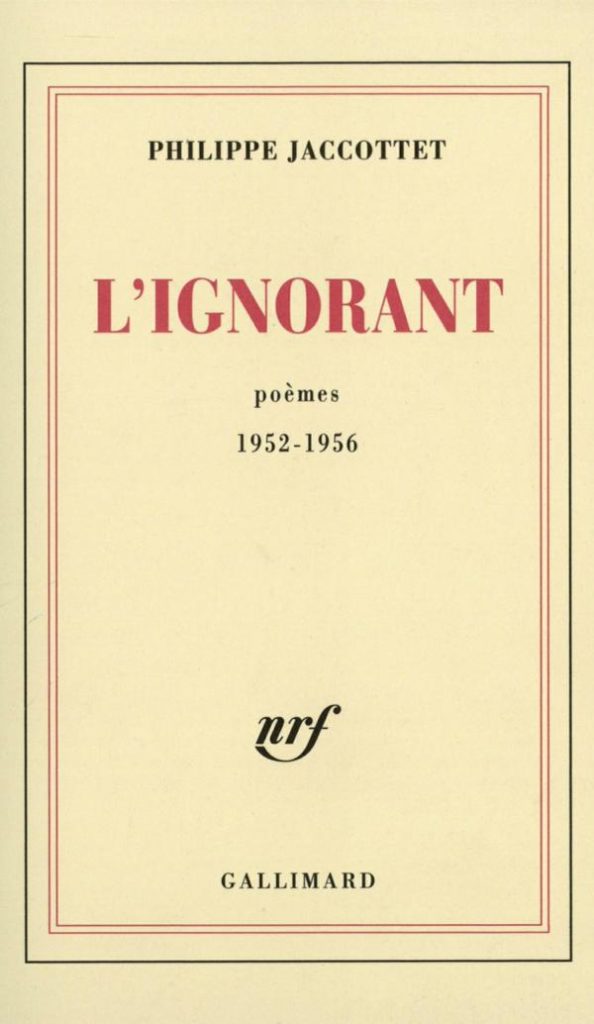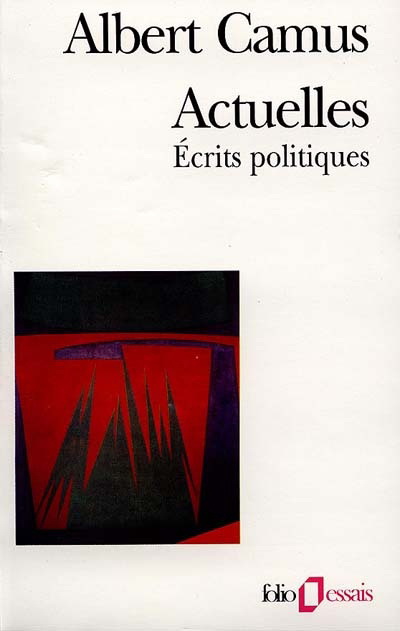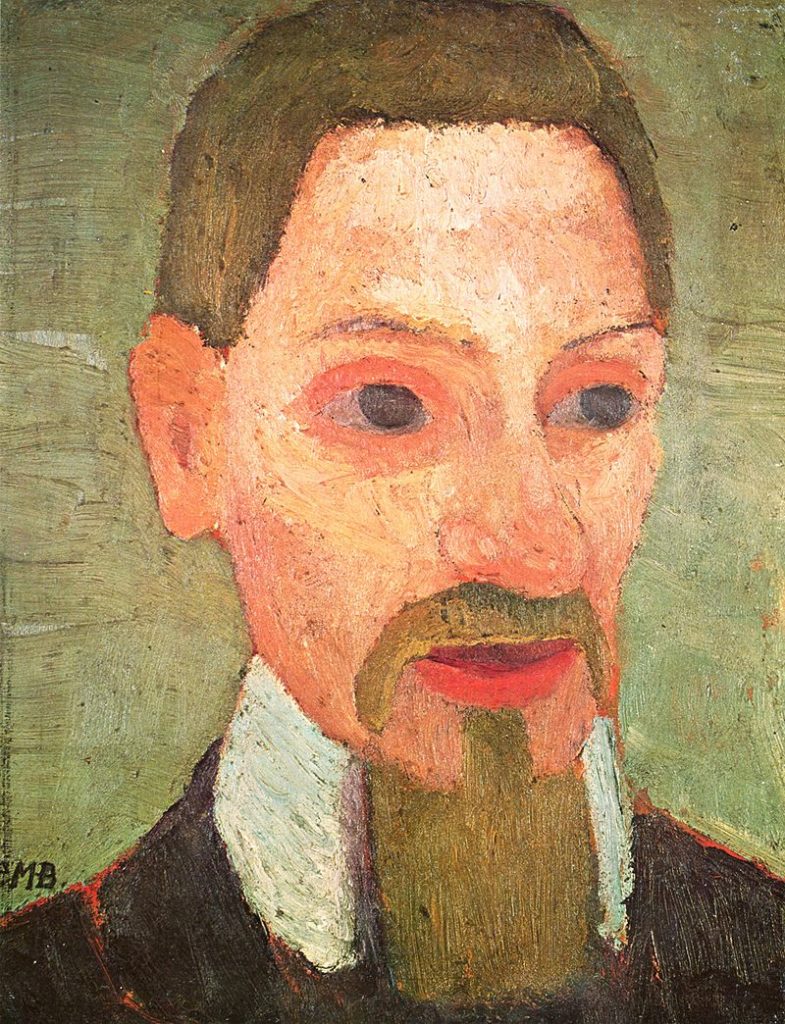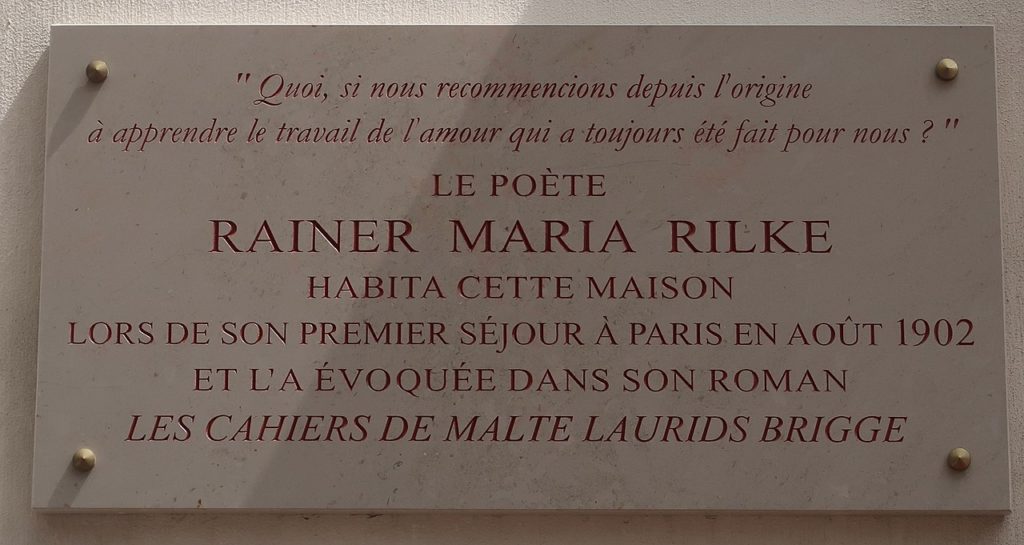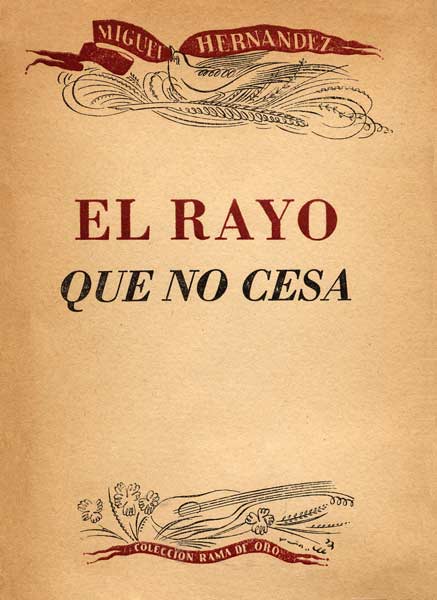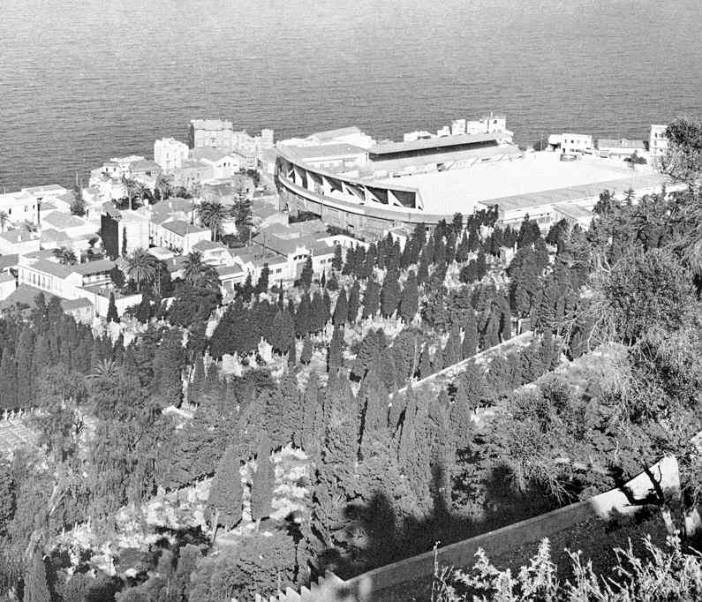Vu dimanche 6 janvier au studio Saint-André-des-Arts, Paris VI.
Les héritières (Las herederas). 97’. Réal. et scén.: Marcello Martinessi. Dir.photo.: Luis Armando Ortega. Int: Ana Brun (Chela), Margarita Irun (Chiquita), Ana Ivanova (Andy), Nilda González (Pati), María Martins (Pituca), Alicia Guerra (Carmela).
Chela et Chiquita, la soixantaine, forment un vieux couple qui survit malgré les outrages, l’usure du temps et une vie morne et monotone. Ces deux dames distinguées de la bonne société du Paraguay ont vécu jusque-là de leurs rentes. Mais elles ont dilapidé leur héritage familial et bradent maintenant leurs dernières possessions: les meubles, le piano, l’argenterie. Chiquita est envoyée en prison pour dettes envers sa banque qui l’accuse de fraude. Leur maison, de style colonial, sombre, métaphore d’un pays, d’une classe sociale, se vide et se délabre. Chela, mauvaise conductrice et dépourvu de permis, s’improvise chauffeuse de taxi pour ses vieilles voisines riches. Elle les conduit dans la ville et même sur l’autoroute. Enfin, elle sort de son cocon étouffant. Elle se rapproche d’Angy, une femme beaucoup plus jeune qui lui parle de ses amants. En l’absence de Chiquita, elle se libère des lourdes traditions qui pesaient sur ses épaules.
Un film du Paraguay, c’est un événement en France. Un pays qui a connu 35 ans de dictature sous la présidence du Général Alfredo Stroessner de 1954 à 1989. et dont on ne connaît rien chez nous. C’est pourtant 7 025 763 habitants et 406 752 km².
Ce film n’est pas un drame malgré les premières séquences sombres et lentes. On voit Chela dépressive, apathique, grincheuse, raciste. L’univers carcéral n’est pas montré de manière outancière, sauf dans deux brefs épisodes. Les bourgeoises de ce pays vivent elles dans une prison. Ces dames sortent peu, eles se méfient même des taxis qui pourraient les voler. Le metteur en scène n’insiste pas pourtant sur les dangers possibles dans la ville d’Asunción. Chela prend une fois un verre seule en plein air. Les hommes, qui dans tout le film ne sont que des silhouettes, ne la dérangent nullement.
Marcello Martinessi est habile dans sa mise en scène. Il évite les facilités, utilise les ellipses. On arrive même à la fin à s’attacher à cette femme mûre qui a été belle. Ce n’est qu’une vieille enfant lunaire, presque muette qui n’a jamais rien fait de sa vie. Elle peint un peu, a dû jouer du piano autrefois. Même si ce film est centré sur des femmes et un milieu social particulier, ce récit a un aspect universel, tchékhovien. Le metteur en scène joue sur les sous-entendus, les petites touches L’homosexualité n’est jamais montré comme un problème. C’est même secondaire dans l’intrigue. Les personnages évoluent tout au long du film. On s’en rend bien compte par exemple dans les relations entre Chela et et Pati, la bonne. Le point de vue du cinéaste est lucide, mais compréhensif et affectueux.
Marcelo Martinessi, né en 1973, a dirigé la télévision publique de son pays lors de la présidence progressiste de Fernando Lugo de 2008 à 2012. Avant ce film, il n’avait dirigé que trois courts-métrages. Ses références cinématographiques sont Fassbinder, Almodóvar, Cassavetes. Il réussit bien à faire le portrait de son pays et d’un société qui semble sortir des ténèbres.
Ana Brun, Margarita Irun, Ana Ivanova et Nilda González sont toutes les quatre excellentes dans le film. Ana Brun (Prix d’interprétation à la Berlinale) n’est pas une actrice professionnelle. C’est une avocate qui a été engagée dans la lutte contre la dictature.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577039&cfilm=261839.html