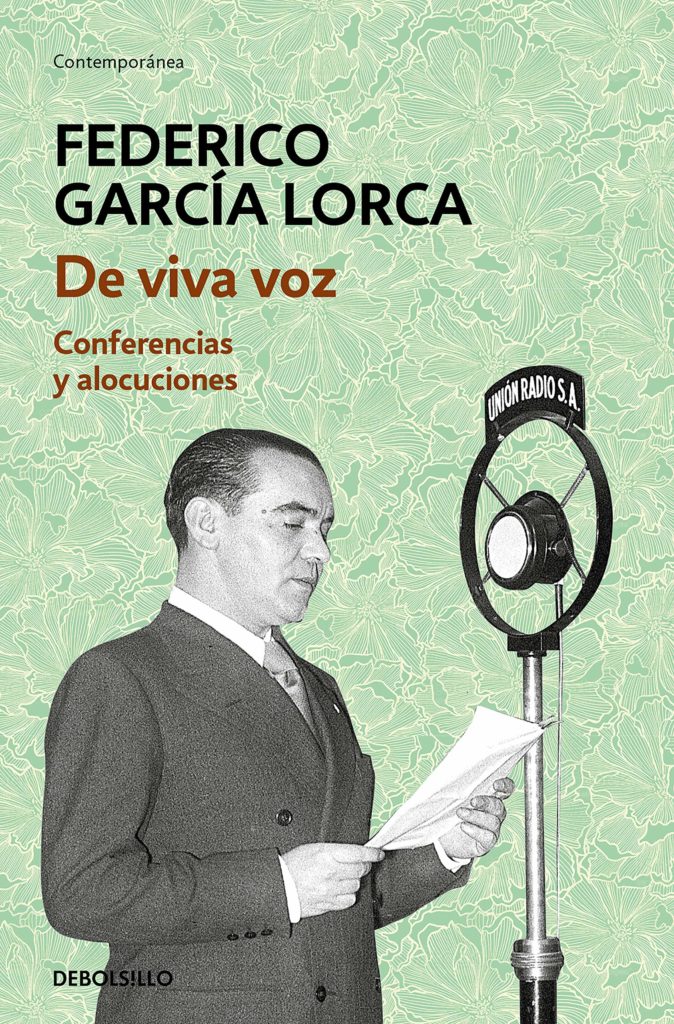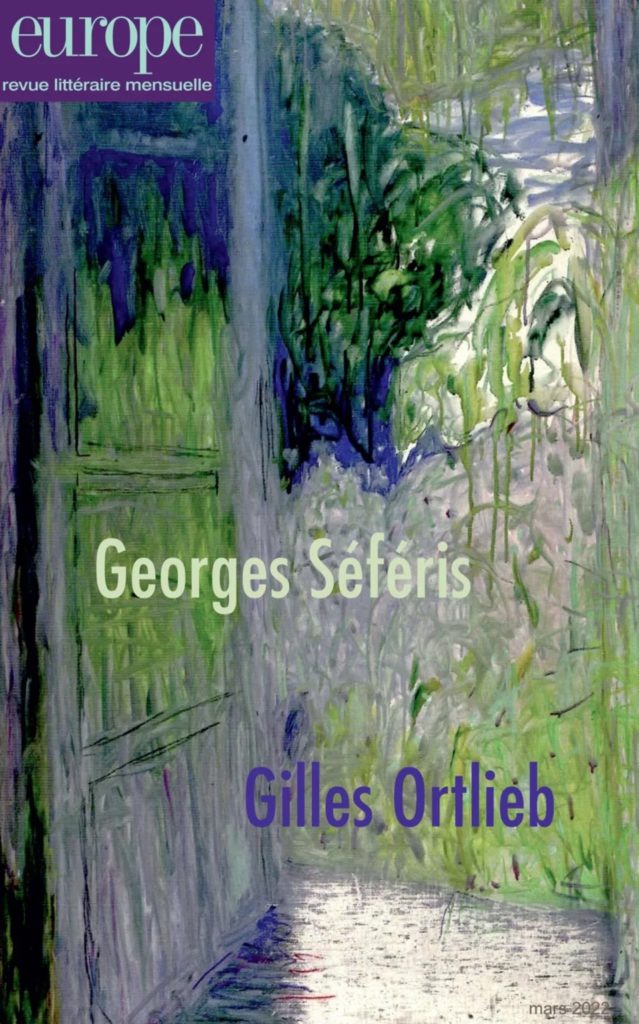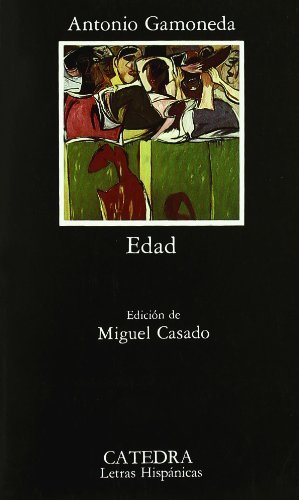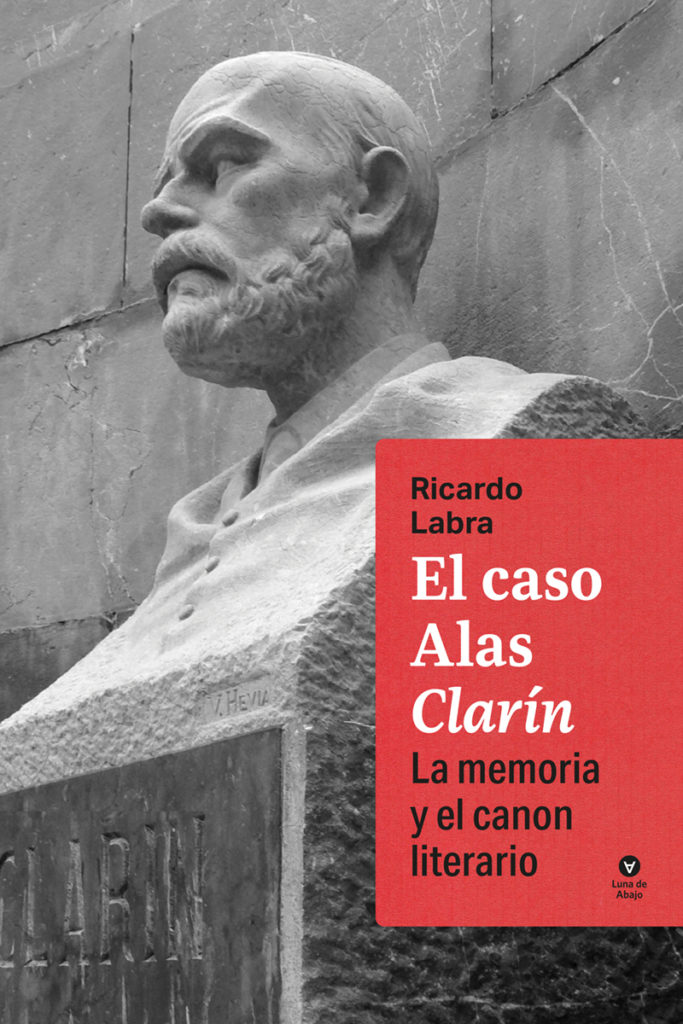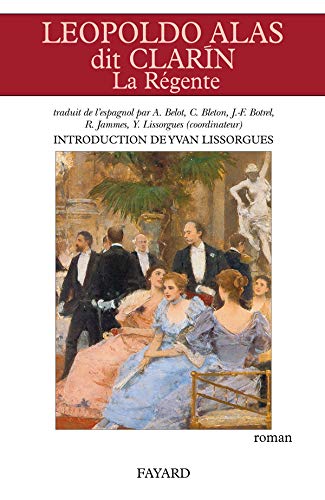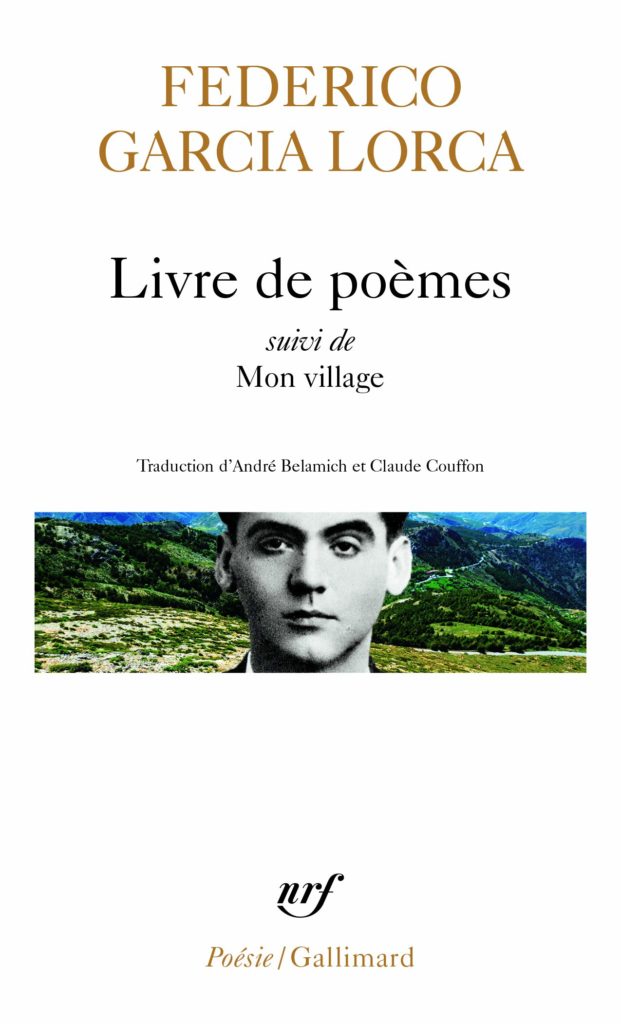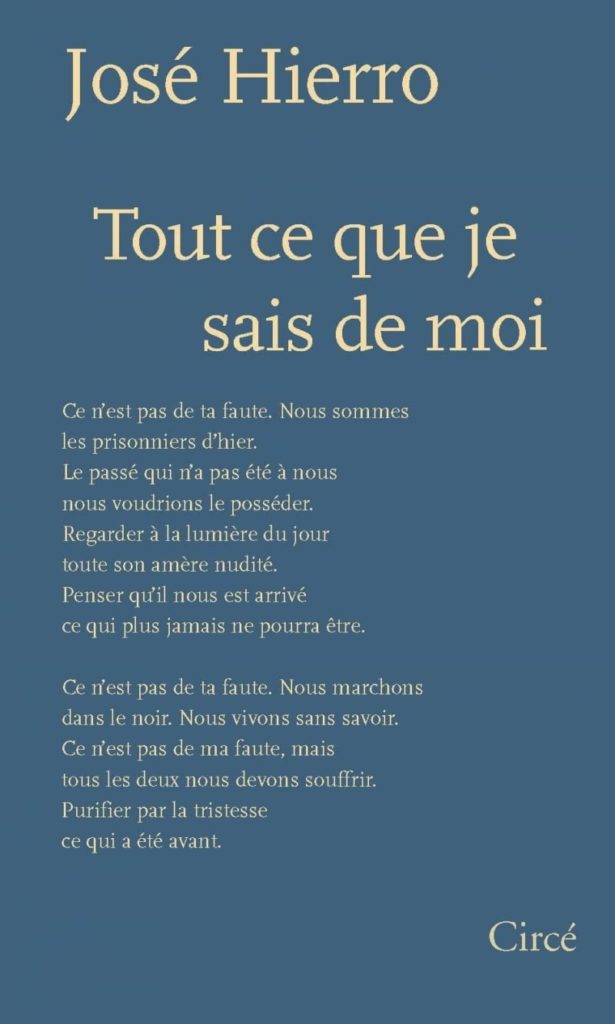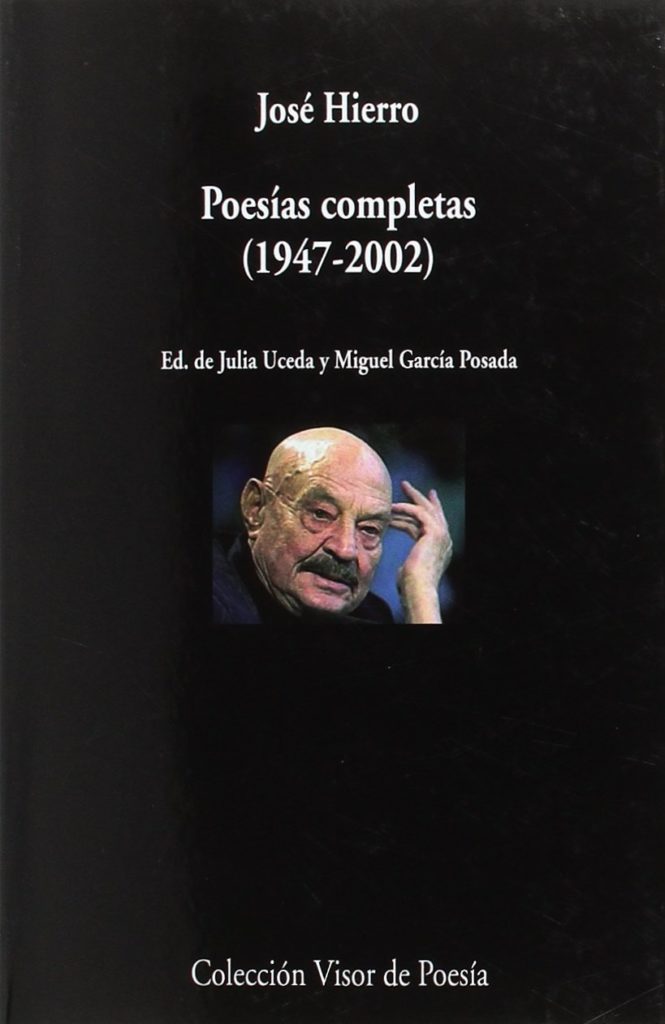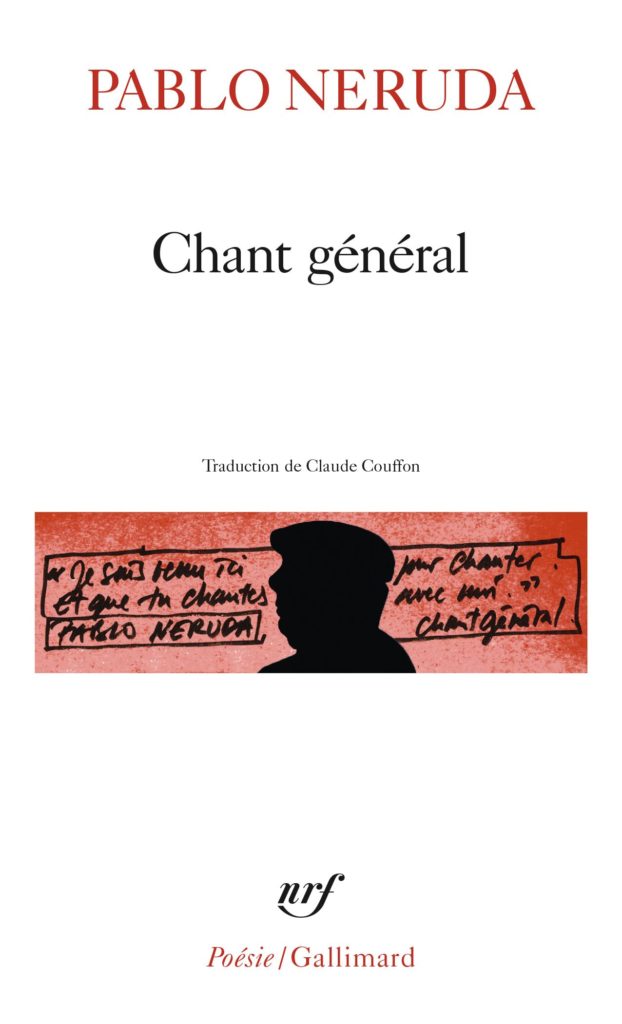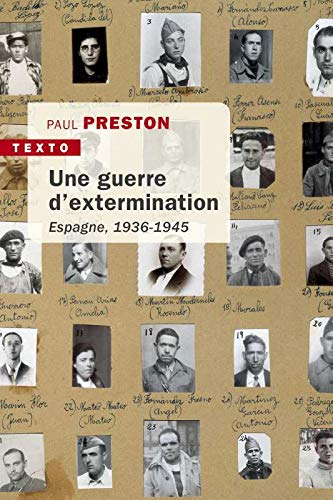23 avril : sant Jordi. Día del Libro.
Discurso de Federico García Lorca en la inauguración de la biblioteca de su pueblo, Fuentevaqueros (septiembre de 1931).
” Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. «Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre», piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Ésta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es serenidad y es pasión.
Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada.
No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita y ¿dónde están esos libros?
¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir: «amor, amor», y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita; y pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: «¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera!». Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.
Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser: «Cultura». Cultura porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz.”

Discours de Federico Garcia Lorca lors de l’inauguration de la bibliothèque de Fuente Vaqueros, sa ville natale. (Septembre 1931)
« Quand quelqu’un va au théâtre, à un concert ou à une fête quelle qu’elle soit, si le spectacle lui plaît il évoque tout de suite ses proches absents et s’en désole : « Comme cela plairait à ma soeur, à mon père ! » pensera-t-il et il ne profitera dès lors du spectacle qu’avec une légère mélancolie. C’est cette mélancolie que je ressens, non pour les membres de ma famille, ce qui serait mesquin, mais pour tous les êtres qui, par manque de moyens et à cause de leur propre malheur ne profitent pas du suprême bien qu’est la beauté, la beauté qui est vie, bonté, sérénité et passion.
C’est pour cela que je n’ai jamais de livres. A peine en ai-je acheté un, que je l’offre. j’en ai donné une infinité. Et c’est pour cela que c’est un honneur pour moi d’être ici, heureux d’inaugurer cette bibliothèque du peuple, la première sûrement de toute la province de Grenade.
L’homme ne vit pas que de pain. Moi si j’avais faim et me trouvais démuni dans la rue, je ne demanderais pas un pain mais un demi-pain et un livre. Et depuis ce lieu où nous sommes, j’attaque violemment ceux qui ne parlent que revendications économiques sans jamais parler de revendications culturelles : ce sont celles-ci que les peuples réclament à grands cris. Que tous les hommes mangent est une bonne chose, mais il faut que tous les hommes accèdent au savoir, qu’ils profitent de tous les fruits de l’esprit humain car le contraire reviendrait à les transformer en machines au service de l’état, à les transformer en esclaves d’une terrible organisation de la société.
J’ai beaucoup plus de peine pour un homme qui veut accéder au savoir et ne le peut pas que pour un homme qui a faim. Parce qu’un homme qui a faim peut calmer facilement sa faim avec un morceau de pain ou des fruits. Mais un homme qui a soif d’apprendre et n’en a pas les moyens souffre d’une terrible agonie parce que c’est de livres, de livres, de beaucoup de livres dont il a besoin, et où sont ces livres ?
Des livres ! Des livres ! Voilà un mot magique qui équivaut à clamer: « Amour, amour », et que devraient demander les peuples tout comme ils demandent du pain ou désirent la pluie pour leur semis. Quand le célèbre écrivain russe Fédor Dostoïevski, père de la révolution russe bien davantage que Lénine, était prisonnier en Sibérie, retranché du monde, entre quatre murs, cerné par les plaines désolées, enneigées, il demandait secours par courrier à sa famille éloignée, ne disant que : « Envoyez-moi des livres, des livres, beaucoup de livres pour que mon âme ne meure pas ! ». Il avait froid ; ne demandait pas le feu, il avait une terrible soif, ne demandait pas d’eau, il demandait des livres, c’est-à-dire des horizons, c’est-à-dire des marches pour gravir la cime de l’esprit et du coeur. Parce que l’agonie physique, biologique, naturelle d’un corps, à cause de la faim, de la soif ou du froid, dure peu, très peu, mais l’agonie de l’âme insatisfaite dure toute la vie.
Le grand Menéndez Pidal, l’un des véritables plus grands sages d’Europe, , l’a déjà dit : « La devise de la République doit être la culture ». La culture, parce que ce n’est qu’à travers elle que peuvent se résoudre les problèmes auxquels se confronte aujourd’hui le peuple plein de foi mais privé de lumière. N’oubliez pas que l’origine de tout est la lumière. »