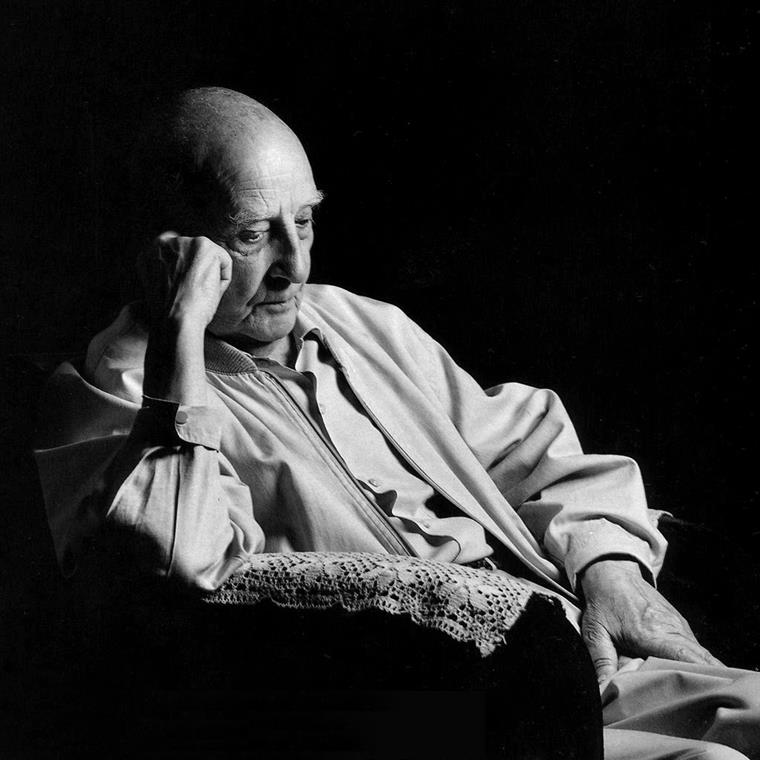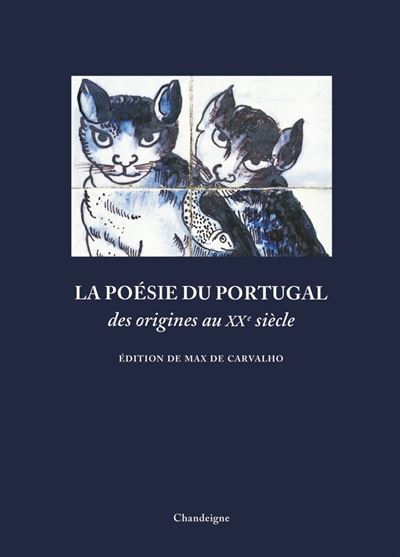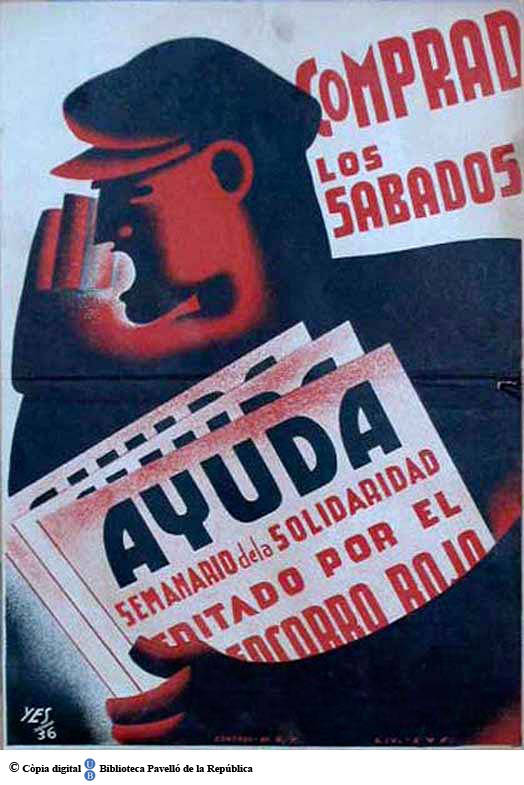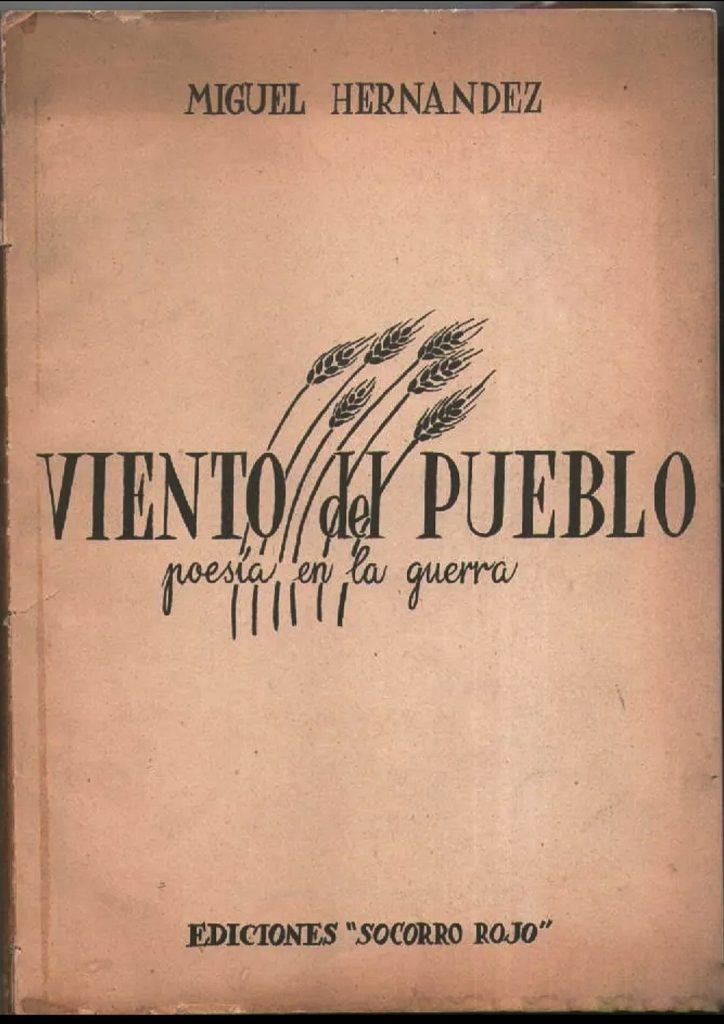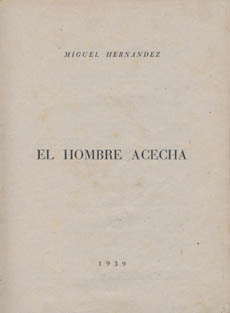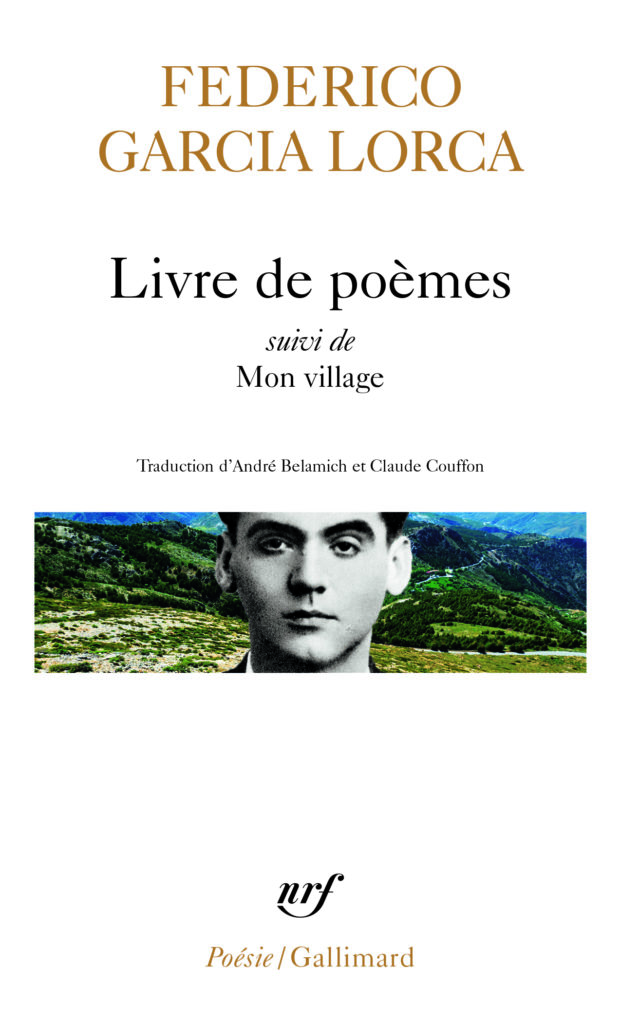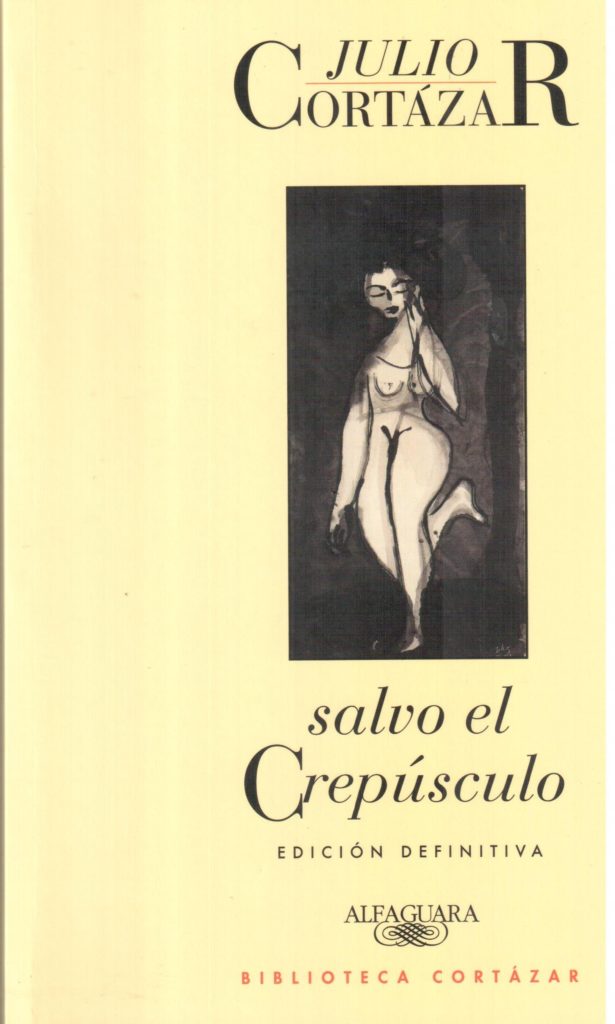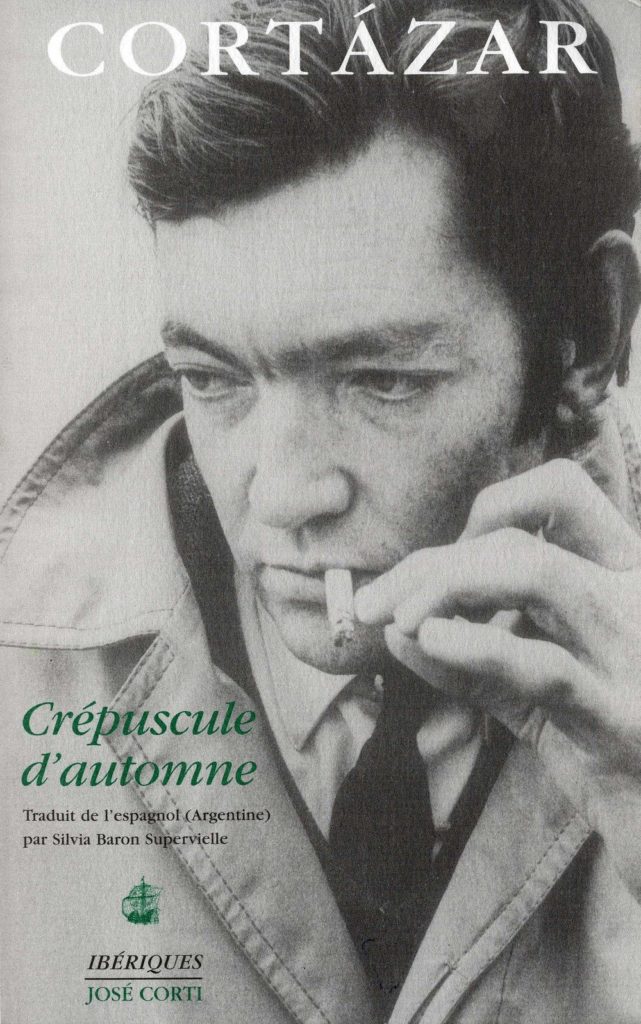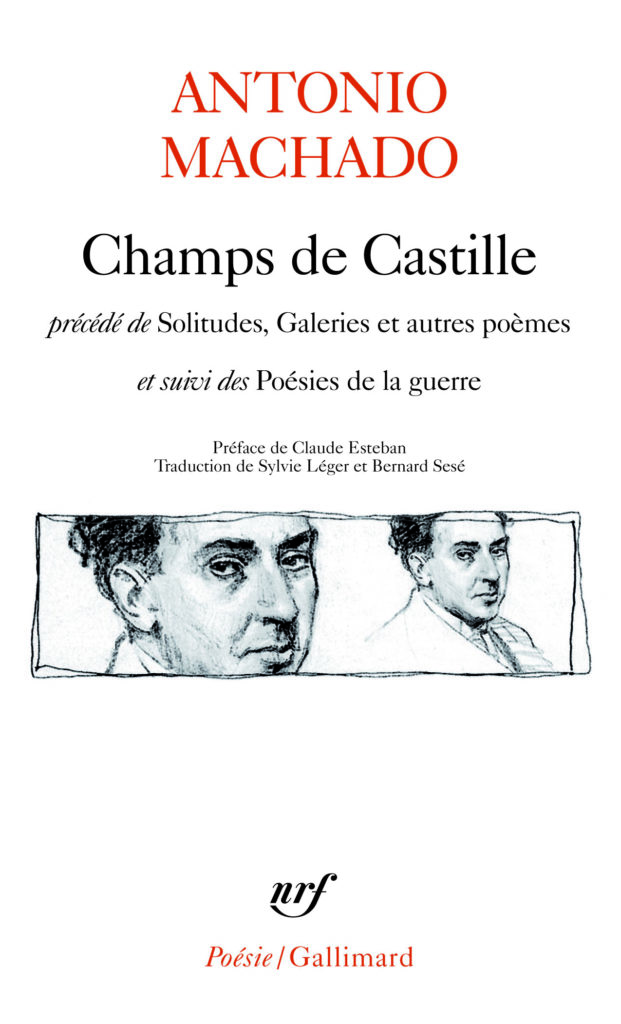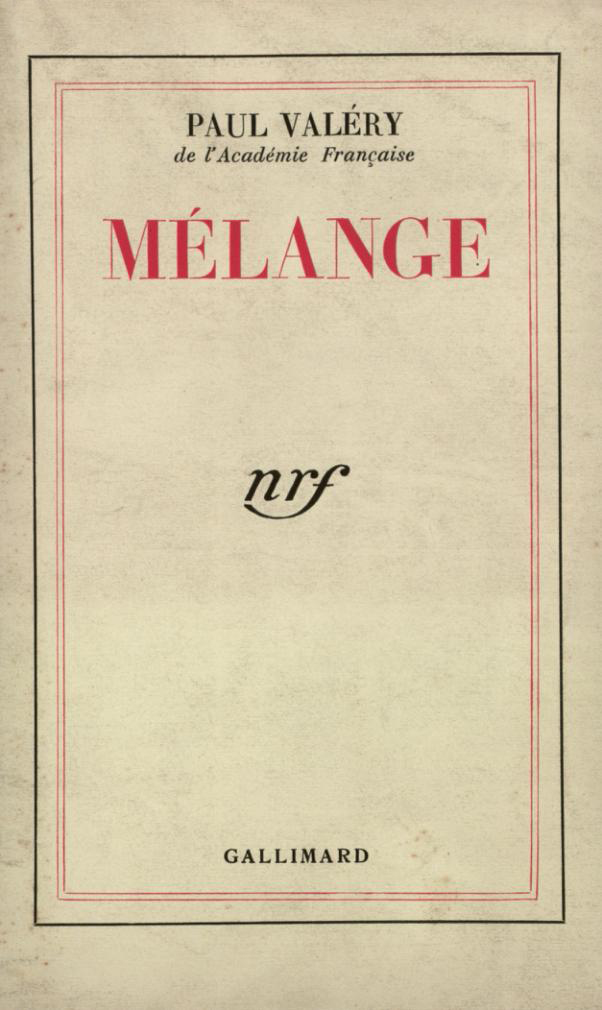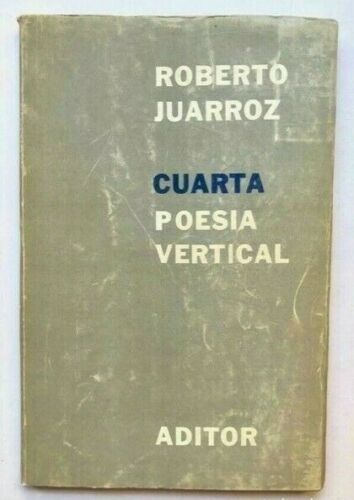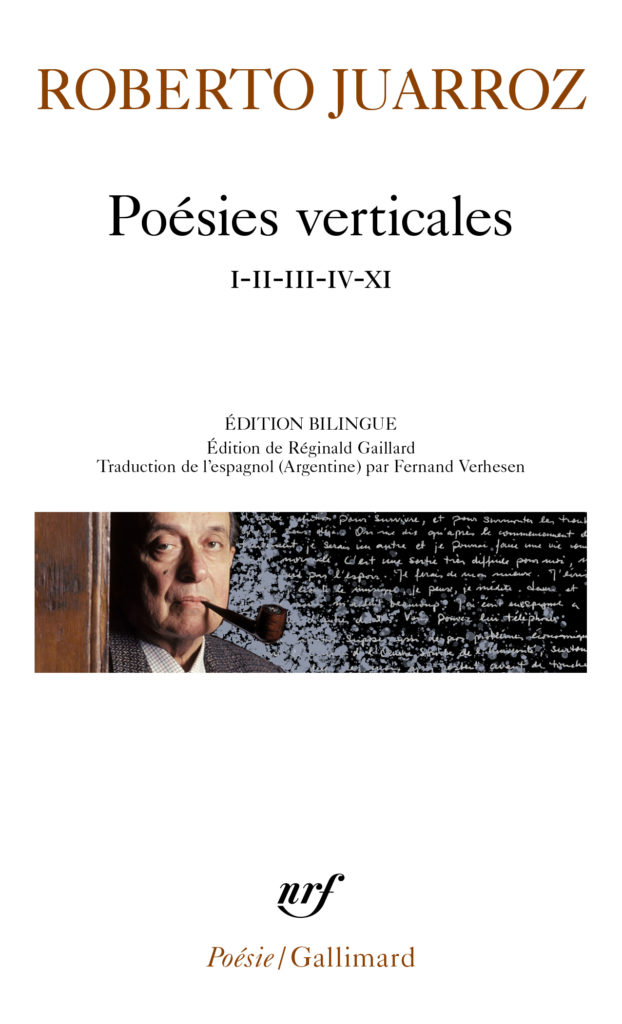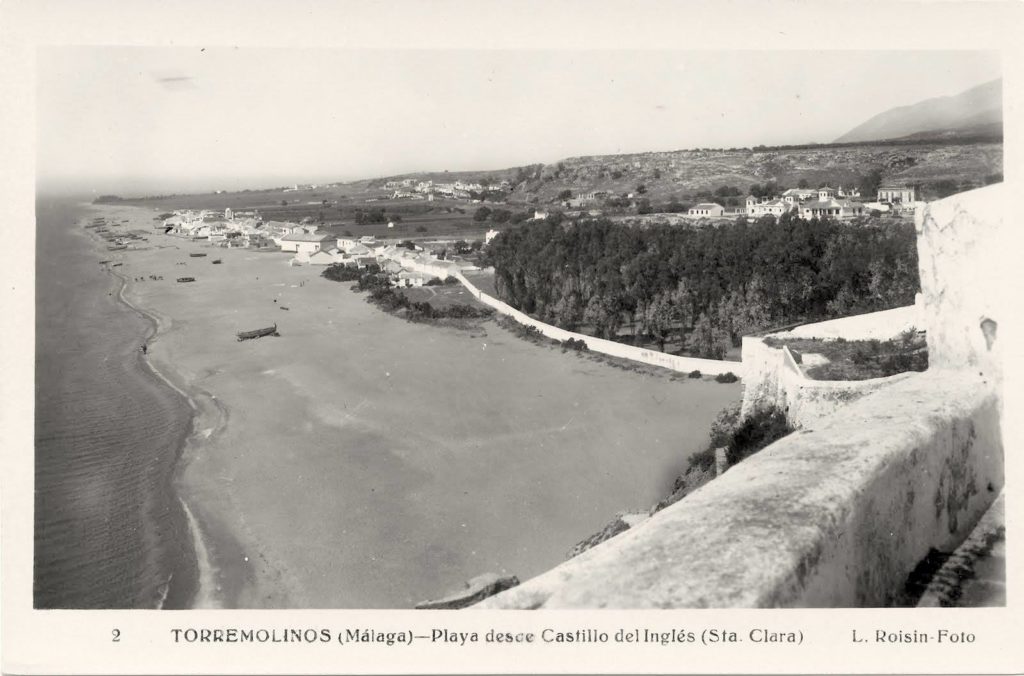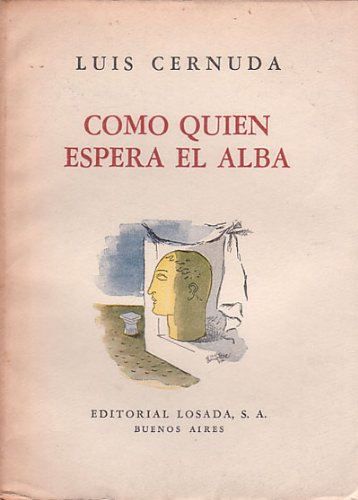Canción otoñal
Noviembre de 1918
(Grenade)
Hoy siento en el corazón
un vago temblor de estrellas,
pero mi senda se pierde
en el alma de la niebla.
La luz me troncha las alas
y el dolor de mi tristeza
va mojando los recuerdos
en la fuente de la idea.
Todas las rosas son blancas,
tan blancas como mi pena,
y no son las rosas blancas,
que ha nevado sobre ellas.
Antes tuvieron el iris.
También sobre el alma nieva.
La nieve del alma tiene
copos de besos y escenas
que se hundieron en la sombra
o en la luz del que las piensa.
La nieve cae de las rosas,
pero la del alma queda,
y la garra de los años
hace un sudario con ellas.
¿Se deshelará la nieve
cuando la muerte nos lleva?
¿O después habrá otra nieve
y otras rosas más perfectas?
¿Será la paz con nosotros
como Cristo nos enseña?
¿O nunca será posible
la solución del problema?
¿Y si el amor nos engaña?
¿Quién la vida nos alienta
si el crepúsculo nos hunde
en la verdadera ciencia
del Bien que quizá no exista,
y del Mal que late cerca?
¿Si la esperanza se apaga
y la Babel se comienza,
qué antorcha iluminará
los caminos en la Tierra?
¿Si el azul es un ensueño,
qué será de la inocencia?
¿Qué será del corazón
si el Amor no tiene flechas?
¿Si la muerte es la muerte,
qué será de los poetas
y de las cosas dormidas
que ya nadie las recuerda?
¡Oh sol de las esperanzas!
¡Agua clara! ¡Luna nueva!
¡Corazones de los niños!
¡Almas rudas de las piedras!
Hoy siento en el corazón
un vago temblor de estrellas
y todas las rosas son
tan blancas como mi pena.
Libro de Poemas, 1921.

Chanson d’automne
Novembre 1918
Grenade
Aujourd’hui je sens dans mon coeur
Un vague frisson d’étoiles,
Mais mon sentier se perd
Dans l’âme du brouillard.
Le jour me tranche les ailes,
La douleur et le regret
Submergent mes souvenirs
Dans la source de l’idée.
Toutes les roses sont blanches
Aussi blanches que ma peine ;
Ces roses n’étaient pas blanches
Mais il a neigé sur elles
Qui étaient couleur d’iris.
Il neige aussi sur nos âmes.
La neige de l’âme a ses
Flocons de baisers, d’images
Qui s’enfouirent dans l’ombre
Ou le jour de la pensée.
La neige tombe des roses,
Celle de l’âme demeure,
Et la griffe des années
La transforme en un linceul.
Fondra-t-elle, cette neige,
Quand la mort viendra nous prendre ?
Connaîtrons-nous d’autres neiges,
D’autres roses plus parfaites ?
Sur nous la paix viendra-t-elle ?
Comme Jésus nous l’enseigne ?
Ou bien n’aurons-nous jamais
La solution du problème ?
L’amour n’est-il qu’illusion ?
Qui animera nos vies,
Si la pénombre nous plonge
Dans la véritable science
Du Bien qui n’existe pas,
Peut-être, et du Mal tout proche ?
Si l’espérance s’éteint,e s’éteint,
Si Babel se recommence,
Quelle torche éclairera
Nos chemins sur cette terre ?
Si l’azur n’est qu’un mirage,
Que deviendra l’innocence ?
Que deviendra notre cœur
Si l’Amour n’a pas de flèches ?
Si la mort est bien la mort,
Que deviendront les poètes
Et les choses endormies
Dont personne ne se souvient ?
Ô soleil des espérances !
Eau claire ! Lune nouvelle !
Fraîcheur des petits enfants !
Âme rude de la pierre !
Aujourd’hui je sens dans mon cœur
Un vague frisson d’étoiles
Et toutes les roses sont
Aussi blanches que ma peine.
Livre de poèmes, Éditions Gallimard, 1954.
Oeuvres complètes I. Bibliothèque de la Pléiade. NRF. Gallimard. 1981. Traduction André Belamich.