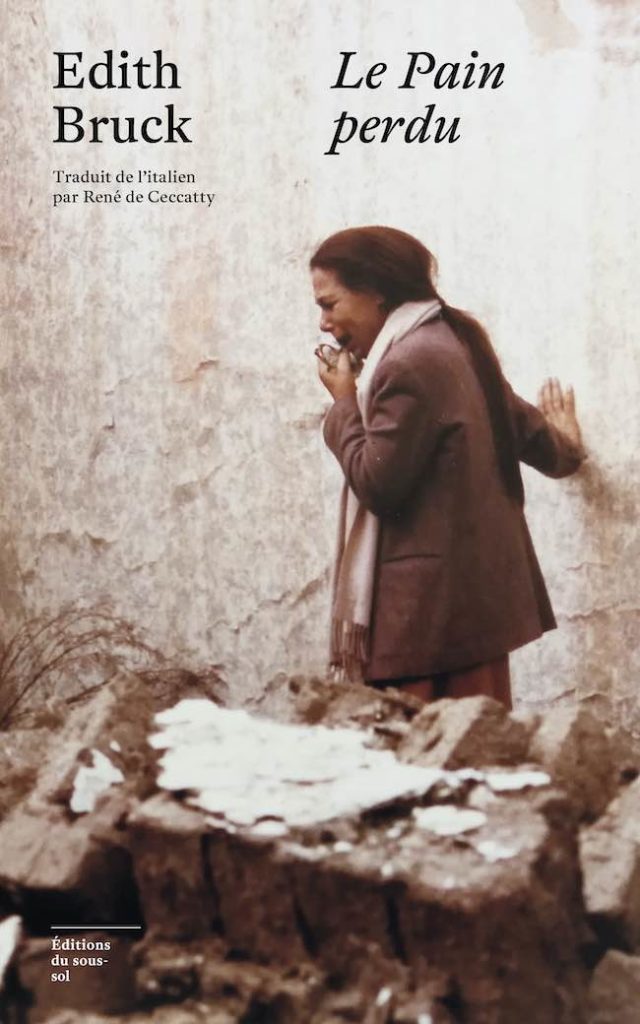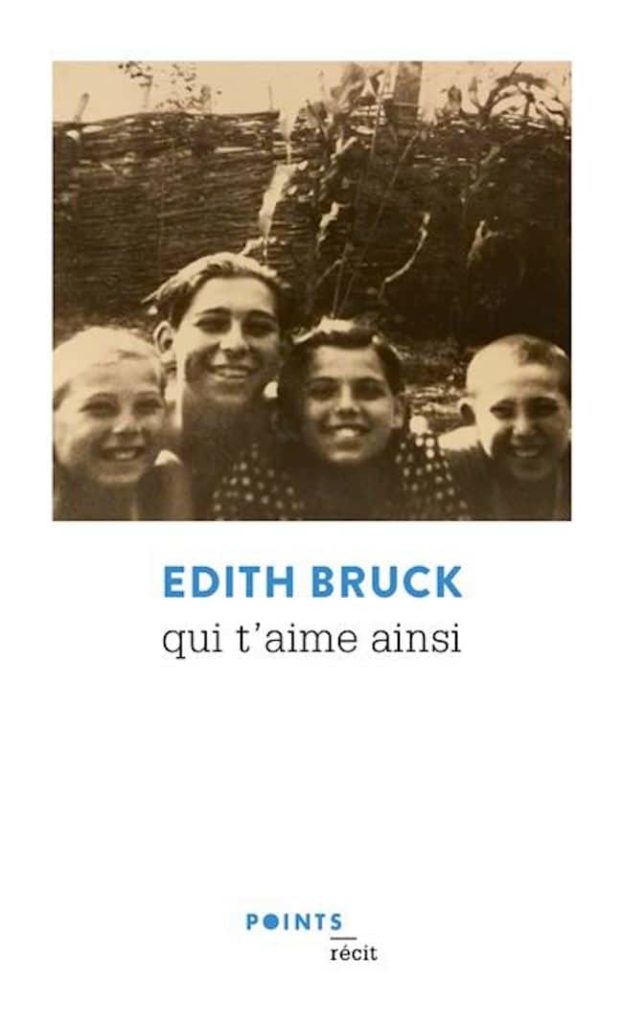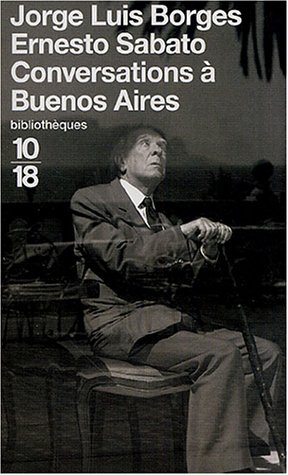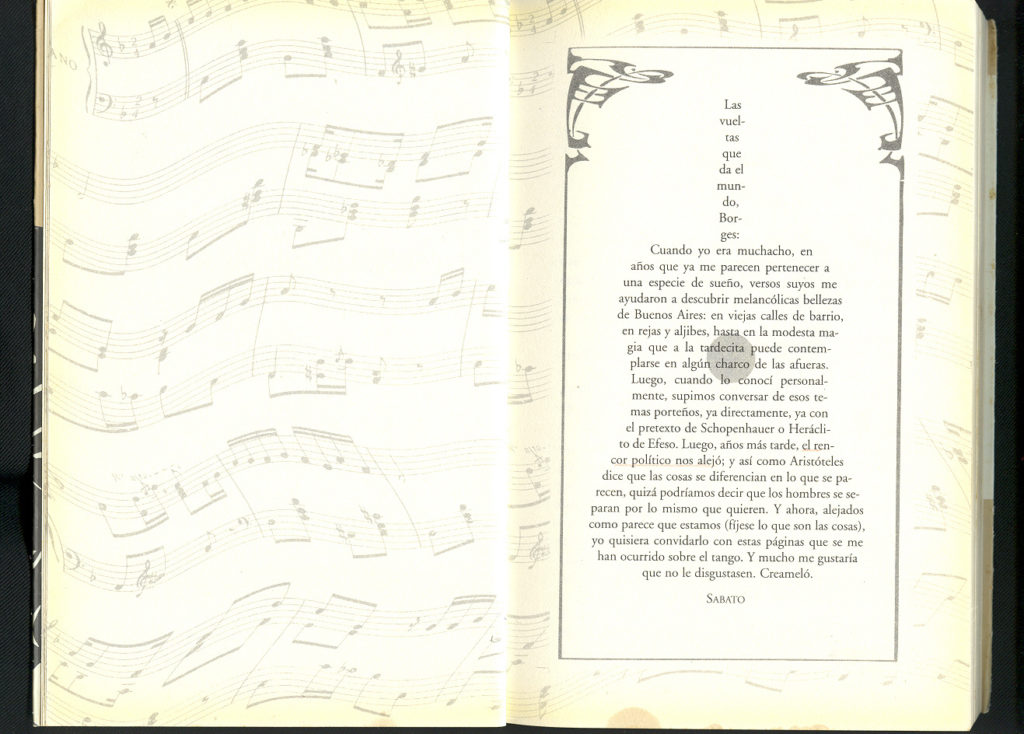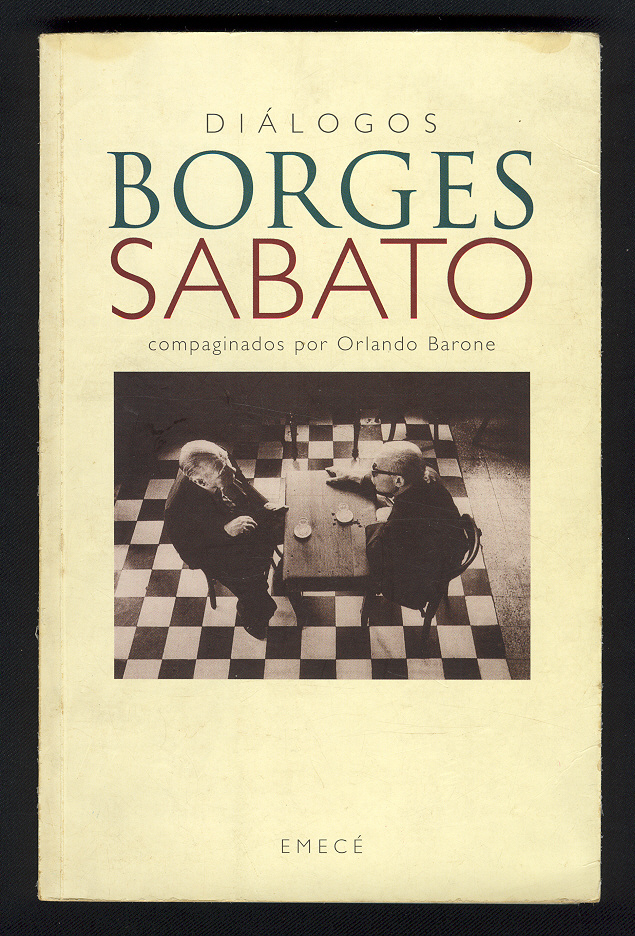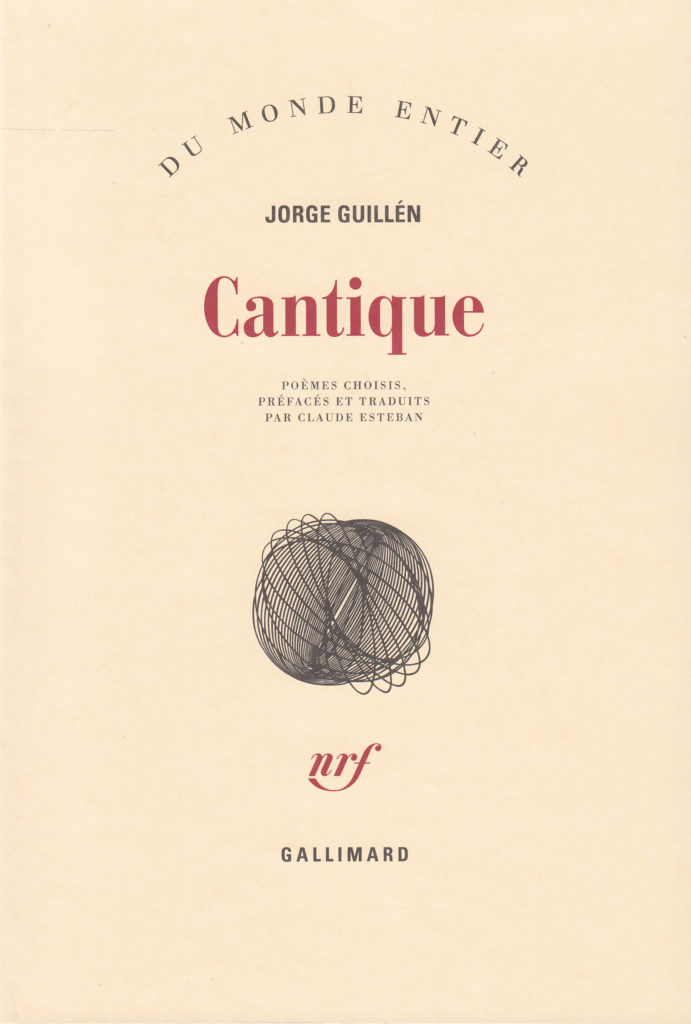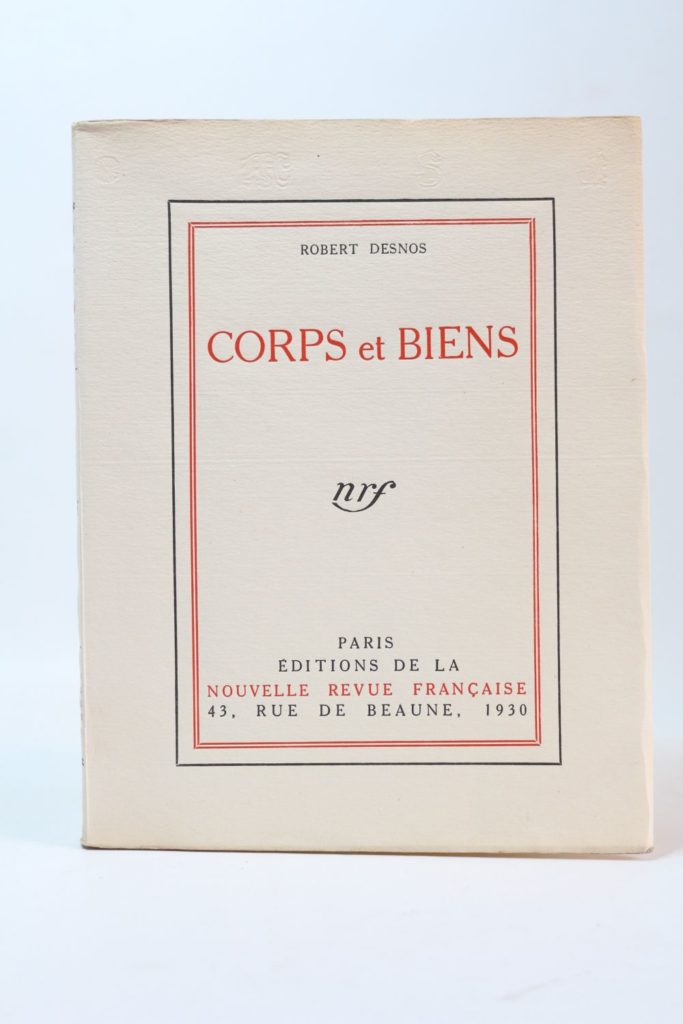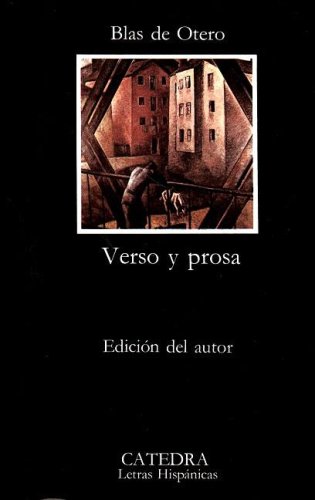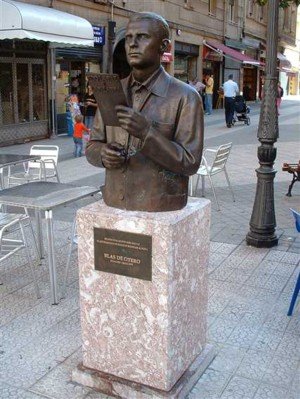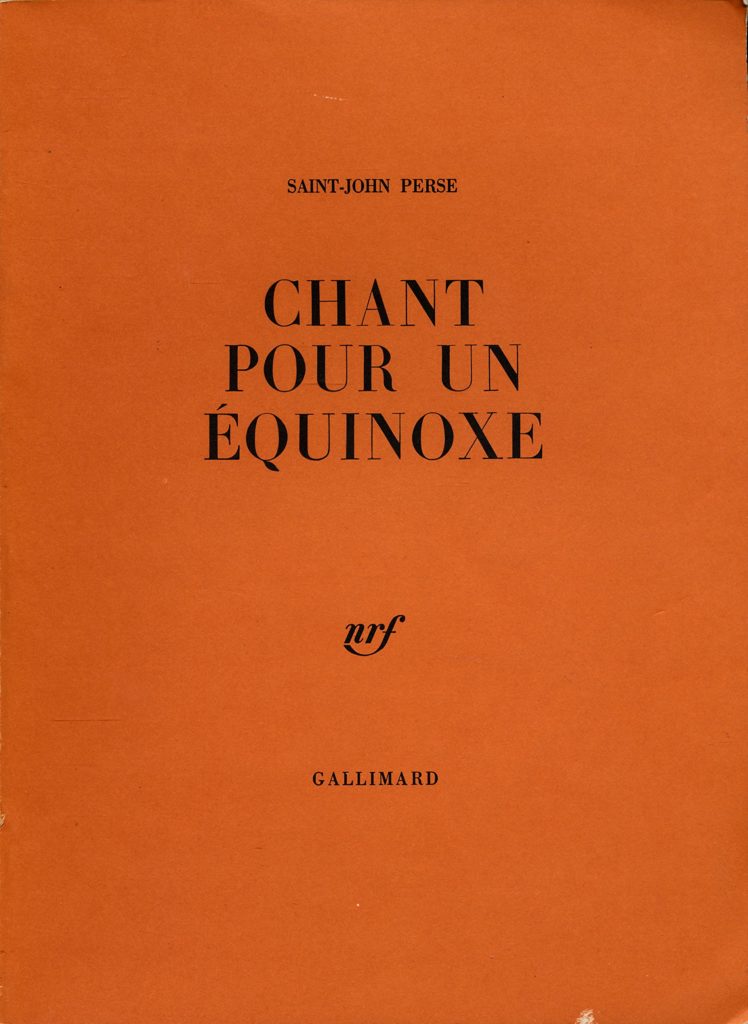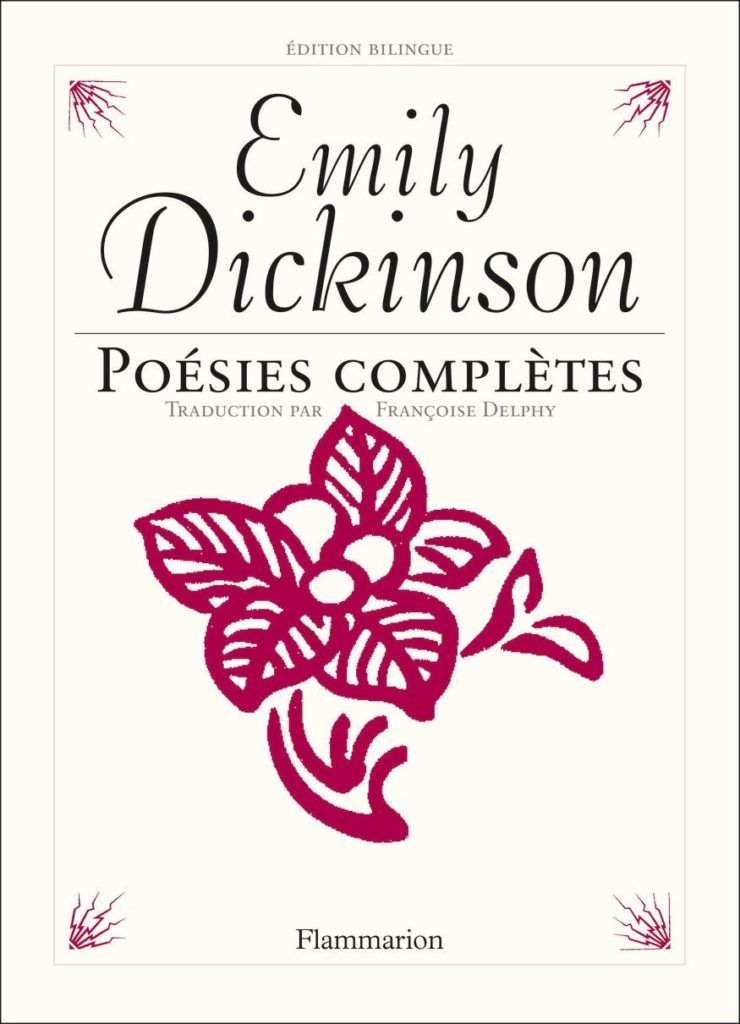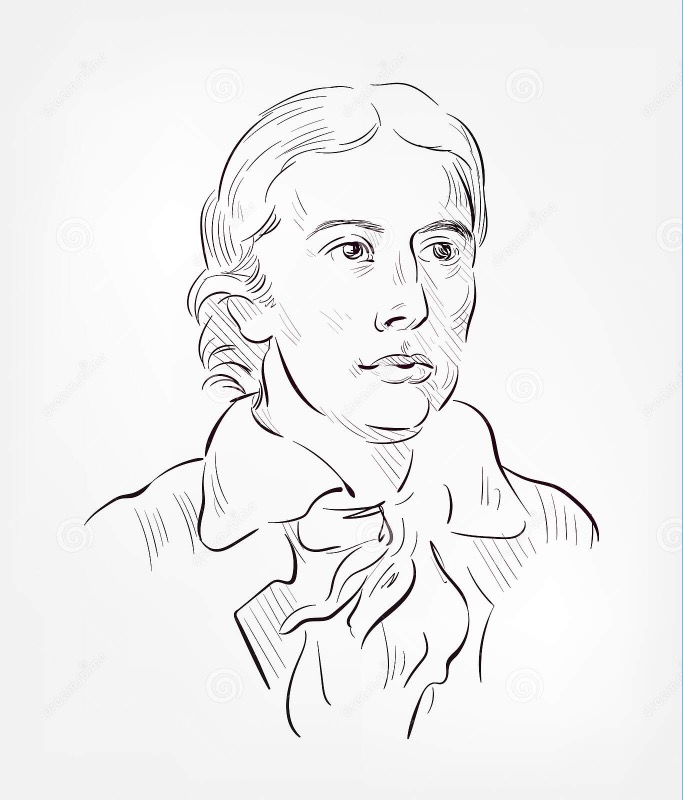Le deuxième recueil de poèmes de César Vallejo, Trilce, a été publié en octobre 1922, il y a cent ans (Talleres Tipográficos de la Penitenciaria). Il a été tiré à deux cents exemplaires. 121 pages de textes et un prologue d’Antenor Orrego (1892-1960), ami du poète. Les 77 poèmes ne portent pas de titre. Ils sont dénombrés de I à LXXVII. La poésie dépasse toute anecdote.
Le premier livre de César Vallejo, Los heraldos negros, date de 1919. On sent encore dans ces poèmes, rédigés entre 1915 et 1918, l’influence du modernisme.
Le mot Trilce est un mot inconnu. On demanda un jour à Vallejo ce qu’il signifiait. Il répondit :« Ah, mais ça ne veut rien dire. Je ne trouvais aucun mot qui ait la dignité d’un titre, alors je l’ai inventé : Trilce. Ce n’est pas un joli mot ? » («Ah, pues Trilce no quiere decir nada. No encontraba, en mi afán, ninguna palabra con dignidad de título, y entonces la inventé: Trilce. ¿No es una palabra hermosa? ») D’autres explications ont été données. En espagnol, on entend d’abord deux états : Triste, Dulce. Triste et Doux.
Ces textes furent écrits pendant une période particulièrement dramatique de la vie du poète. Sa mère meurt en août 1918. Il connaît une rupture amoureuse douloureuse (avec la très jeune Otilia Villanueva) en mai 1919. Son ami, l’écrivain Abraham Valdelomar ,(1888-1919) meurt le 3 novembre 1919 après une chute accidentelle. Il perd son poste d’enseignant à la fin de 1919. Il est emprisonné à Trujillo pendant 112 jours (du 6 novembre 1920 au 26 février 1921), sous l’accusation d’être un agitateur et d’avoir incendié une maison à Santiago de Chuco, sa ville natale. Il s’exilera en France le 17 juin 1923 et arrivera à Paris le 13 juillet.
César Vallejo a commencé à écrire Trilce en 1918. La plupart des poèmes datent de 1919 et les deux derniers de 1922. Il s’agit du sommet de l’oeuvre du poète péruvien. Il est en avance sur toutes les avant-gardes. On remarque une rupture avec Los heraldos negros. Ses poèmes sont toujours marqués par le pessimisme, mais l’angoisse et la désolation apparaissent avec un nouveau langage poétique, loin de toute influence moderniste. La langue se désarticule. La syntaxe disparaît parfois. Ce livre donne l’impression d’un monde chaotique et angoissant. Il deviendra l’un des plus importants de la poésie en langue espagnole du XX ème siècle.
«El libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista: ¡la de ser libre! Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente con su más imperativa curva de heroicidad. Me doy en la forma más libre que puedo y ésta es mi mayor cosecha artística. ¡Dios sabe hasta dónde es cierta y verdadera mi libertad! ¡Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje! ¡Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morir a fondo para que mi pobre ánima viva!»
(Carta enviada a Antenor Orrego y citada por su amigo José Carlos Mariátegui. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. En El proceso de la literatura. Lima, 1928.)
En 1930, il fut publié en Espagne (Compañia Ibero-Americana de Publicaciones) avec un prologue de José Bergamín et un poème de Gerardo Diego.
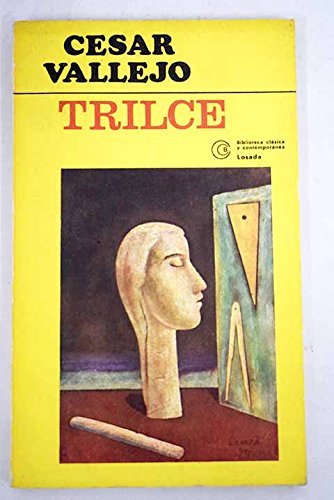
III
Las personas mayores
¿a qué hora volverán?
Da las seis el ciego Santiago,
y ya está muy oscuro.
Madre dijo que no demoraría.
Aguedita, Nativa, Miguel,
cuidado con ir por ahí, por donde
acaban de pasar gangueando sus memorias
dobladoras penas,
hacia el silencioso corral, y por donde
las gallinas que se están acostando todavía,
se han espantado tanto.
Mejor estemos aquí no más.
Madre dijo que no demoraría.
Ya no tengamos pena. Vamos viendo
los barcos ¡el mío es más bonito de todos!
con los cuales jugamos todo el santo día,
sin pelearnos, como debe de ser:
han quedado en el pozo de agua, listos,
fletados de dulces para mañana.
Aguardemos así, obedientes y sin más
remedio, la vuelta, el desagravio
de los mayores siempre delanteros
dejándonos en casa a los pequeños,
como si también nosotros
no pudiésemos partir.
Aguedita, Nativa, Miguel?
Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.
No me vayan a haber dejado solo,
y el único recluso sea yo.
Trilce, 1922.
III
Les grandes personnes
à quelle heure reviendront-elles ?
L’aveugle Santiago sonne six heures
et il fait déjà très sombre.
Mère a dit qu’elle ne tarderait pas.
Aguedita, Nativa, Miguel,
attention à ne pas aller par là, par où
viennent de passer en nasillant leurs souvenirs
d’accablantes âmes en peine,
vers la basse-cour silencieuse, et par où
les poules qui, en sont encore à se coucher,
se sont tant effrayées.
Il vaut mieux que nous restions ici simplement.
Mère a dit qu’elle ne tarderait pas.
N’ayons plus de peine. Allons voir
les bateaux, le mien est le plus beau de tous !
Ceux avec quoi nous jouons toute la sainte journée,
sans nous disputer, comme il se doit :
ils sont restés dans le bassin, tout prêts,
chargés de sucreries pour demain.
Attendons ici, obéissants et soumis
le retour, le dédommagement
des adultes qui toujours vont devant
nous laissant à la maison, nous les petits,
comme si nous
ne pouvions partir aussi.
Aguedita, Nativa, Miguel ?
J’appelle, je cherche à tâtons dans l’obscurité.
Pourvu qu’ils ne m’aient pas abandonné
et que le seul reclus ce soit moi.
Traduction: Nicole Reda-Euvremer. César Vallejo, Poésie complète 1919-1937. Flammarion, 2009.