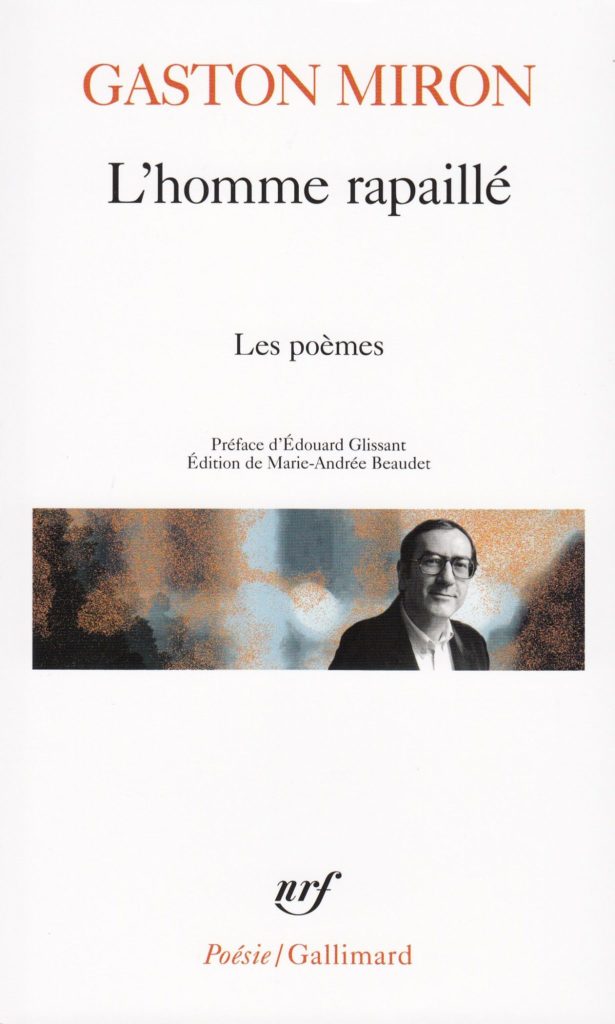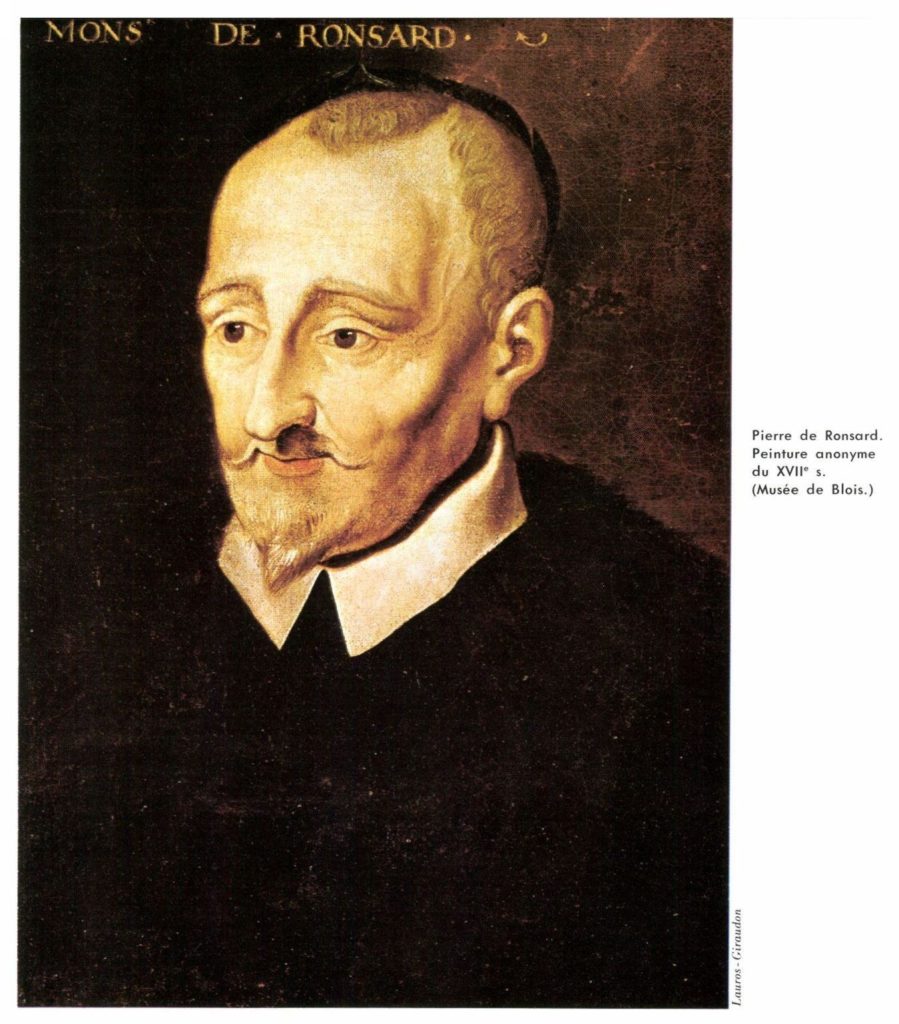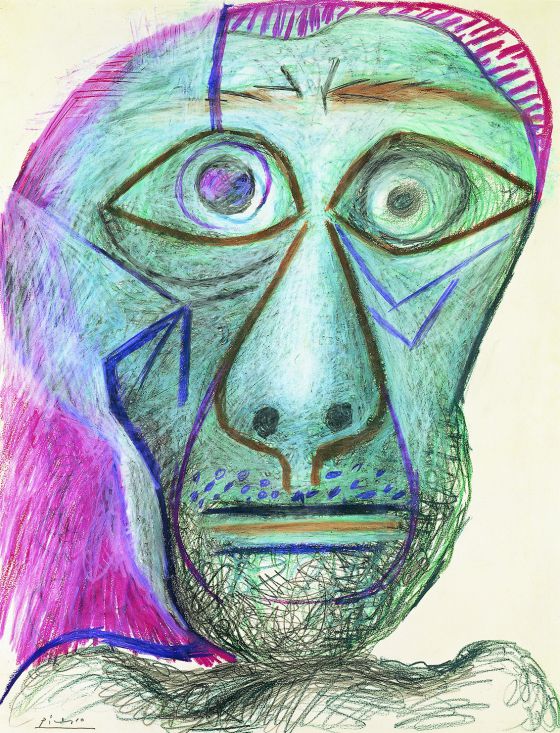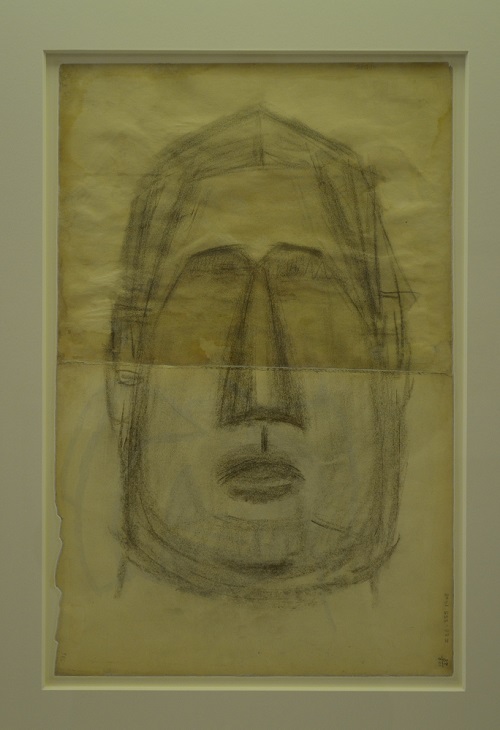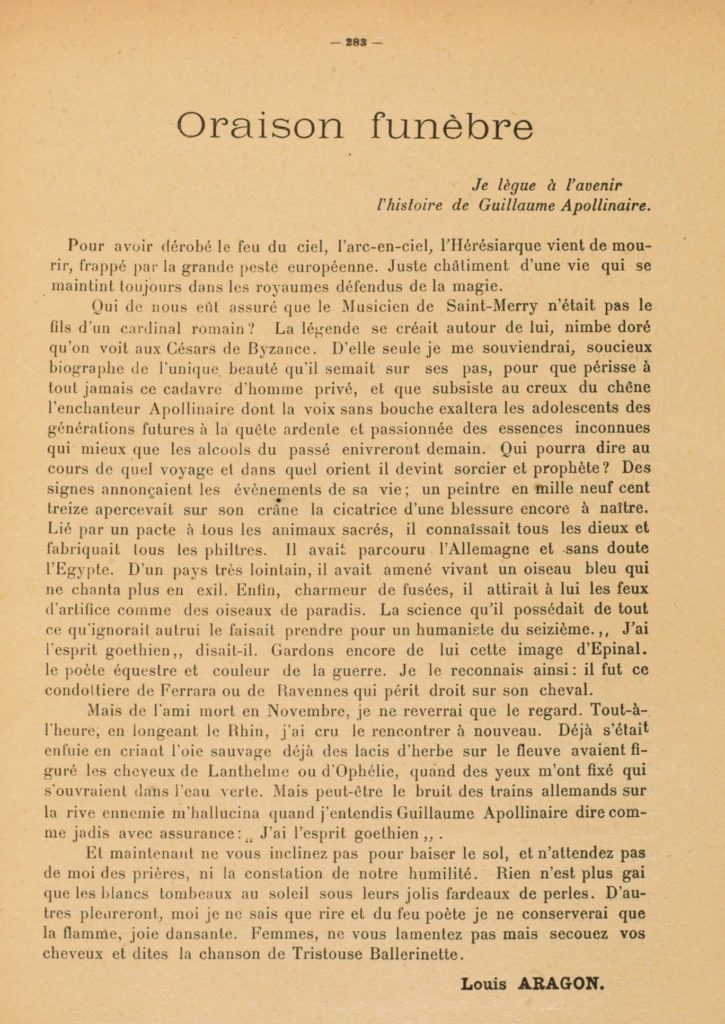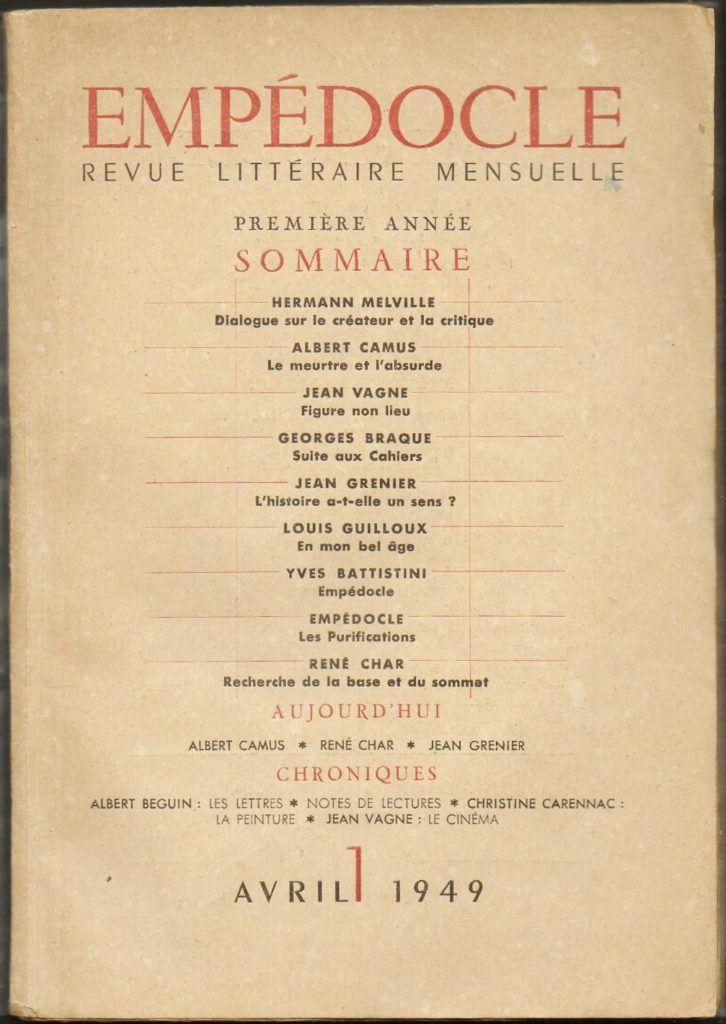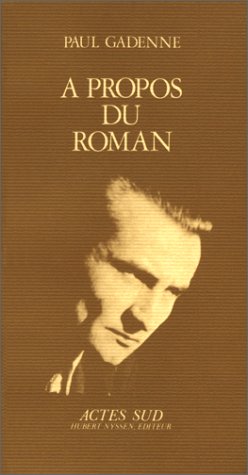Je remercie Jean- Louis Trintignant de m’avoir rappelé ce poème que j’avais tant aimé quand j’avais lu L’homme rapaillé du poète québécois Gaston Miron, il y a bien longtemps.
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/141218/trintignant-au-firmament-final
La marche à l’amour
Tu as les yeux pers des champs de rosées
tu as des yeux d’aventure et d’années-lumière
la douceur du fond des brises au mois de mai
dans les accompagnements de ma vie en friche
avec cette chaleur d’oiseau à ton corps craintif
moi qui suis charpente et beaucoup de fardoches
moi je fonce à vive allure et entêté d’avenir
la tête en bas comme un bison dans son destin
la blancheur des nénuphars s’élève jusqu’à ton cou
pour la conjuration de mes manitous maléfiques
moi qui ai des yeux où ciel et mer s’influencent
pour la réverbération de ta mort lointaine
avec cette tache errante de chevreuil que tu as
tu viendras tout ensoleillée d’existence
la bouche envahie par la fraîcheur des herbes
le corps mûri par les jardins oubliés
où tes seins sont devenus des envoûtements
tu te lèves, tu es l’aube dans mes bras
où tu changes comme les saisons
je te prendrai marcheur d’un pays d’haleine
à bout de misères et à bout de démesures
je veux te faire aimer la vie notre vie
t’aimer fou de racines à feuilles et grave
de jour en jour à travers nuits et gués
de moellons nos vertus silencieuses
je finirai bien par te rencontrer quelque part
bon dieu!
et contre tout ce qui me rend absent et douloureux
par le mince regard qui me reste au fond du froid
j’affirme ô mon amour que tu existes
je corrige notre vie
nous n’irons plus mourir de langueur
à des milles de distance dans nos rêves bourrasques
des filets de sang dans la soif craquelée de nos lèvres
les épaules baignées de vols de mouettes
non
j’irai te chercher nous vivrons sur la terre
la détresse n’est pas incurable qui fait de moi
une épave de dérision, un ballon d’indécence
un pitre aux larmes d’étincelles et de lésions profondes
frappe l’air et le feu de mes soifs
coule-moi dans tes mains de ciel de soie
la tête la première pour ne plus revenir
si ce n’est pour remonter debout à ton flanc
nouveau venu de l’amour du monde
constelle-moi de ton corps de voie lactée
même si j’ai fait de ma vie dans un plongeon
une sorte de marais, une espèce de rage noire
si je fus cabotin, concasseur de désespoir
j’ai quand même idée farouche
de t’aimer pour ta pureté
de t’aimer pour une tendresse que je n’ai pas connue
dans les giboulées d’étoiles de mon ciel
l’éclair s’épanouit dans ma chair
je passe les poings durs au vent
j’ai un coeur de mille chevaux-vapeur
j’ai un coeur comme la flamme d’une chandelle
toi tu as la tête d’abîme douce n’est-ce pas
la nuit de saule dans tes cheveux
un visage enneigé de hasards et de fruits
un regard entretenu de sources cachées
et mille chants d’insectes dans tes veines
et mille pluies de pétales dans tes caresses
tu es mon amour
ma clameur mon bramement
tu es mon amour ma ceinture fléchée d’univers
ma danse carrée des quatre coins d’horizon
le rouet des écheveaux de mon espoir
tu es ma réconciliation batailleuse
mon murmure de jours à mes cils d’abeille
mon eau bleue de fenêtre
dans les hauts vols de buildings
mon amour
de fontaines de haies de ronds-points de fleurs
tu es ma chance ouverte et mon encerclement
à cause de toi
mon courage est un sapin toujours vert
et j’ai du chiendent d’achigan plein l’âme
tu es belle de tout l’avenir épargné
d’une frêle beauté soleilleuse contre l’ombre
ouvre-moi tes bras que j’entre au port
et mon corps d’amoureux viendra rouler
sur les talus du mont Royal
orignal, quand tu brames orignal
coule-moi dans ta palinte osseuse
fais-moi passer tout cabré tout empanaché
dans ton appel et ta détermination
Montréal est grand comme un désordre universel
tu es assise quelque part avec l’ombre et ton coeur
ton regard vient luire sur le sommeil des colombes
fille dont le visage est ma route aux réverbères
quand je plonge dans les nuits de sources
si jamais je te rencontre fille
après les femmes de la soif glacée
je pleurerai te consolerai
de tes jours sans pluies et sans quenouilles
des circonstances de l’amour dénoué
j’allumerai chez toi les phares de la douceur
nous nous reposerons dans la lumière
de toutes les mers en fleurs de manne
puis je jetterai dans ton corps le vent de mon sang
tu seras heureuse fille heureuse
d’être la femme que tu es dans mes bras
le monde entier sera changé en toi et moi
la marche à l’amour s’ébruite en un voilier
de pas voletant par les lacs de portage
mes absolus poings
ah violence de délices et d’aval
j’aime
que j’aime
que tu t’avances
ma ravie
frileuse aux pieds nus sur les frimas de l’aube
par ce temps profus d’épilobes en beauté
sur ces grèves où l’été
pleuvent en longues flammèches les cris des pluviers
harmonica du monde lorsque tu passes et cèdes
ton corps tiède de pruche à mes bras pagayeurs
lorsque nous gisons fleurant la lumière incendiée
et qu’en tangage de moisson ourlée de brises
je me déploie sur ta fraîche chaleur de cigale
je roule en toi
tous les saguenays d’eau noire de ma vie
je fais naître en toi
les frénésies de frayères au fond du coeur d’outaouais
puis le cri de l’engoulevent vient s’abattre dans ta gorge
terre meuble de l’amour ton corps
se soulève en tiges pêle-mêle
je suis au centre du monde tel qu’il gronde en moi
avec la rumeur de mon âme dans tous les coins
je vais jusqu’au bout des comètes de mon sang
haletant
harcelé de néant
et dynamité
de petites apocalypses
les deux mains dans les furies dans les féeries
ô mains
ô poings
comme des cogneurs de folles tendresses
mais que tu m’aimes et si tu m’aimes
s’exhalera le froid natal de mes poumons
le sang tournera ô grand cirque
je sais que tout mon amour
sera retourné comme un jardin détruit
qu’importe je serai toujours si je suis seul
cet homme de lisière à bramer ton nom
éperdument malheureux parmi les pluies de trèfles
mon amour ô ma plainte
de merle-chat dans la nuit buissonneuse
ô fou feu froid de la neige
beau sexe léger ô ma neige
mon amour d’éclairs lapidée
morte
dans le froid des plus lointaines flammes
puis les années m’emportent sens dessus dessous
je m’en vais en délabre au bout de mon rouleau
des voix murmurent les récits de ton domaine
à part moi je me parle
que vais-je devenir dans ma force fracassée
ma force noire du bout de mes montagnes
pour te voir à jamais je déporte mon regard
je me tiens aux écoutes des sirènes
dans la longue nuit effilée du clocher de Saint-Jacques
et parmi ces bouts de temps qui halètent
me voici de nouveau campé dans ta légende
tes grands yeux qui voient beaucoup de cortèges
les chevaux de bois de tes rires
tes yeux de paille et d’or
seront toujours au fond de mon coeur
et ils traverseront les siècles
je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi
lentement je m’affale de tout mon long dans l’âme
je marche à toi, je titube à toi, je bois
à la gourde vide du sens de la vie
à ces pas semés dans les rues sans nord ni sud
à ces taloches de vent sans queue et sans tête
je n’ai plus de visage pour l’amour
je n’ai plus de visage pour rien de rien
parfois je m’assois par pitié de moi
j’ouvre mes bras à la croix des sommeils
mon corps est un dernier réseau de tics amoureux
avec à mes doigts les ficelles des souvenirs perdus
je n’attends pas à demain je t’attends
je n’attends pas la fin du monde je t’attends
dégagé de la fausse auréole de ma vie
L’Homme Rapaillé, 1970.
Trintignant, Mille, Piazzolla Théâtre de la Porte-Saint-Martin
Du 11 au 22 décembre Du mardi au samedi à 18 h 30, sauf 16 et 17 décembre.