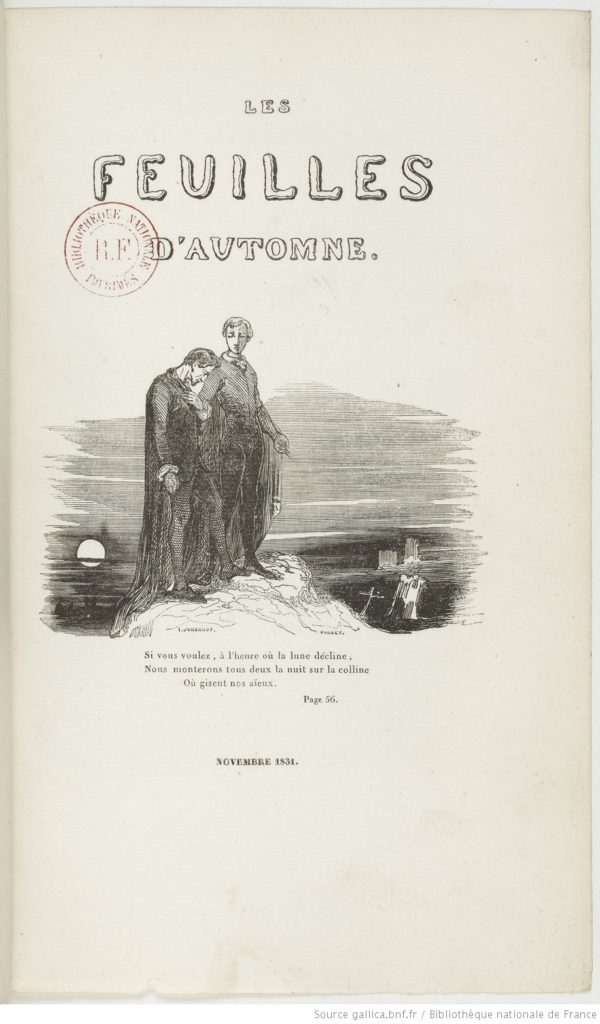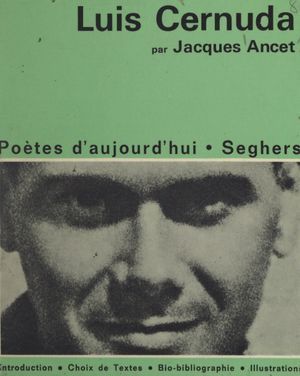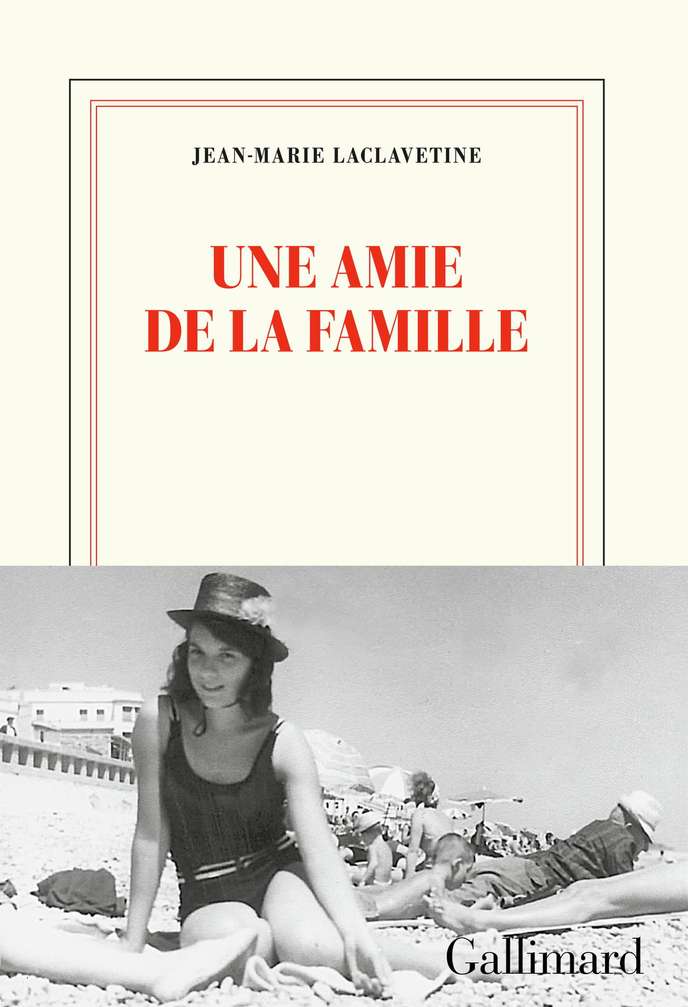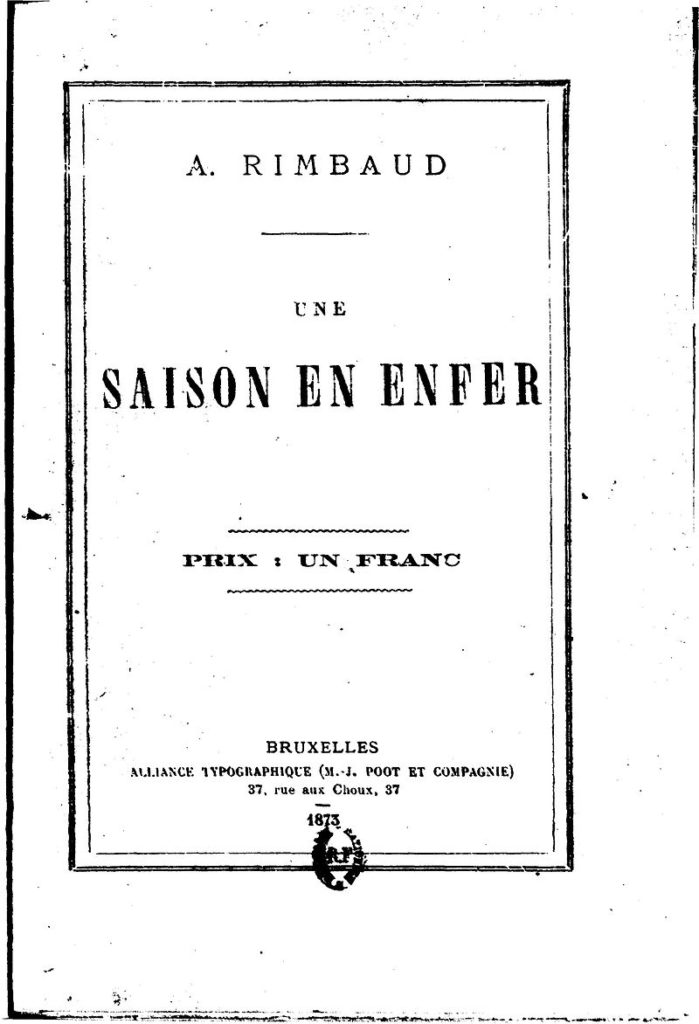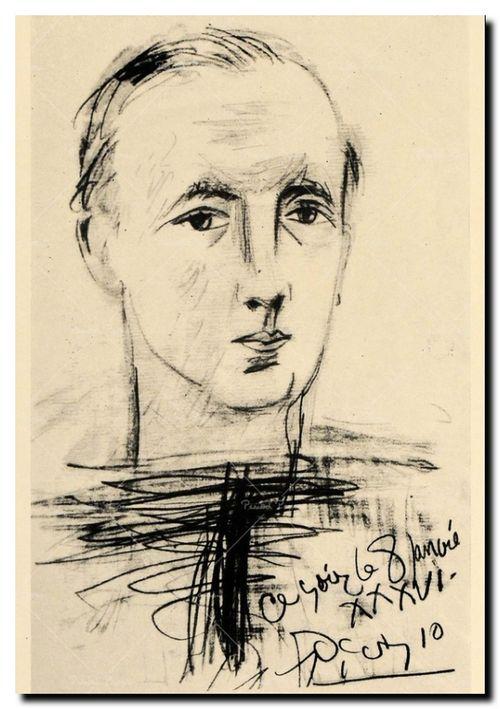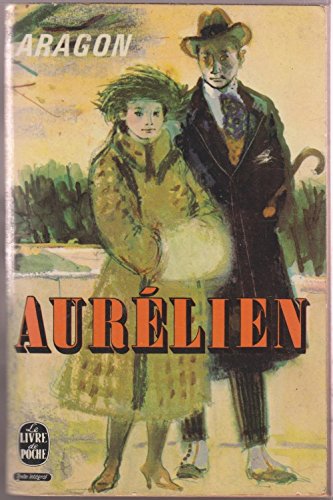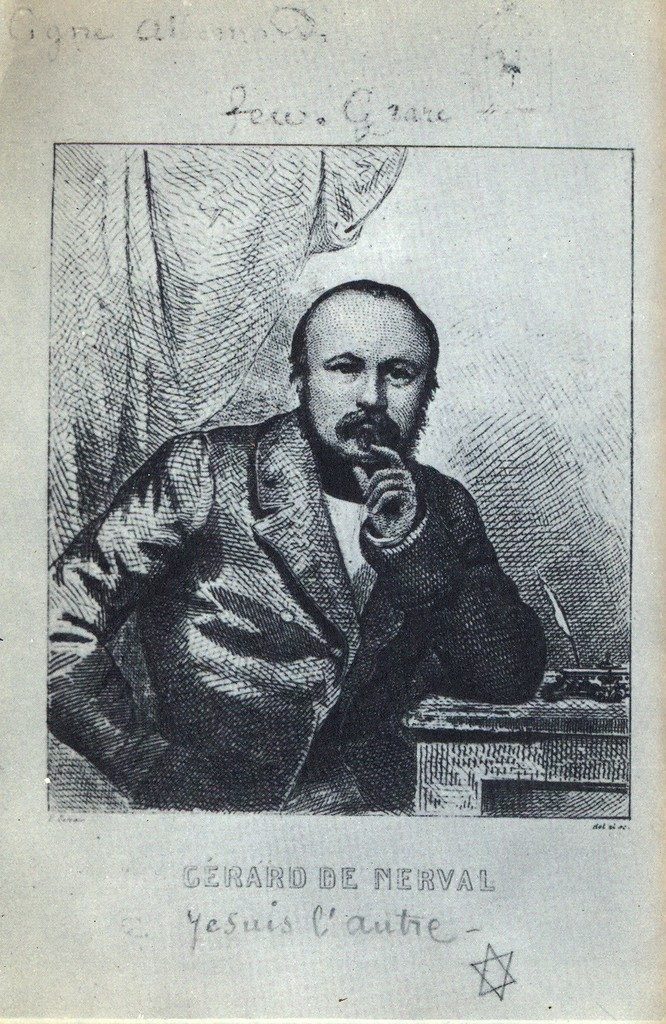Yvon le Men a lu le poème Solo sur Radio-Armorique, le jour de l’Ascension, en 1981, quelques mois avant la mort de Xavier Grall. Depuis, il déclame souvent les poèmes du poète breton.
Prologue de Besoin de poème, Editions du Seuil, 2006.
“Je fus le premier lecteur et diseur de ce poème. j’ai fait corps avec lui sans aucune distance, sans aucune protection. Vingt ans plus tard, je confirme ma chance de l’avoir lu, mon choix de l’avoir dit. Jamais prière ne fut plus juste, plus humble, plus incarnée par un corps aussi désincarné, par un homme aussi épuisé. A chaque phrase, Xavier lampait une gorgée d’air puis rejetait une gorgée de mots. jamais poème ne fut plus inspiré, jamais le mot respiration ne prit autant sa place entre inspiration et expiration. jamais souffle ne fut aussi essoufflé.”

Solo
Seigneur me voici c’est moi
je viens de petite Bretagne
mon havresac est lourd de rimes
de chagrins et de larmes
j’ai marché
Jusqu’à votre grand pays
ce fut ma foi un long voyage
trouvère
j’ai marché par les villes
et les bourgades
François Villon
dormait dans une auberge
à Montfaucon
dans les Ardennes des corbeaux
et des hêtres
Rimbaud interpellait les écluses
les canaux et les fleuves
Verlaine pleurait comme une veuve
dans un bistrot de Lorraine
Seigneur me voici c’est moi
de Bretagne suis
ma maison est à Botzulan
mes enfants mon épouse y résident
mon chien mes deux cyprès
y ont demeurance
m’accorderez-vous leur recouvrance ?
Seigneur mettez vos doigts
dans mes poumons pourris
j’ai froid je suis exténué
O mon corps blanc tout ex-voté
j’ai marché
les grands chemins chantaient
dans les chapelles
les saints dansaient dans les prairies
parmi les chênes erraient les calvaires
O les pardons populaires
O ma patrie
j’ai marché
j’ai marché sur les terres bleues
et pèlerines
j’ai croisé les albatros
et les grives
mais je ne saurais dire
jusqu’aux cieux
l’exaltation des oiseaux
tant mes mots dérivent
et tant je suis malheureux
Seigneur me voici c’est moi
je viens à vous malade et nu
j’ai fermé tout livre
et tout poème
afin que ne surgisse
de mon esprit
que cela seulement
qui est ma pensée
Humble et sans apprêt
ainsi que la source primitive
avant l’abondance des pluies
et le luxe des fleurs
Seigneur me voici devant votre face
chanteur des manoirs et des haies
que vous apporterai-je
dans mes mains lasses
sinon les traces et les allées
l’âtre féal et le bruit des marées
les temps ont passé
comme l’onde sous le saule
et je ne sais plus l’âge
ni l’usage du corps
je ne sais plus que le dit
et la complainte
telle la poésie
mon âme serait-elle patiente
au bout des galantes années?
Seigneur me voici c’est moi
de votre terre j’ai tout aimé
les mers et les saisons
et les hommes étranges
meilleurs que leurs idées
et comme la haine est difficile
les amants marchent dans la ville
souvenez-vous de la beauté humaine
dans les siècles et les cités
mais comme la peine est prochaine!
Seigneur me voici c’est moi
j’arrive de lointaine Bretagne
O ma barque belle
parmi les bleuets et les dauphins
les brumes y sont plus roses
que les toits de l’Espagne
je viens d’un pays de marins
les rêves sur les vagues
sont de jeunes rameurs
qui vont aux îles bienheureuses
de la grande mer du Nord
Je viens d’un pays musicien
liesses colères et remords
amènent les vents hurleurs
sur le clavier des ports
je viens d’un pays chrétien
ma Galilée des lacs et des ajoncs
enchante les tourterelles
dans les vallons d’avril
me voici Seigneur devant votre face
sainte et adorable
mendiant un coin de paradis
parmi les poètes de votre extrace
si maigre si nu
je prendrai si peu de place
que cette grâce
je vous supplie de l’accorder
au pauvre hère que je suis
ayez pitié Seigneur
des bardes et des bohémiennes
qui ont perdu leur vie
sur le chemin des auberges
nulle orgue grégorienne
n’a salué leur trépas
pour ceux qui meurent
dans les fossés
une feuille d’herbe dans la bouche
le cœur troué d’une vielle peine
de lourdes larmes dans le paletot
et dans les veines des lais et des rimes
Seigneur ayez pitié!
La mort vient tôt frapper
à notre porte
les vents d’hiver emportent
les poitrinaires
et pour flétrir les pâles primevères
il suffit que l’ondée se conforte
d’un peu de givre et de Galerne
la vie s’en va la vie s’en vient
ma belle passante mon étrangère
la vie s’en vient la vie s’en va
lonla lonlaine et caetera
S
SOL
L
O
ma rose des vents
mon signe de croix
S
O
ILE
O
Mon ex-voto
dans la crypte marine
chantez saxos
S
O
L
FOL
stèle et fanal
flamme
amer du littoral
signe vertical
de la raison
face aux fatales démences
de la mer et des lames
J’aurais aimé chanter le triomphe
des marées à la corne des caps
et la douceur des plages
dans les criques pélagiennes
un orchestre de pianistes
et de harpeurs
eût repris le thème de l’antienne
car je portais dans mon sang
mystique
des hymnes marins
et des fureur liturgiques
j’aurais aimé chanter
les varechs verts
les germons bleus
les daurades d’or
les couleurs et les chaos
par la harpe et le saxo
mon Dieu je vous adore
Orgues de Benjamin Britten
Cuivres de Ludwig Van Beethoven
Les symphonies fusent
dans les rocs d’Ouessant
les tintamarres furieux
fracassent les brisants
qui dira les sonorités multicolores
dans la gorge des rias
les corps morts dansent
les cormorans fustigent les amarres
les coques des naufrages
cognent dans les baies
des oiseaux hurleurs
descendent dans mes veines
mon âme est cette porte battante
ouverte sur la mer
j’attends la fuite des vents
à la renverse
paix sur les noyés et les goémons
paix sur les îles et les quais
mon cœur
tranquille caboulot
à la bonne brise
au-dessus des limons
affiche son enseigne
«Au repos du marin»
Solo
Solo de mes noyades
solo de mes sanglots
j’agite des violons brisé
sur mes amours mortes
mes barques chavirées
accrochent des grelots
aux chagrins sourds
qui lentement m’emportent
Solo
Solo d’oraisons ferventes
il m’arrive de prier
dans les églises défuntes
Notre-Dame des poètes
mère des Atlantes
pitié pour ce voilier perdu
au large des pâles limbes
Solo
Solo de mes années passantes
haleurs et musiciens
désertent les bordées
mon âme est cette Marie-Galante
que défoncent les vins
et les rhums boucanés
Solo
Solo de mes pensées dolentes
musiques enfuies motets anciens
tout périt dans les marées violentes
l’Océan tracasse des pianos
à la gueule des chiens
Seigneur me voici c’est moi
je viens à vous issu d’un pays de mer
les tempêtes ont réjoui mon amère jeunesse
la liesse des alizés roulait dans les collèges
les goélands croisaient dans mes classes latines
des Maris Stella à matines
éclataient dans les nefs
les noroîts jouaient de l’harmonium
délirium du graduel
cantique des grèves ivres
O les navires et les chapelles
Etoile de la mer
Qu’ai-je fait de ma chère jeunesse?
Seigneur me voici c’est moi
dans les bonnes auberges
j’ai traîné ma détresse
les bouteilles entonnaient des pavanes
dans les verres je buvais des rengaines
les bars roulaient comme des rivières
j’ai prié comme jamais dans les ivresses
faisant des femmes des suzeraines
qu’elles fussent allemandes
bretonnes françaises
leur beauté glorifiée par l’absinthe
dissolvait la bassesse
c’était ma tournée aux tables saintes
Seigneur
les bars chantent toujours dans les villes
ma santé trop vile les déserte
je ne vois plus les Belles
qu’au fond de ma mémoire
Brestoises Rhénanes ou Parisiennes
elles ont quitté mon domaine
fermons les persiennes
sur mes cinquante et une années
j’écrase les feuilles mortes
dans les allées
les temps ronge les vies et les grimoires
adieu les Reines les bars et camarades
je tiens comme un pourboire
votre souvenir
adieu mes fêtes et mes délires
adieu mes désirades
……………………………………………………….
Seigneur Dieu
A mes frères et amis
Aux femmes que j’ai aimées
A tous ceux que mon cœur à croisés
Avant que d’entrer dans les ténèbres
Transmettez je vous prie mon espérance testamentaire
Nul chant nul solo
Nulle symphonie nul concerto
Qui porte nostalgie d’amour
Et soif et faim de tendresse
Ne sera perdu dans la détresse de lamer
Voilà et puis encore ceci
Par la dernière larme
Par l’ultime halètement
Par le dernier frémissement
Par le moineau qui s’envole
Par le geai sur la branche
Par la dernière chanson
Par la joie dans la grange
Par le vent qui se lève
Par le matin qui vient
Tout simplement
Je vous rends grâce
D’avoir été dans le bondissement incroyable
De votre création
Et misérable
Oui
Tout simplement
Un être humain
Parmi les milliards et les milliards
De vos créatures
A présent que les feuilles et les mains
De douce Nature
Me closent les yeux !
Mais Seigneur Dieu
Comme la vie était jolie
En ma Bretagne bleue !”
Solo et autres poèmes, Editions Calligrammes, 29000 Quimper 1981.