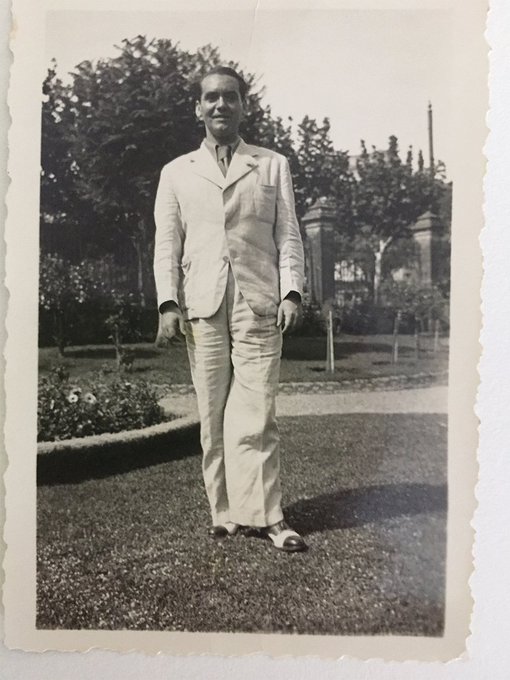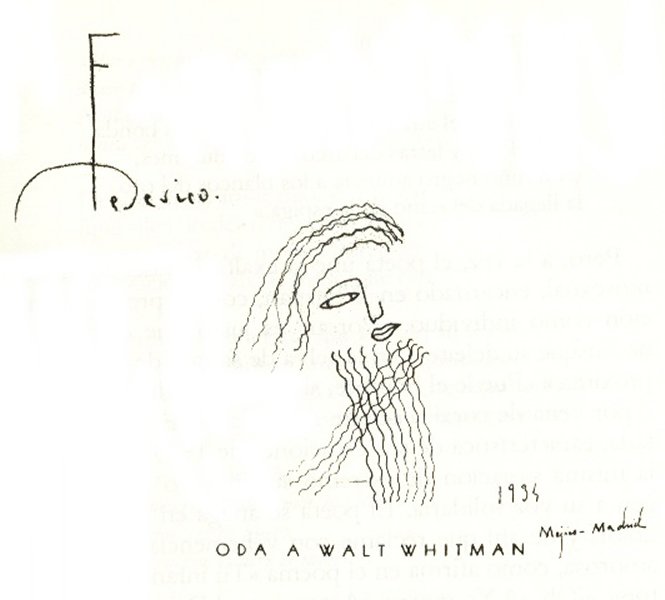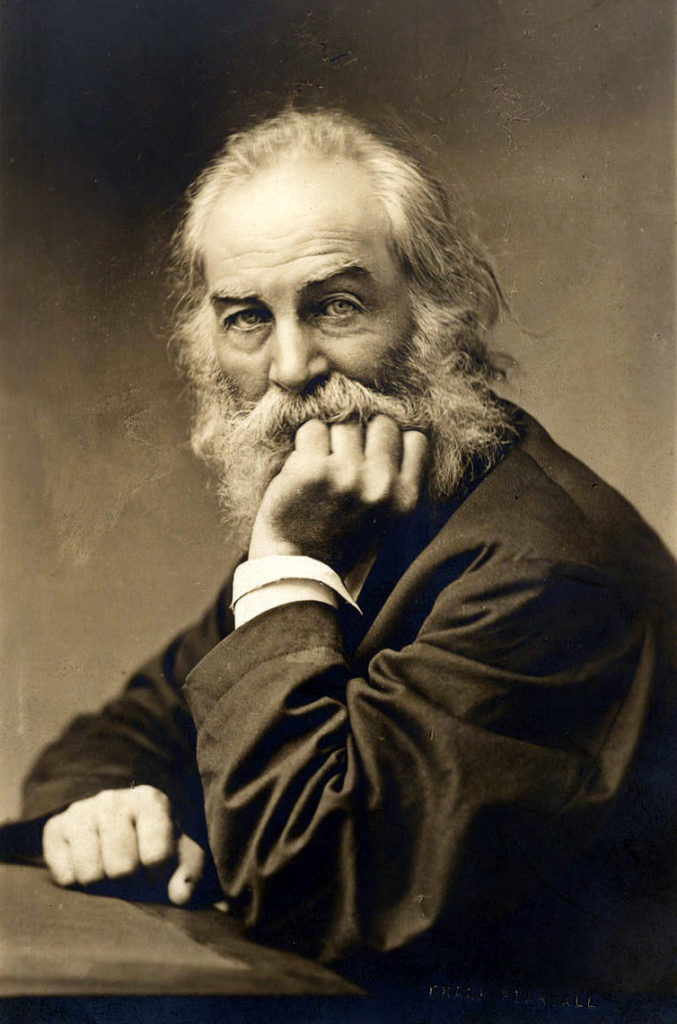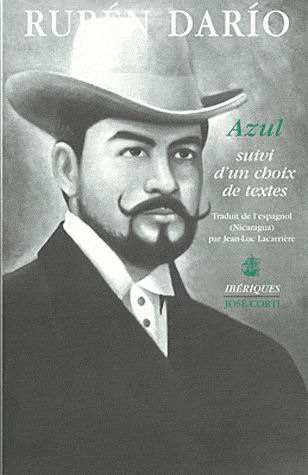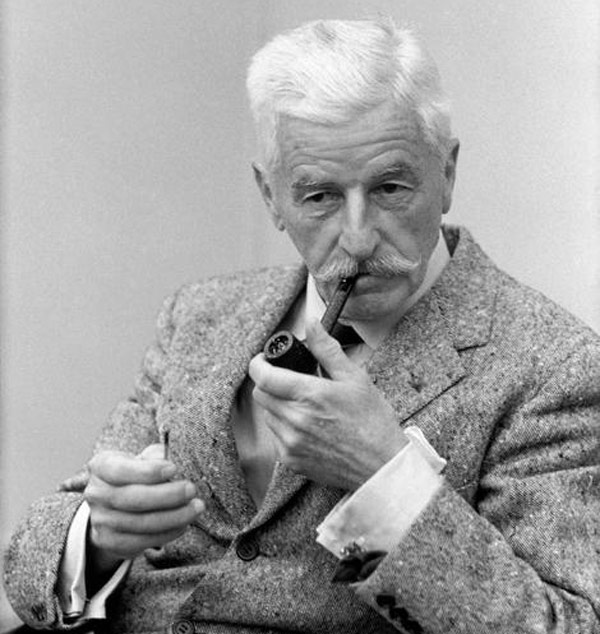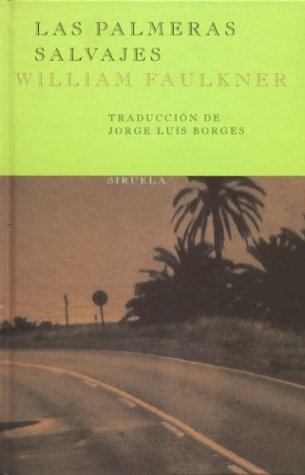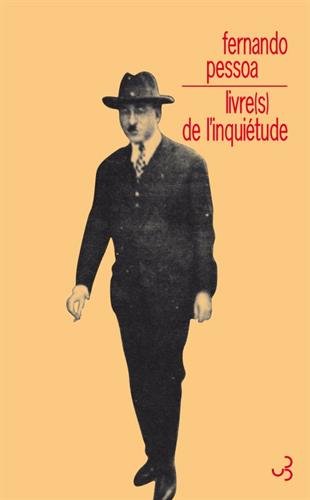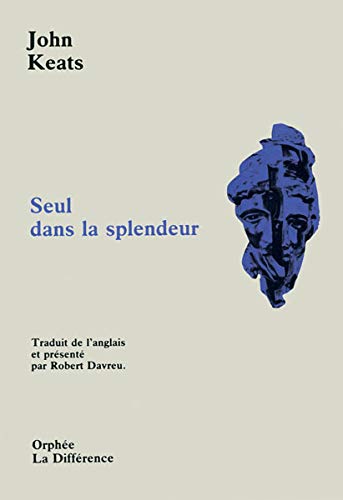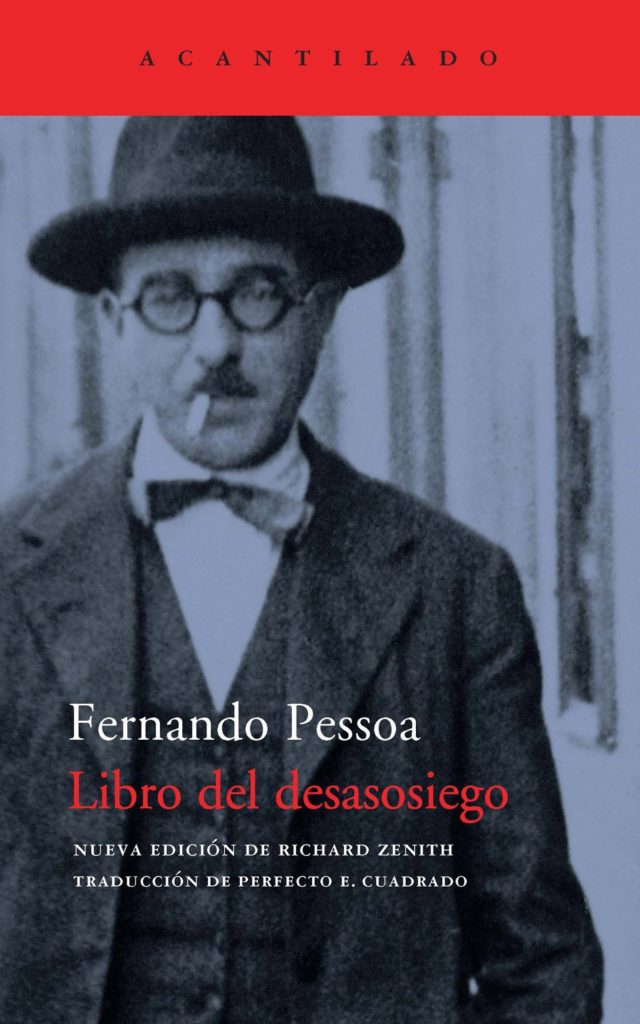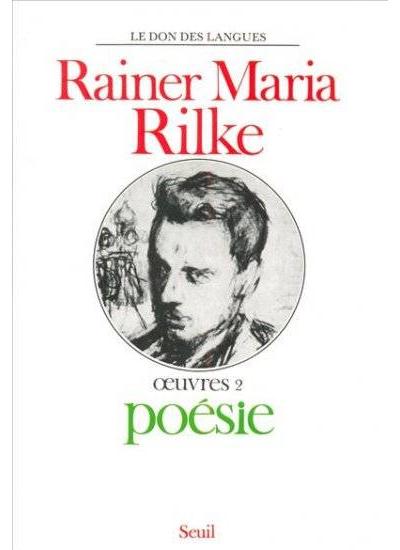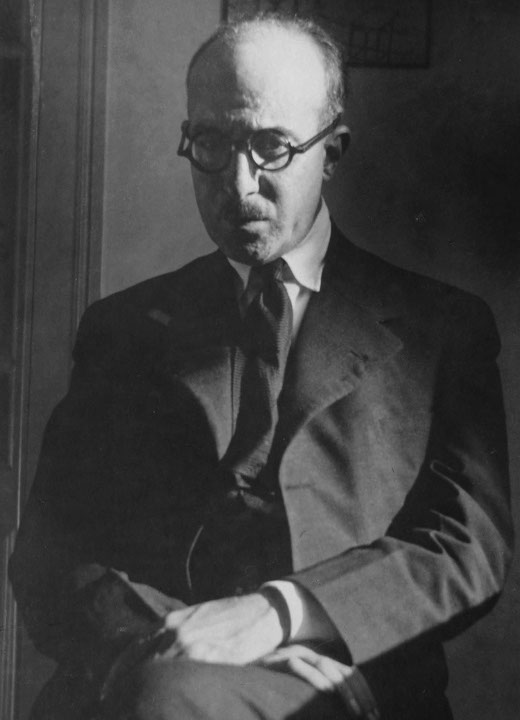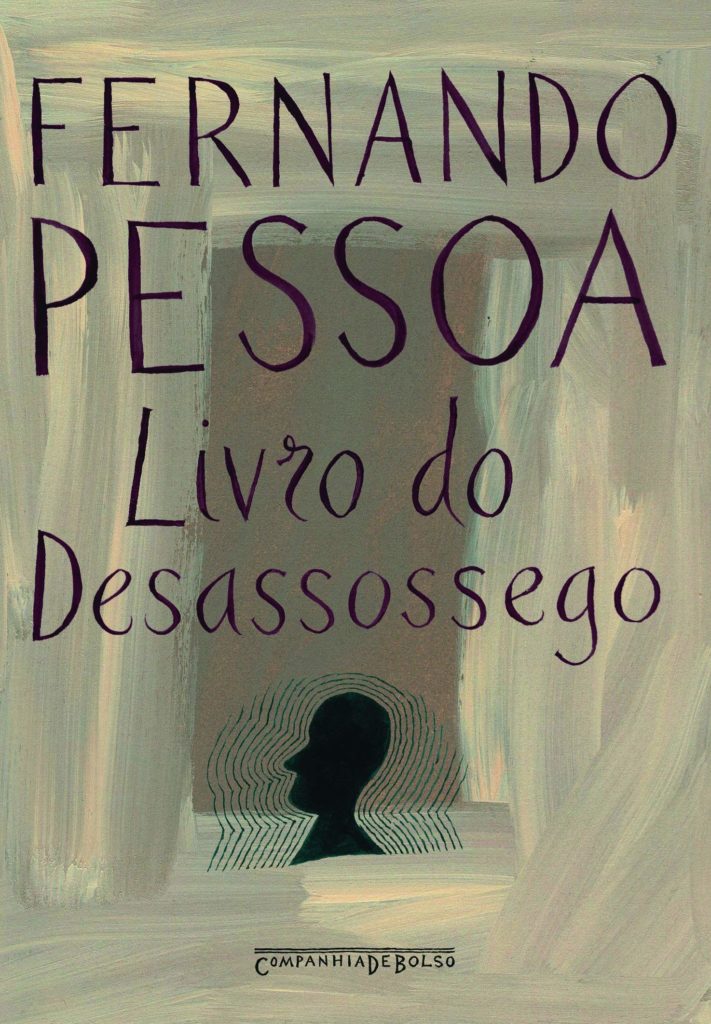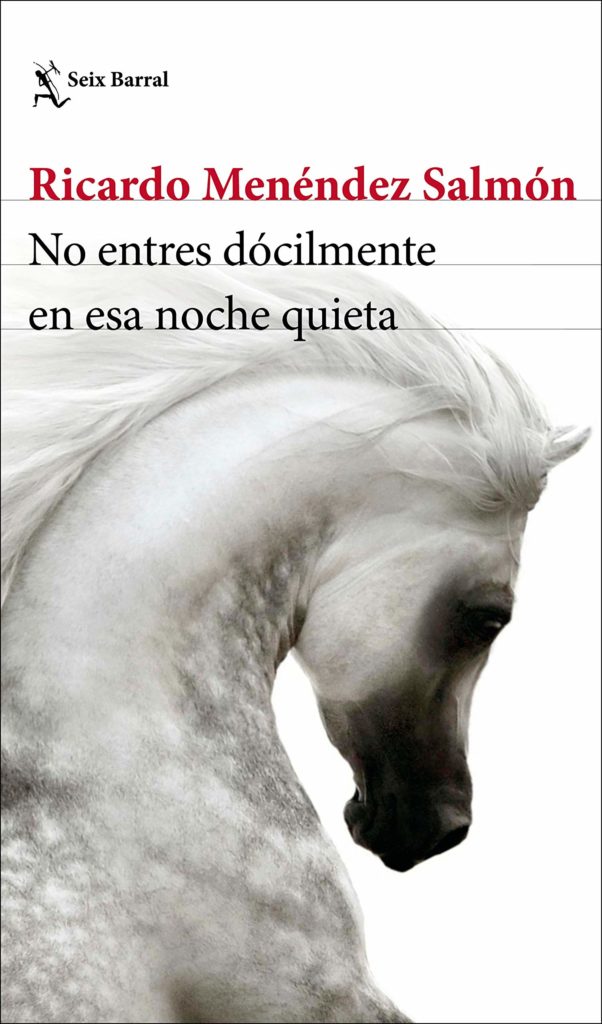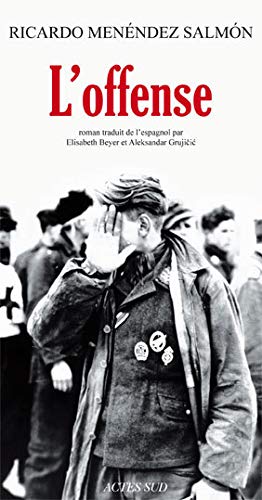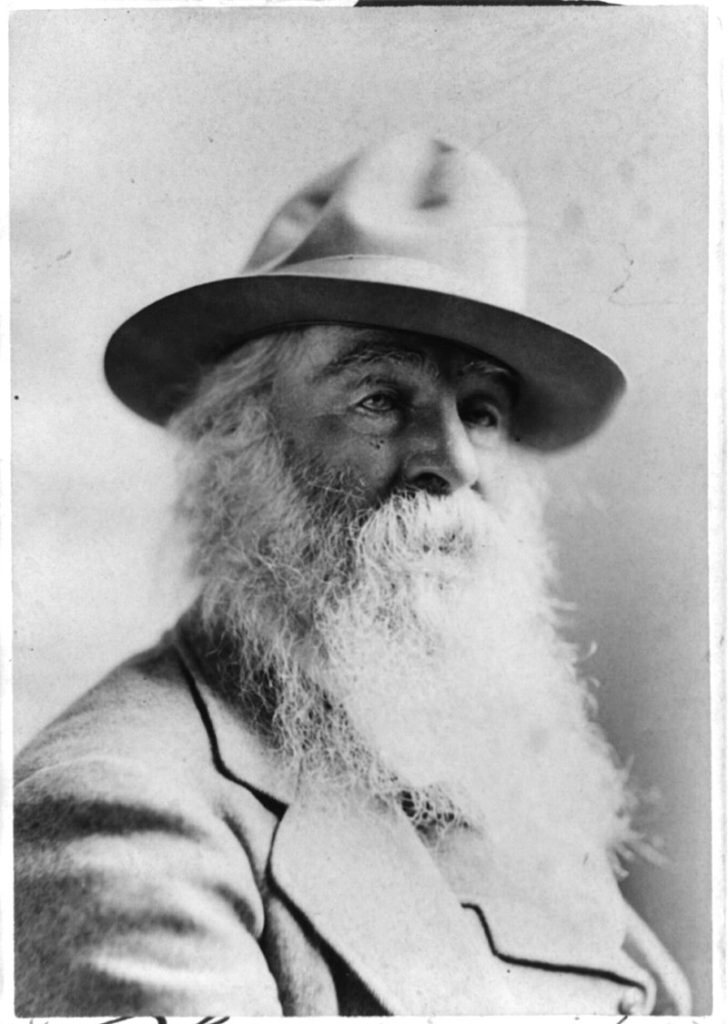
Ode à Walt Whitman
Par l’East River et le Bronx
les garçons chantaient, montrant leur ceinture
avec la roue, l’huile, le cuir et le marteau.
Quatre-vingt dix mille mineurs tiraient l’argent des rochers
et les enfants dessinaient des escaliers et des perspectives.
Mais aucun ne s’endormait,
aucun ne voulait être rivière,
aucun n’aimait les larges feuilles
ni la langue bleue de la plage.
Par l’East River et le Queensboro
les garçons luttaient avec l’industrie
les Juifs vendaient au faune du fleuve
la rose de la circoncision,
et le ciel lâchait sur les ponts et les toits
des troupeaux de bisons poussés par le vent.
Mais aucun ne s’arrêtait,
aucun ne voulait être nuage,
aucun ne cherchait les fougères
ni la roue jaune du tambourin.
Au lever de la lune
les poulies tourneront pour brouiller le ciel ;
une frontière d’aiguilles cernera la mémoire
et les cercueils emporteront ceux qui ne travaillent pas.
New York de fange,
New York de fil de fer et de mort,
Quel ange portes-tu caché dans ta joue?
Quelle voix parfaite dira la vérité des blés?
Qui dira le sommeil terrible de tes anémones souillées?
Pas un seul instant, beau Walt Whitman,
Je n’ai cessé de voir ta barbe pleine de papillons,
ni tes épaules de panne usées par la lune,
ni tes cuisses d’Apollon virginal,
ni ta voix comme une colonne de cendres,
vieillard beau comme le brouillard
qui gémissait à l’égal d’un oiseau
sexe transpercé d’une aiguille.
Ennemi du satyre,
ennemi de la vigne,
et amant des corps sous la toile grossière.
Pas un seul instant, beauté virile,
qui, parmi les montagnes de charbon, les réclames et les chemins de fer,
rêvait d’être un fleuve et de dormir comme un fleuve
avec ce camarade qui aurait mis dans ta poitrine
cette petite douleur d’innocent léopard.
Pas un seul instant, Adam de sang, mâle,
homme seul sur la mer, beau vieillard Walt Whitman,
parce que sur les terrasses,
groupés dans les bars,
sortant en grappes des égouts,
tremblant entre les jambes des chauffeurs,
ou tournant sur les plates-formes de l’absinthe,
les efféminés, Walt Whitman te suivaient.
Lui aussi! Lui aussi ! et ils se précipitent
sur ta barbe lumineuse et chaste,
Blonds du nord, Noirs du désert,
multitude de cris et de gestes,
comme les chats et comme les serpents,
les efféminés, Walt Whitman, les efféminés,
brouillés de larmes, chair pour le fouet,
la botte ou la morsure du dompteur.
Lui aussi! Lui aussi ! Leurs doigts teints
tintent à l’orée de ton rêve
quand l’ami mange ta pomme
au léger goût de pétrole
et le soleil chante sur le nombril
des garçons qui jouent sous les ponts.
Mais tu ne cherchais pas les yeux égratignés,
ni le sombre marais où dorment les enfants,
ni la salive glacée,
ni les blessures courbes comme des panses de crapaud
que portent les efféminés dans les voitures et aux terrasses
quand la lune les fouette au coin de la terreur.
Tu cherchais un nu qui fût comme un fleuve.
Taureau et songe qui joignît l’algue à la roue,
père de ton agonie, camélia de ta mort,
qui gémirait dans les flammes de ton équateur secret.
Parce qu’il est juste que l’homme ne cherche pas sa jouissance
dans la forêt de sang du proche lendemain.
Le ciel a des plages où éviter la vie
et il y a des corps qui ne doivent pas se répéter dans l’aurore.
Agonie, l’agonie, rêve, ferment et rêve.
Voici le monde ami, agonie, agonie.
Les morts se décomposent sous l’horloge des villes
la guerre passe en pleurant, avec un million de rats gris,
les riches offrent à leurs bien-aimées
de petits moribonds illuminés,
et la vie n’est ni noble, ni bonne, ni sacrée.
L’homme peut s’il le veut conduire son désir
par une veine de corail ou un nu céleste.
Demain, les amours seront des rochers, et le temps
une brise qui vient dormante sous les branches.
C’est pourquoi je n’élève pas la voix, vieux Walt Whitman,
contre l’enfant qui écrit
un nom de fille sur son oreiller
ni contre l’adolescent qui s’habille en mariée
dans l’obscurité de sa chambre,
ni contre les solitaires des casinos
qui boivent avec dégoût l’eau de la prostitution,
ni contre les hommes au regard vert
qui aiment l’homme et brûlent leurs lèvres en silence.
Mais bien contre vous, efféminés des villes
à la chair tuméfiée et aux pensées immondes,
mères de la fange, harpies, ennemies sans trêve
de l’Amour qui partage des couronnes de joie.
Contre vous toujours, qui donnez aux garçons
des gouttes de mort sale et du venin amer.
Contre vous toujours,
Faeries de l’Amérique
Pajaros de La Havane,
Jotos de Mexico,
Sarasas de Cadix,
Apios de Séville,
Cancos de Madrid,
Floras d’Alicante,
Adelaidas du Portugal..
Efféminés du monde entier, assassins de colombes !
Esclaves de la femme, chiens de leurs boudoirs,
ouverts sur les places avec des fièvres d’éventail
ou embusqués dans des paysages desséchés de ciguë.
Pas de quartier ! La mort
sourd de vos yeux
et rassemble ses fleurs grises aux frontières de la fange.
Pas de quartier ! Alerte !
Que les confondus, les purs,
les classiques, les insignes, les suppliants
vous ferment les portes de l’orgie.
Et toi, beau Walt Whitman, dors au rivage de l’Hudson,
la barbe vers le pôle, et les mains ouvertes.
Argile tendre ou neige, ta langue appelle
tes camarades qui veillent ta gazelle sans corps.
Dors, rien ne subsiste.
Une danse de murs agite les prairies
et l’Amérique est submergée de machines et de larmes.
Je veux que l’air violent de la nuit la plus profonde
arrache fleurs et lettres à l’arche où tu dors
et qu’un enfant noir annonce aux blanc de l’or
la venue du règne de l’épi.
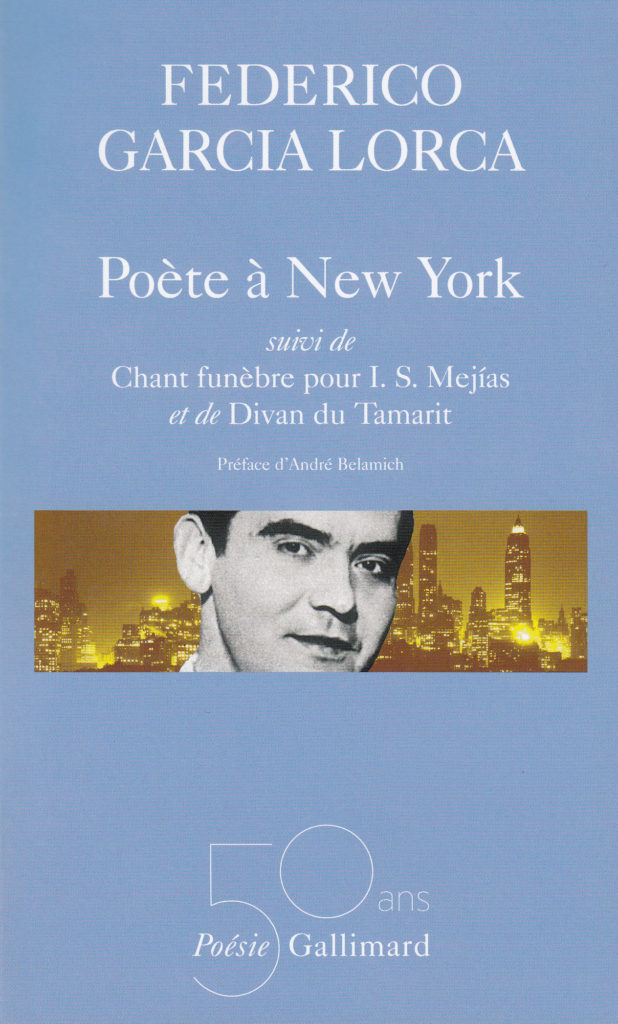
Traduit de l’espagnol par André Belamich. Nouvelle édition en 2016 de Poésies, III.
Collection Poésie/Gallimard n° 30, Gallimard. 1968.