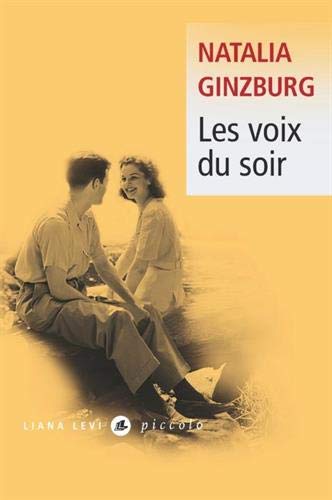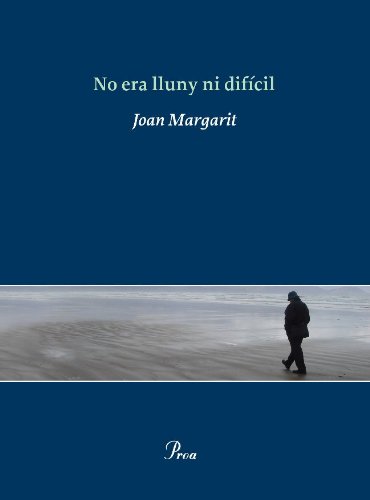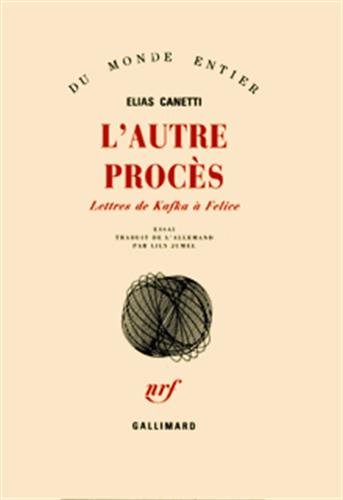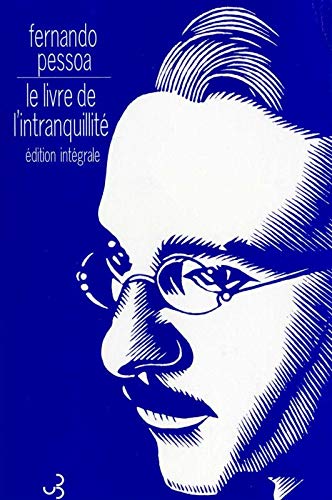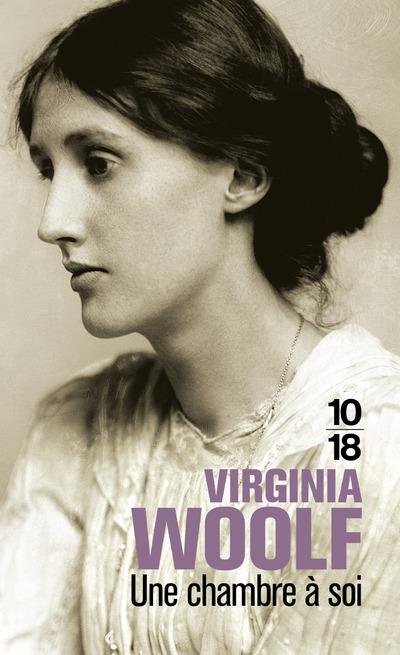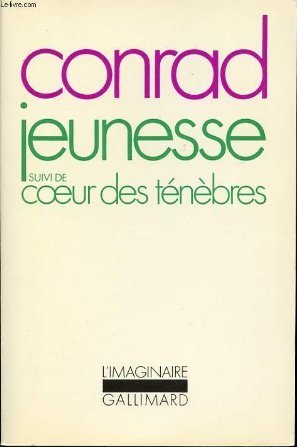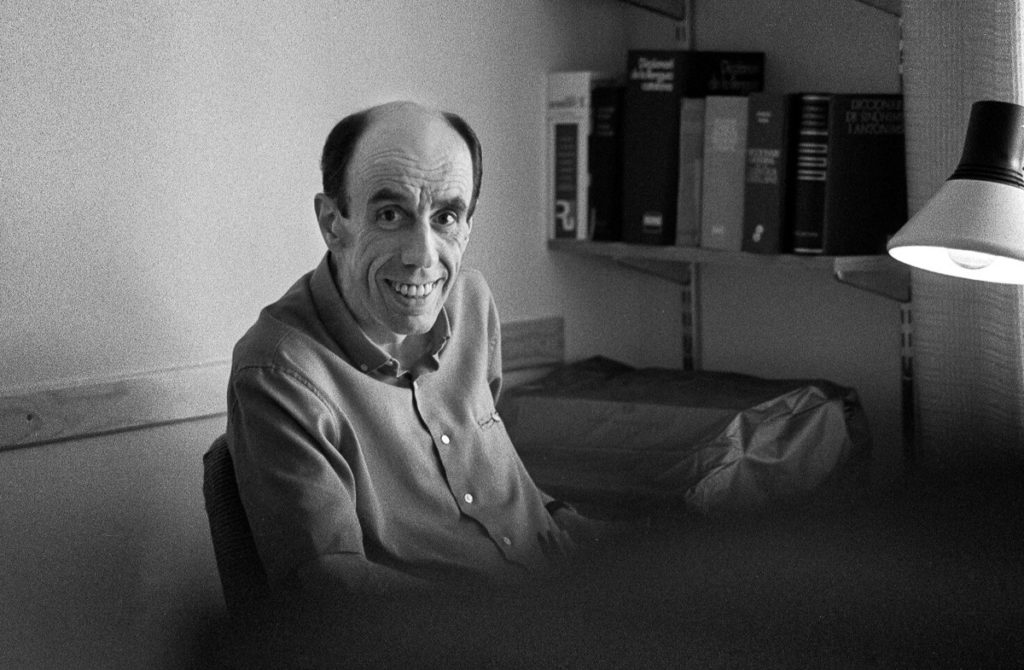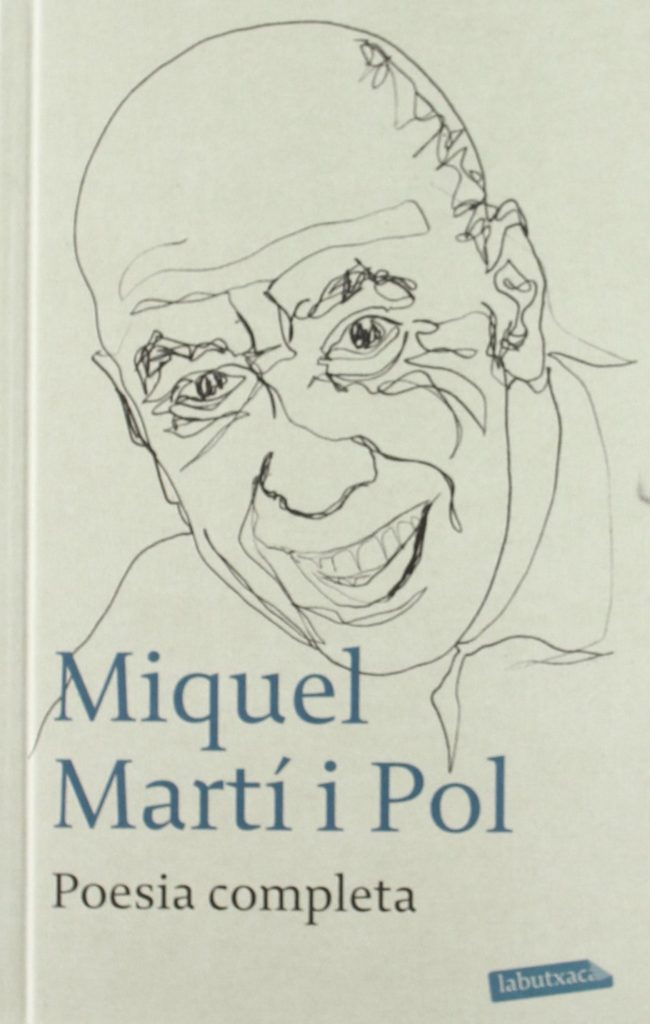NOUVELLES 1888-1896 (TOME III DES ŒUVRES COMPLÈTES) de Henry James. Traduites de l’anglais par Jean Pavans. Éditions de La Différence. 2008.
Henry James écrit la nouvelle Entre deux âges (The Middle Years) alors qu’il a 50 ans. Elle est publiée par la revue Scribner’s Magazine en 1893.
Le «pauvre Dencombe», un célèbre écrivain vieillissant, est en convalescence sur la côte anglaise, près de Bournemouth. Son éditeur lui envoie son dernier livre qui vient tout juste d’être imprimé. Il s’intitule The Middle Years. Il n’est pas content de ce qu’il relit. Il corrige encore le texte et envisage avec effroi la fin de sa vie. En se promenant, il croise un jeune homme qui tient à la main ce même livre qu’un ami critique vient de lui envoyer. Le jeune Hugh est médecin et fait devant l’écrivain, qu’il ne reconnaît pas, un éloge enthousiaste et sincère. Il accompagne une riche et excentrique comtesse anglaise qui séjourne avec sa dame de compagnie, Miss Vernham, dans le même hôtel que Dencombe. Le jeune médecin délaisse la comtesse pour s’occuper de l’écrivain souffrant. Elle meurt peu après et ne laisse rien en héritage au jeune homme alors qu’elle lui en avait fait un moment la promesse. Le doute mystique de l’écrivain habité par la foi en son art sacré est pathétiquement exprimé par Dencombe mourant dans les bras du docteur Hugh.
Quelques extraits du texte:
«It came over him in the long, quiet hours that only with The Middle Years had he taken his flight; only on that day, visited by soundless processions, had he recognised his kingdom. He had had a revelation of his range. What he dreaded was the idea that his reputation should stand on the unfinished. It was not with his past but with his future that it should properly be concerned. Illness and age rose before him like spectres with pitiless eyes: how was he to bribe such fates to give him the second chance? He had had the one chance that all men have – he had the chance of life.»
Page 684. « Et cet élan, il se convainquit, durant ces longues heures solitaires, qu’il l’avait pris seulement avec Entre deux âges: c’était seulement ce jour-là que, visité par des processions silencieuses, il avait reconnu son royaume. Il avait eu la révélation de son registre. Ce qu’il redoutait, c’était que sa réputation pût s’établir sur une expérience inachevée. C’était, non pas sur son passé, mais sur son avenir, que sa réputation devait se fonder. L’âge et la maladie se dressaient devant lui comme des spectres aux yeux impitoyables: comment pourrait-il les soudoyer afin d’obtenir une deuxième chance? Il avait eu l’unique chance qu’ont tous les êtres humains: il avait eu la chance de venir au monde.»
«…It isn’t till we are old that we begin to tell ourselves we’re not!»
«He recovered himself, however, to explain, lucidly enough, that if he, ungraciously, knew nothing of such a balm, it was doubtless because he had wasted inestimable years. He had followed literature from the first, but he had taken a life-time to get alongside of her. Only today, at last, had he begun to see, so that what he had hitherto done was a movement without of direction. He had ripened too late and was so clumsily constituted that he had had to teach himself by mistakes.»
Page 685 « C’est seulement quand on est vieux, qu’on commence à se dire qu’on ne l’est pas.»
«Il se ressaisit, cependant, pour expliquer, assez lucidement, que si lui, malheureusement, ignorait une pareille consolation, c’était sans doute parce qu’il avait gâché des années inestimables. Il avait suivi la littérature dès le début, mais il lui avait fallu toute une vie pour la rattraper. Seulement aujourd’hui, enfin, il s’était mis à voir, et ce qu’il avait fait jusqu’à présent n’était que des tâtonnements désorientés. Il avait mûri trop tard; il s’était si mal constitué qu’il n’avait pu s’instruire qu’en faisant des erreurs.»
«Two days later Dencombe observed to him, by way of the feeblest of jokes, that there would now be no question whatever of a second chance. At this the young man stared; then he exclaimed: «Why, it has come to pass – it has come to pass! The second chance has been the public’s – the chance to find the point of view, to pick up the pearl!»
«Oh, the pearl!» por Dencombe uneasily sighed. A smile as cold as a winter sunset flickered on his drawn lips as he added: «The pearl is the unwritten – the pearl is the unalloyed, the rest, the lost!»
Page 690. «Deux jours plus tard, Dencombe lui déclara, en guise de très faible plaisanterie, qu’il pouvait absolument ne plus être question d’une quelconque deuxième chance. Le jeune homme écarquilla les yeux; puis il s’écria: «Quoi, elle a déjà eu lieu…elle a déjà eu lieu! La deuxième chance a été celle du public…la chance de comprendre le point de vue, de saisir la perle! “Oh, la perle!” soupira avec peine le pauvre Descombe. Un sourire froid comme un crépuscule d’hiver joua sur ses lèvres crispées quand il ajouta: «La perle est ce qui n’est pas écrit…La perle est ce qui n’ a pas été agrégé, c’est le reste, c’est ce qui est perdu!»
” Not my glory – what there is of it! It is glory – to have been tested, to have had out little quality and cast our little spell. The thing is to have made somebody care. You happen to be crazy, or course, but that doesn’t affect the law.»
«You’re a great success!» said Doctor Hugh, putting into his young voice the ring of a marriage-bell.
Dencombe lay taking this in; then he gathered strength to speak once more. A second chance—that’s the delusion. There never was to be but one. We work in the dark–we do what we can—we give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art”.
«If you,ve doubted, if you’ve despaired, you’ve always done it,» his visitor subtly argued.
«We’ve done something or other,» Dencombe conceded.
«Something or other is everything. It’s the feasible. It’s you!»
«Comforter!» poor Dencombe ironically sighed.
«But it’s true,» insited his friend.
«It’s true. It’s frustration that doesn’t count.»
«Frustration’s only life,» said Doctor Hugh.
«Yes, it’s what passes.» Poor Dencombe was barely audible, but he had marked with the words the virtual end of his first and only chance.»
Page 691 « – Pas ma gloire, en effet…pour ce qu’elle est! C’est de la gloire, que d’avoir été compris, que d’avoir opéré un charme. L’essentiel, c’est d’avoir attiré l’intérêt de quelqu’un. Vous êtes fou, bien sûr, mais cela ne contredit pas la loi.
– Vous avez magnifiquement réussi!» dit le docteur Hugh en mettant dans sa voix juvénile des échos de carillon de mariage.
Dencombe entendit cela sans bouger; puis il rassembla ses forces pour parler encore. «Une deuxième chance…voilà l’illusion! Il n’y en a jamais qu’une seule. Nous travaillons dans les ténèbres, nous faisons ce que nous pouvons, nous donnons ce que nous avons. Notre doute est notre passion, et notre passion est notre devoir. Le reste est la folie de l’art.
– Si vous avez douté, si vous avez désespéré, vous avez toujours fait quelque chose, argua subtilement son visiteur.
– Nous faisons toujours une chose ou une autre, concéda Dencombe.
– Une chose ou une autre est tout! C’est ce qui est faisable. C’est vous!
– Optimiste! Soupira ironiquement le pauvre Dencombe.
– Mais c’est vrai, insista son ami.
– C’est vrai. Ce qui ne compte pas c’est la frustration.
– La frustration n’est que la vie, dit le docteur Hugh.
– Oui, et c’est ce qui se passe.» Le pauvre Dencombe était à peine audible; mais il avait marqué avec ces paroles la fin effective de sa première et unique chance.»
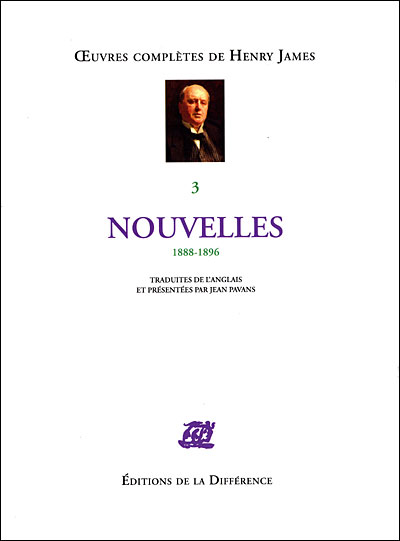
On trouve aussi une autre traduction (Les Années médianes) dans le tome III des Nouvelles complètes 1888-1898. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2011. Traduction de François Piquet.
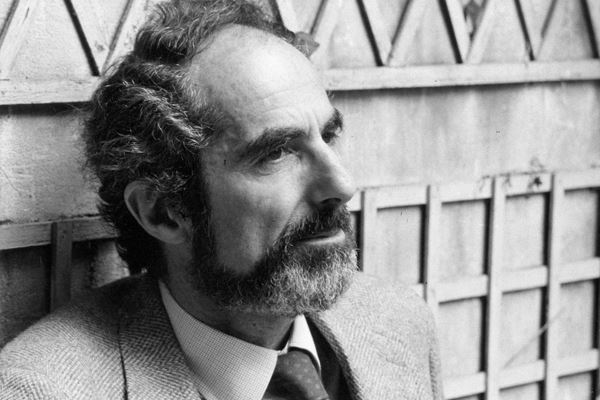
Philip Roth parle de cette nouvelle dans son roman The Ghost Writer (1979), L’écrivain des ombres, Gallimard 1981. Premier tome du cycle Nathan Zuckerman. Cf. Zuckerman enchaîné. Traduction: Henri Robillot et Jean-Pierre Carasso. Folio n°1877. 1987.
Nathan Zuckerman, un jeune écrivain prometteur des années 1950, est victime du jugement de sa famille juive qui trouve que ses nouvelles ne décrivent pas la communauté sous son meilleur jour, mais qu’au contraire, elles tendent à inciter à l’antisémitisme. Le protagoniste décide donc de rendre visite à son idole littéraire, E. I. Lonoff, en quête de reconnaissance.
Toute l’histoire se déroule en 24 heures, chez ce grand écrivain, où Zuckerman rencontre Amy Bellette, une jeune femme qui pourrait être la maîtresse de Lonoff, et qu’il s’imaginera être Anne Frank.
Cette œuvre met en avant les tensions entre l’écriture et les conventions.
«Je lus entièrement deux fois de suite la nouvelle, cherchant à découvrir ce que je pouvais sur le doute qui est la passion de l’écrivain, la passion qui est son devoir et la folie – quelle idée – de l’art.»
Léon Edel, le grand spécialiste d’Henry James, a écrit une magnifique biographie de cet auteur: Henry James, une vie. Traduction André Müller, Paris, Seuil, 1990. Édition originale New York, Harper & Row, 1985.