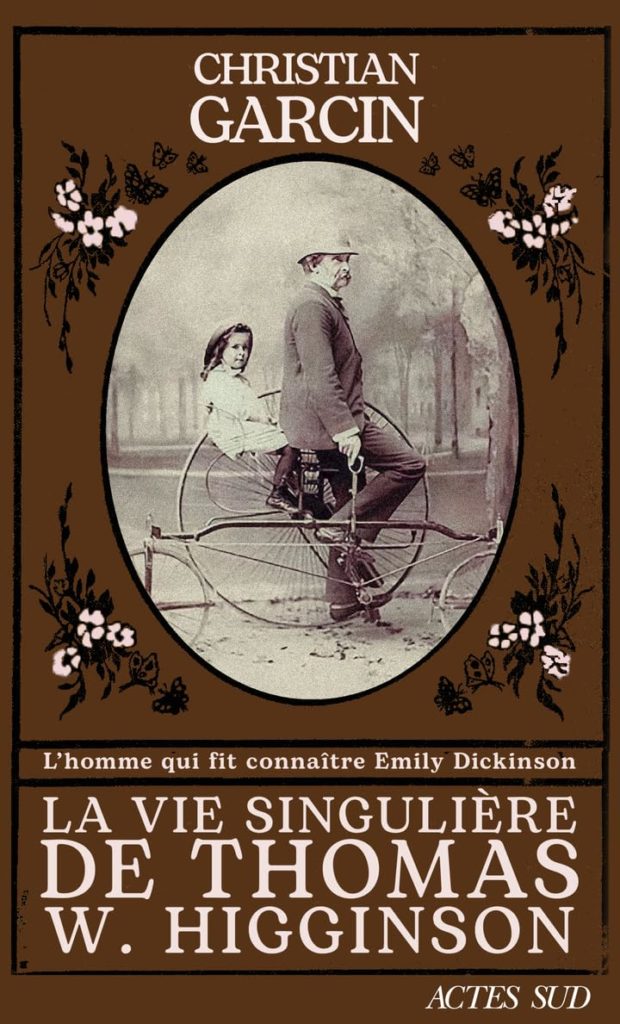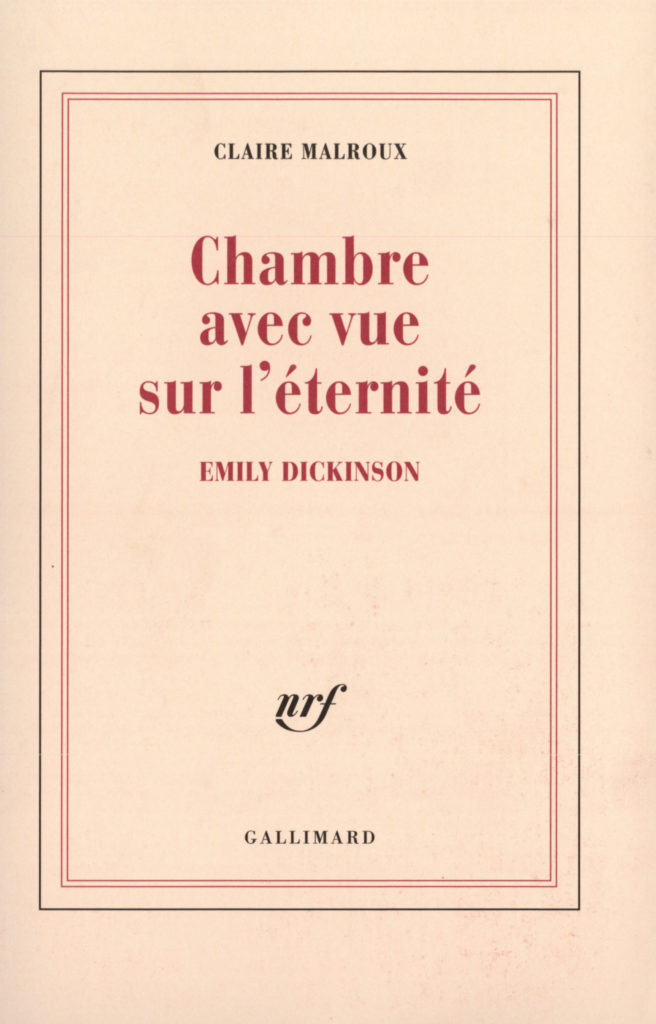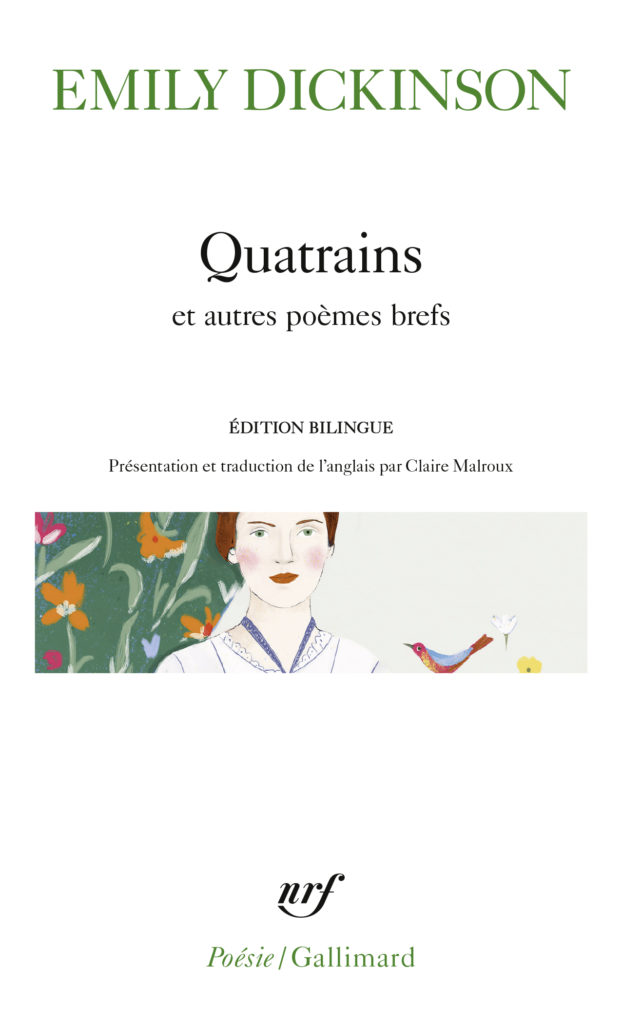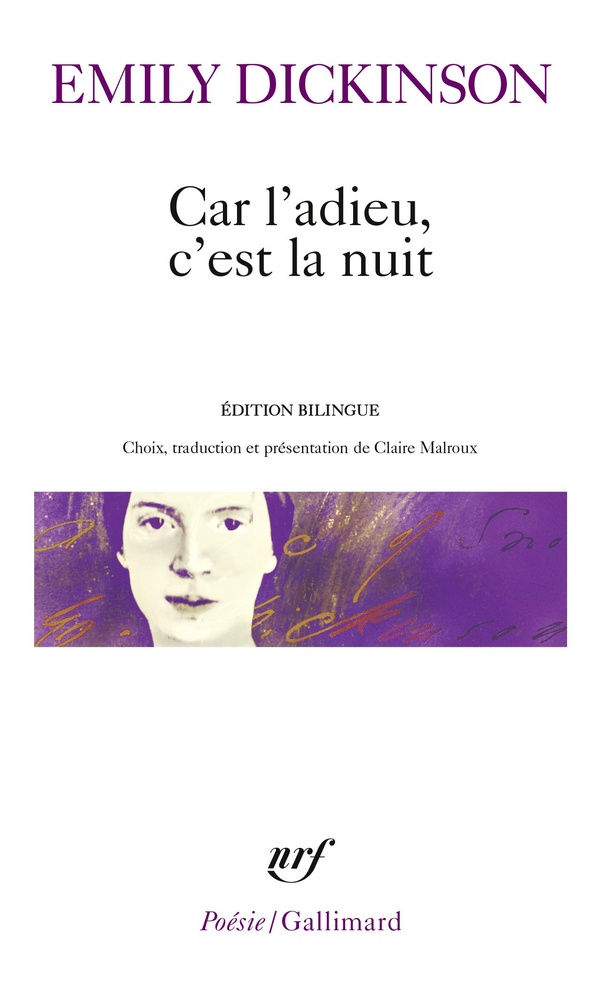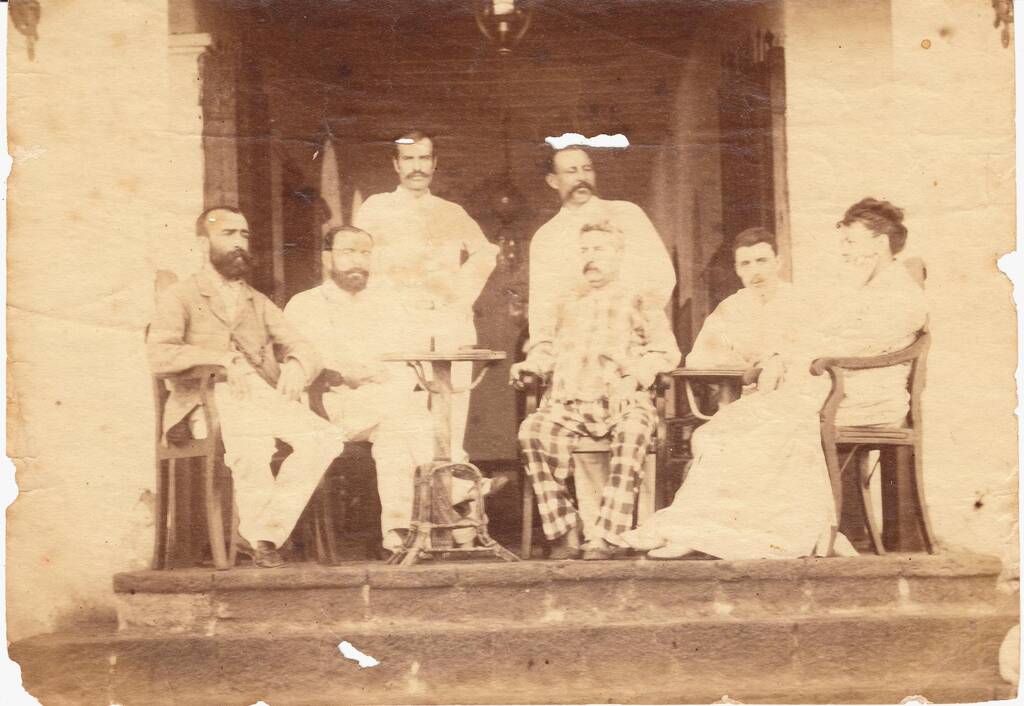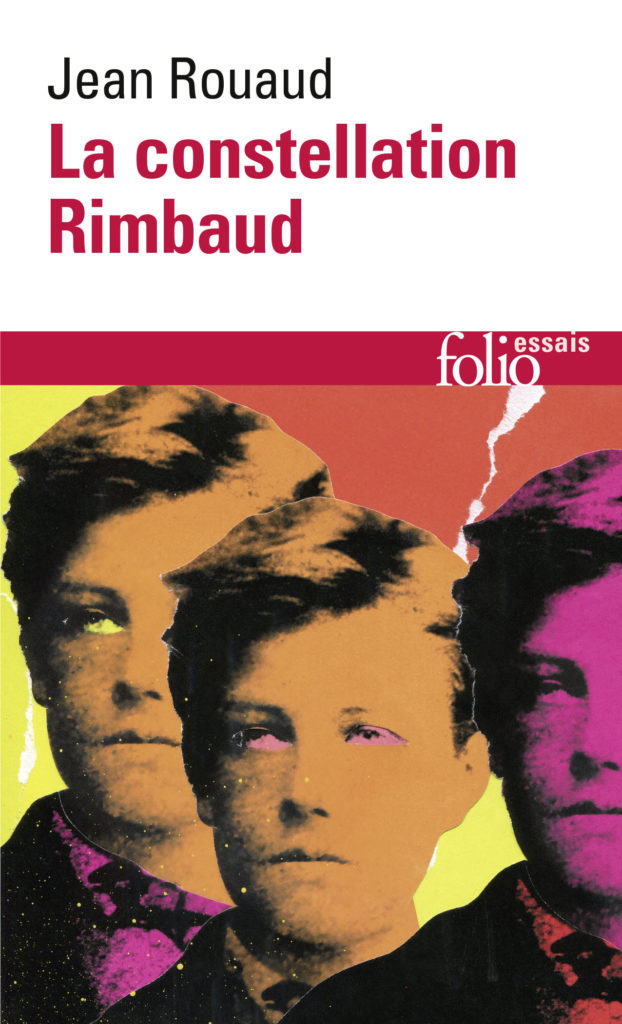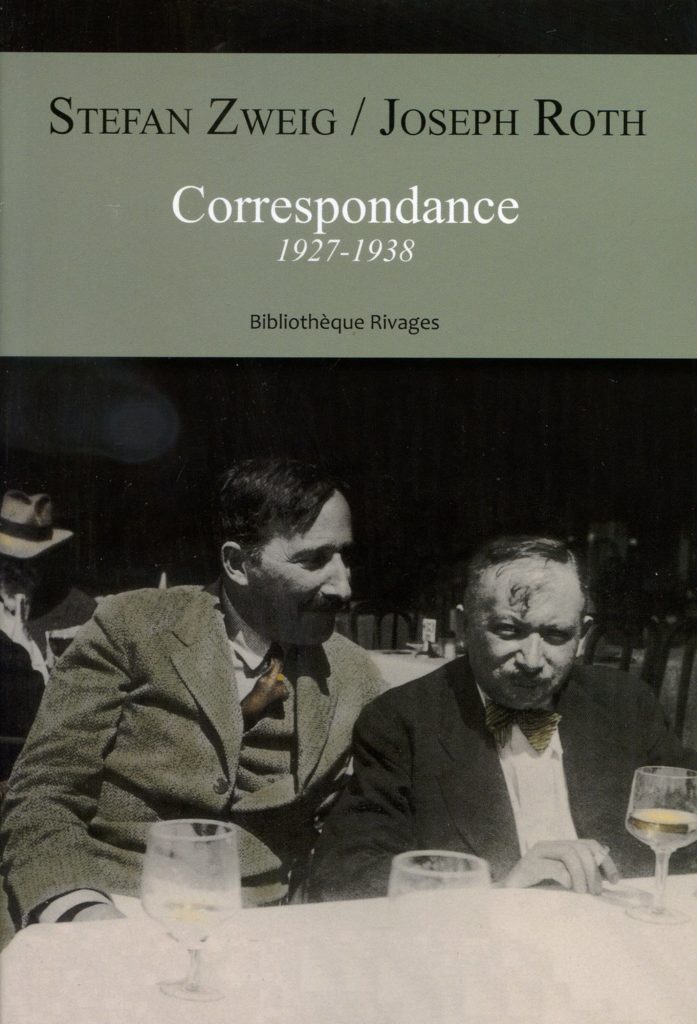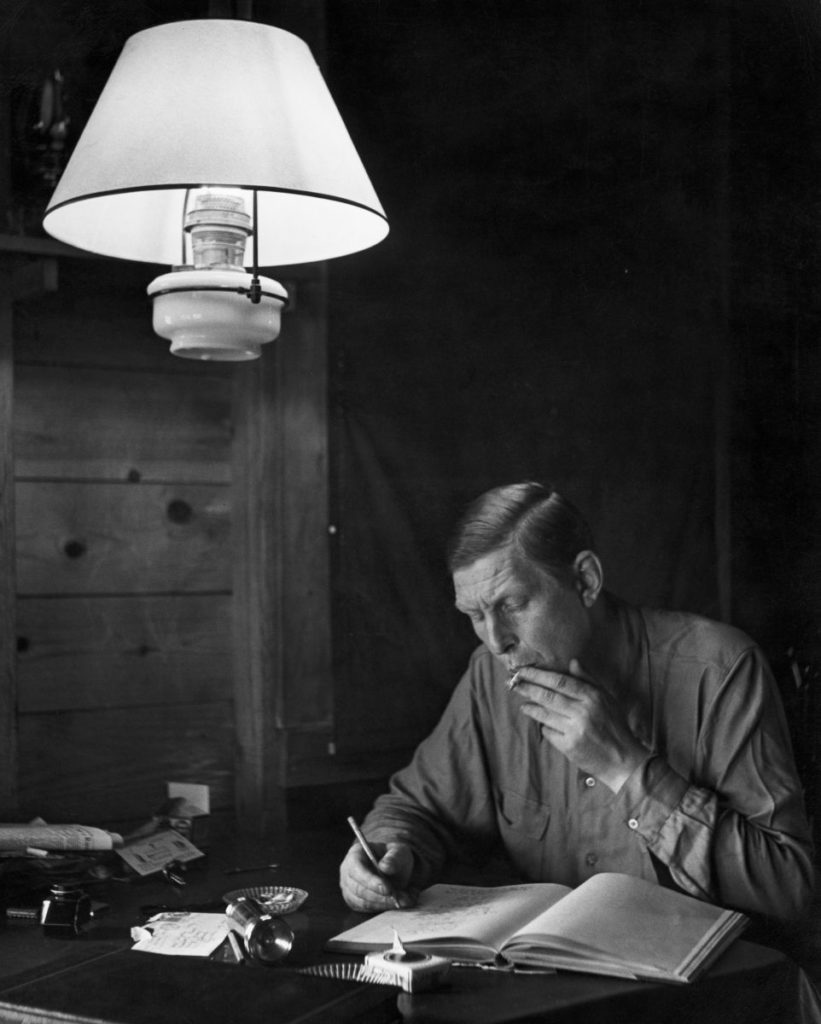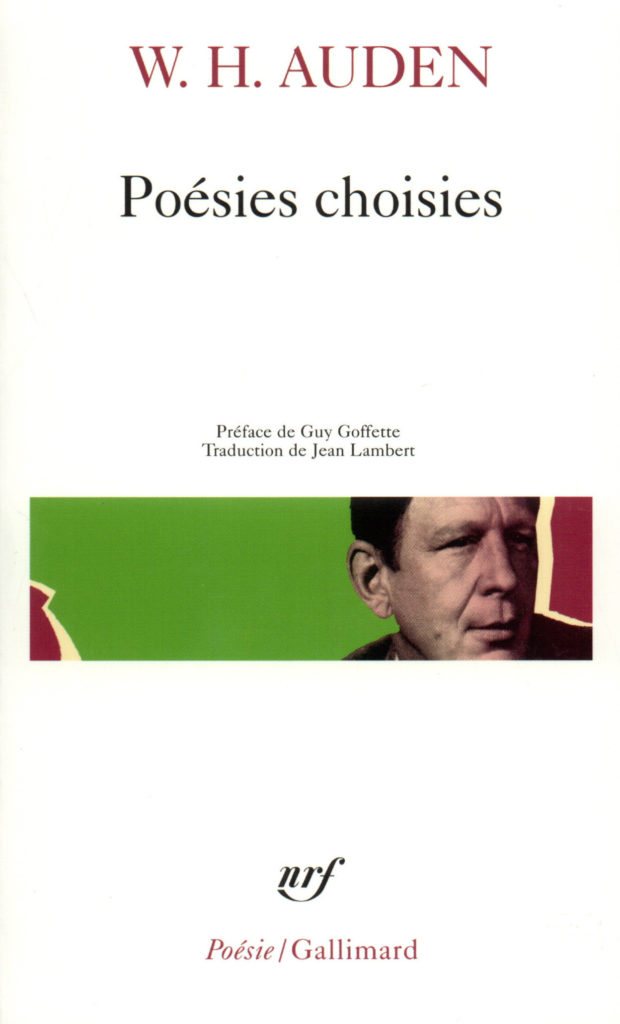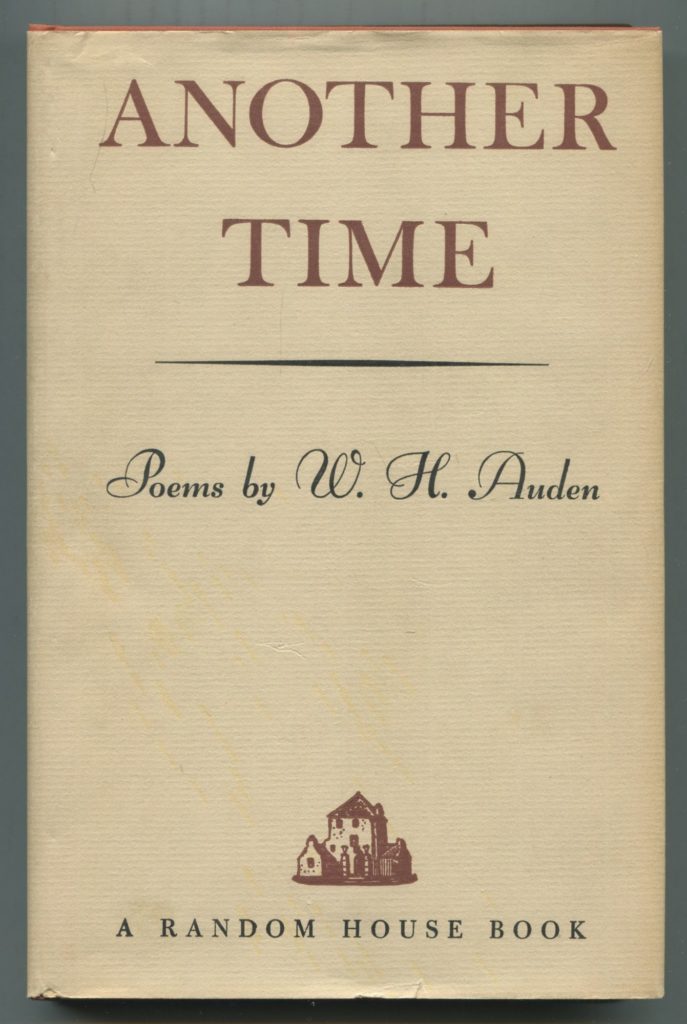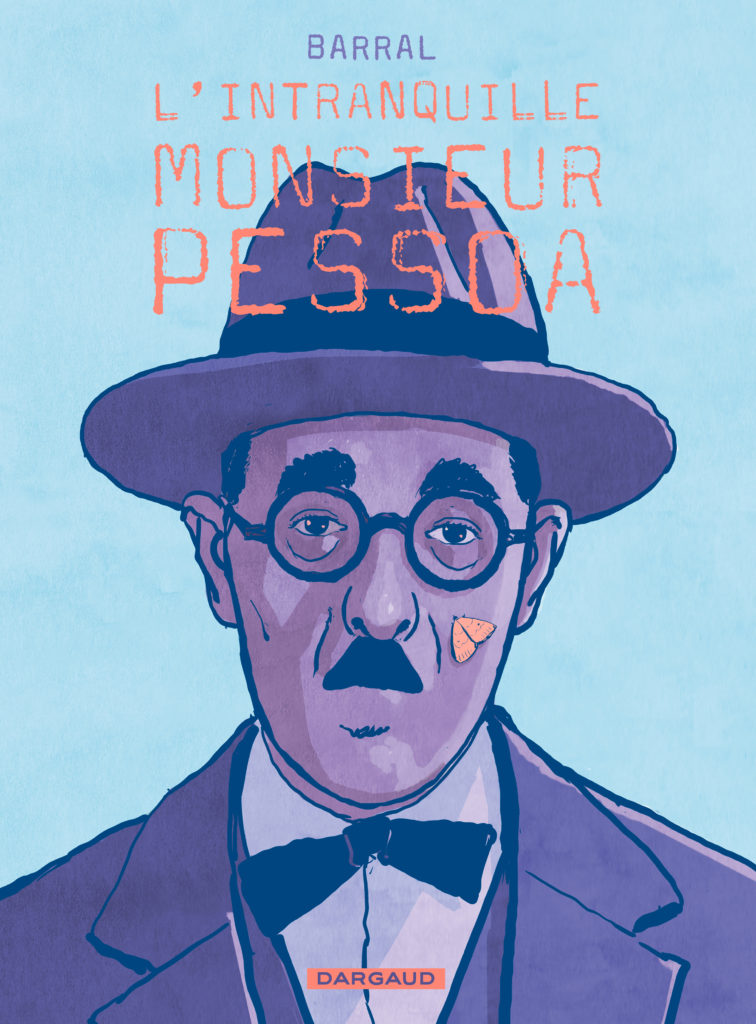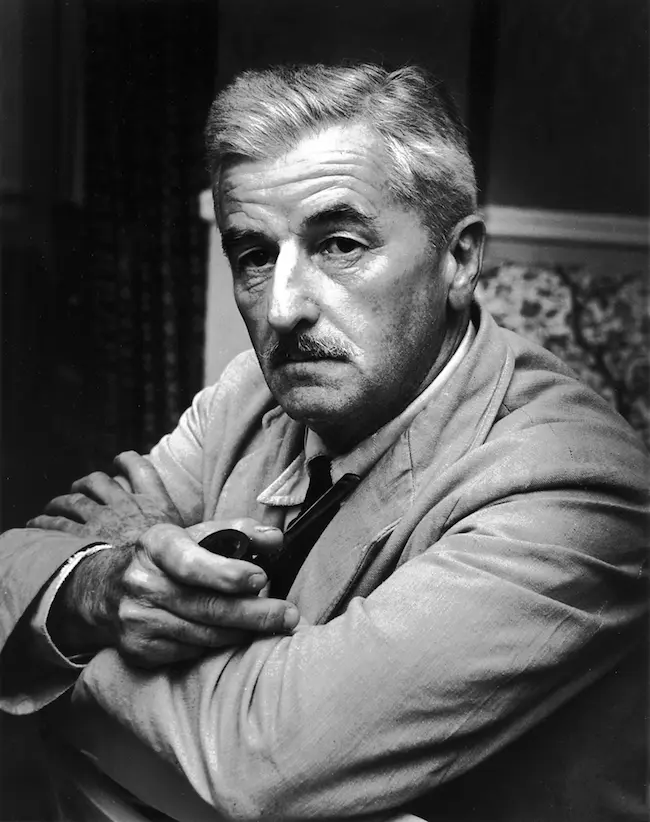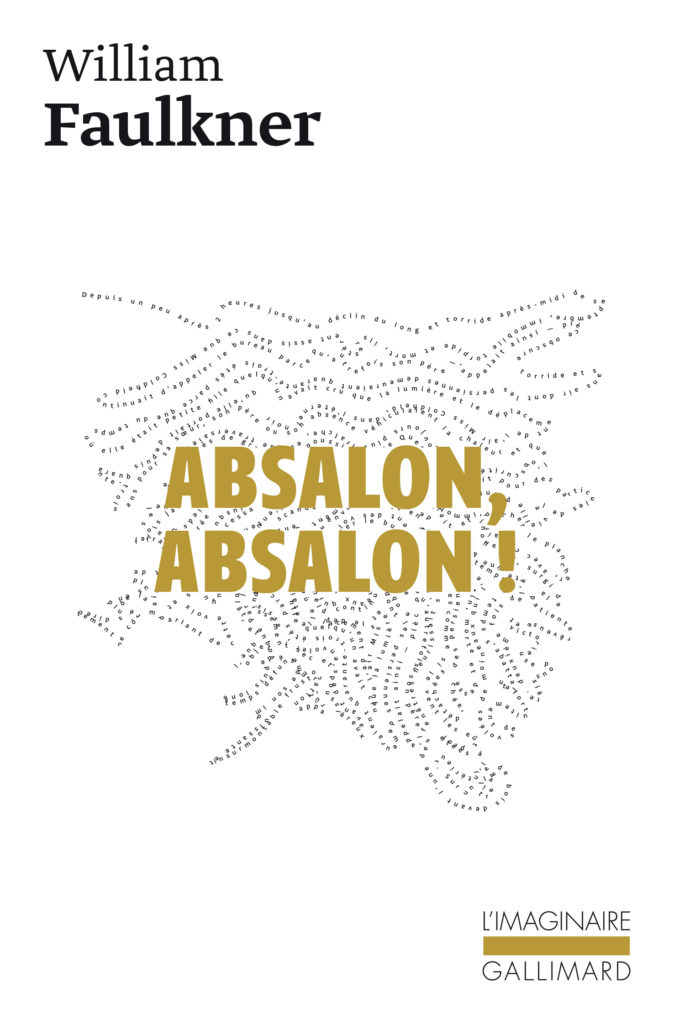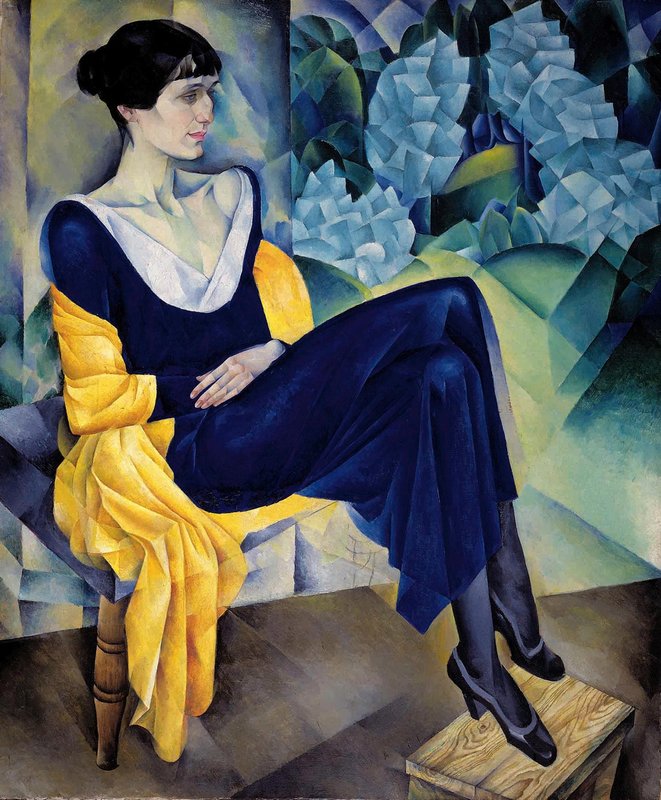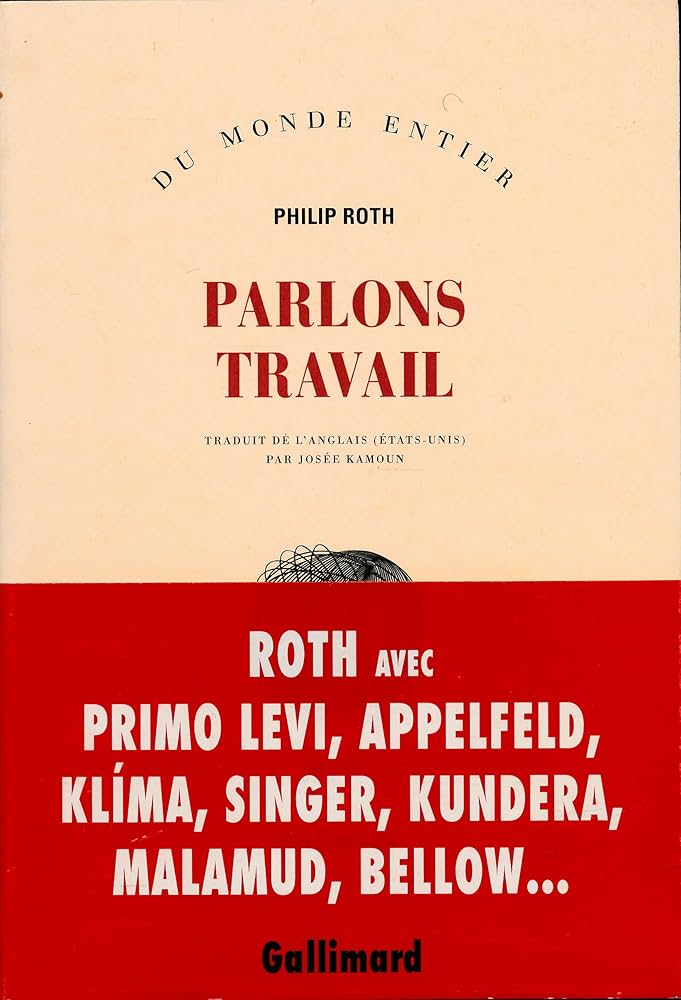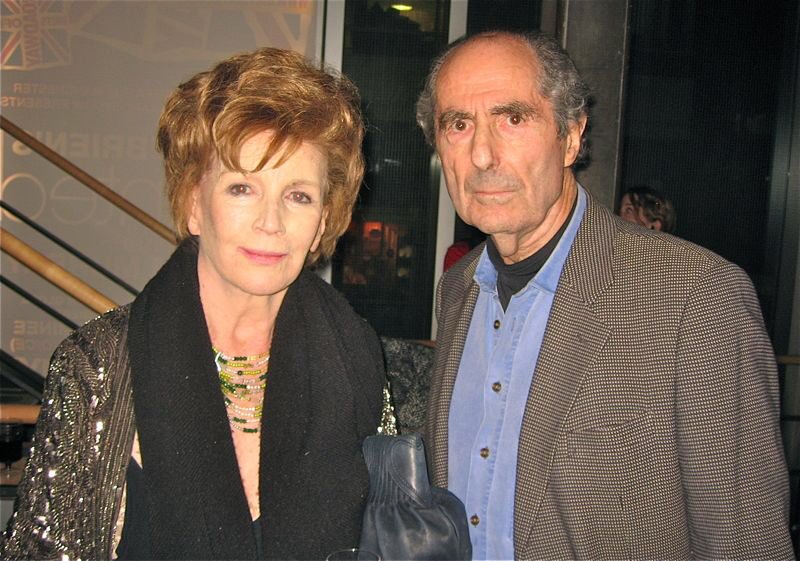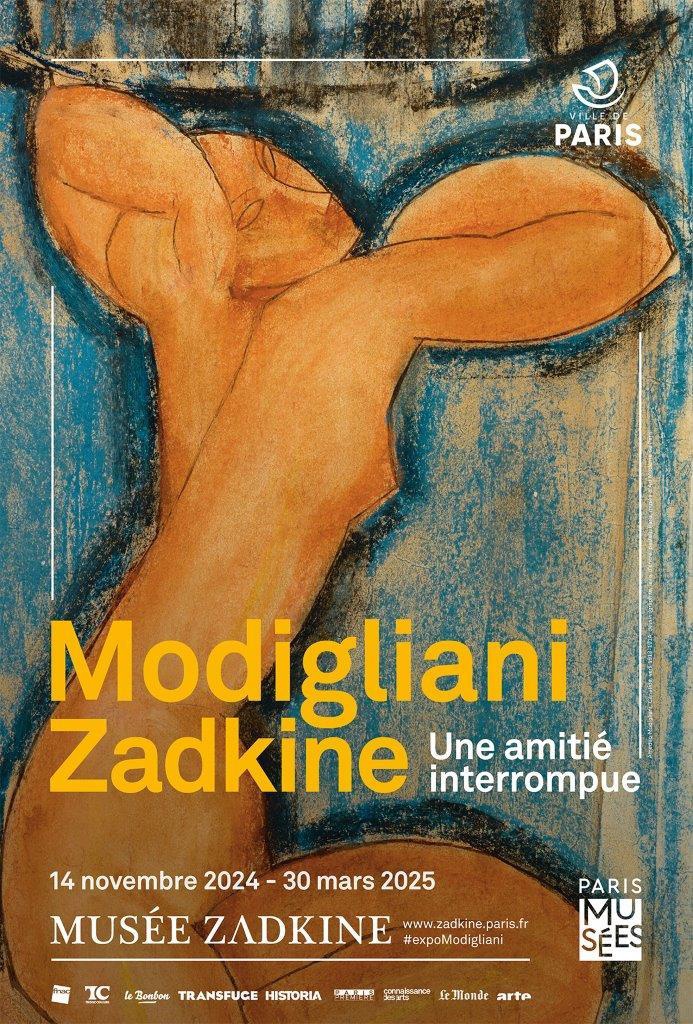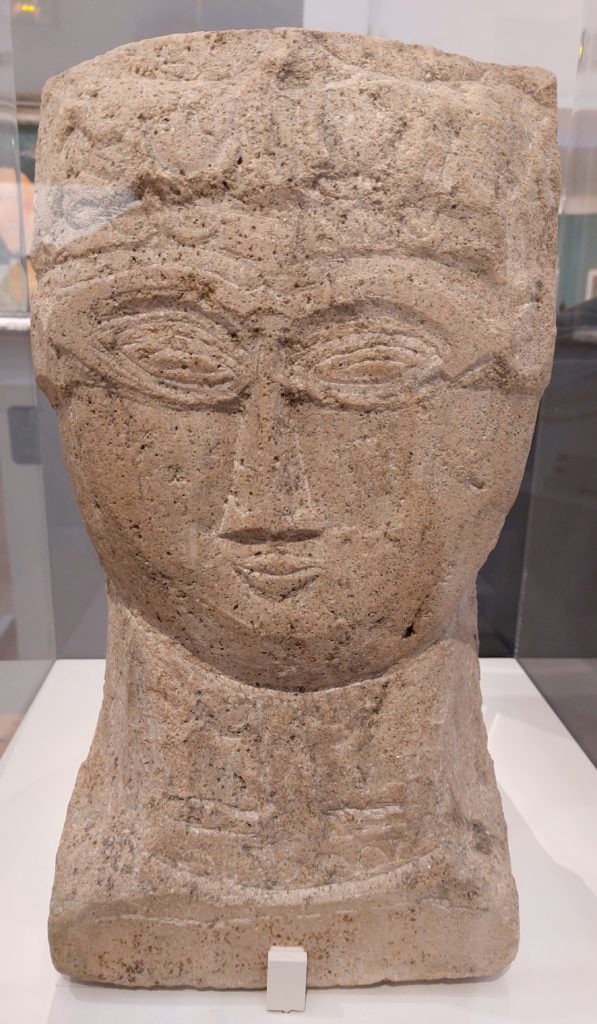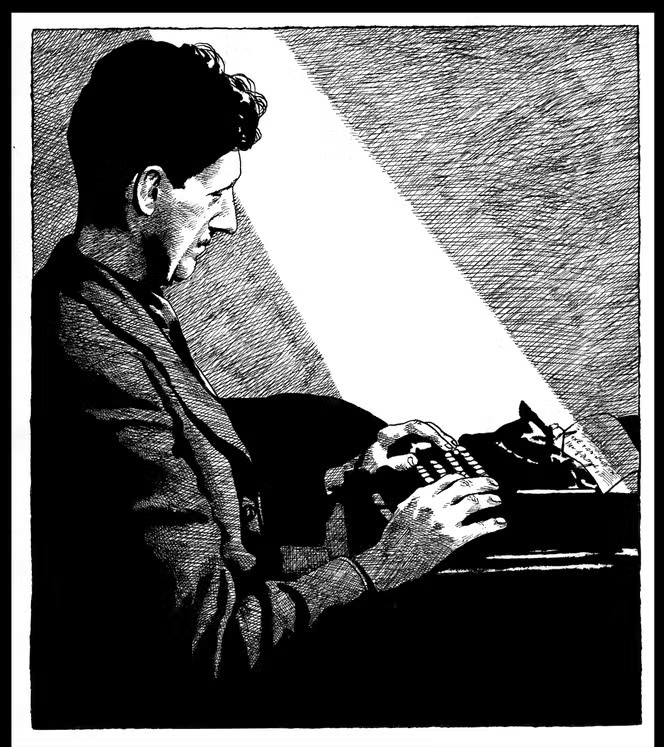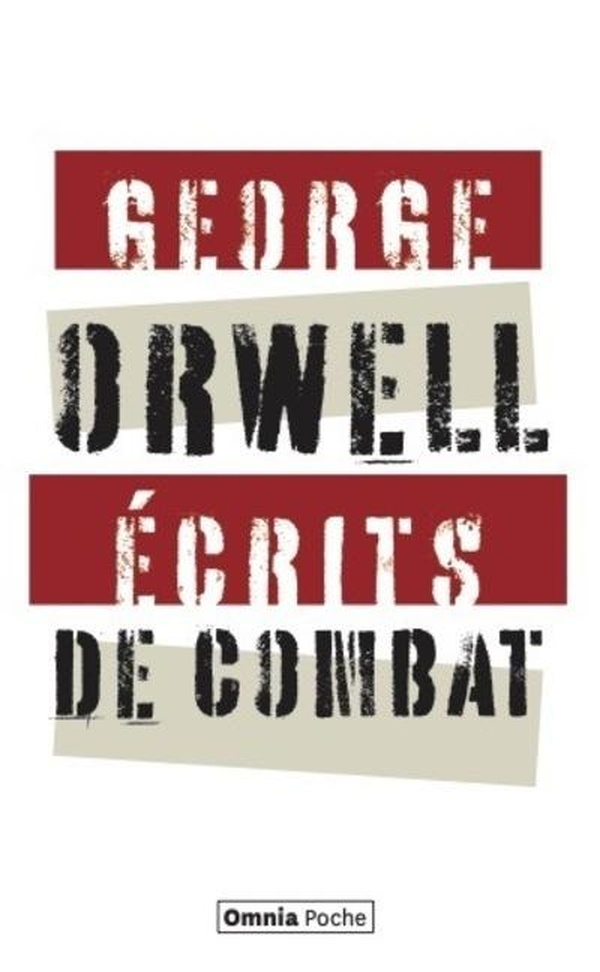656
I started Early – Took my Dog –
And visited the Sea –
The Mermaids in the Basement
Came out to look at me –
And Frigates – in the Upper Floor
Extended Hempen Hands –
Presuming Me to be a Mouse –
Aground – opon the Sands –
But no Man moved Me – till the Tide
Went past my simple Shoe –
And past my Apron – and my Belt
And past my Boddice – too –
And made as He would eat me up –
As wholly as a Dew
Opon a Dandelion’s Sleeve –
And then – I started – too –
And He – He followed – close behind –
I felt His Silver Heel
Opon my Ancle – Then My Shoes
Would overflow with Pearl –
Until We met the Solid Town –
No One He seemed to know –
And bowing – with a Mighty look –
At me – The Sea withdrew –
656
Je partis Tôt – Pris mon Chien –
Rendis visite à la Mer –
Les Sirènes du Sous-sol
Montèrent pour me voir –
Et les Frégates – à l’Étage
Tendirent des Mains de Chanvre –
Me prenant pour une Souris –
Échouée – sur les Sables –
Mais nul Homme ne Me héla – et le Flot
Dépassa ma Chaussure –
Puis mon Tablier – et ma Ceinture
Puis mon Corsage – aussi –
Il menaçait de m’avaler toute –
Comme la Rosée
Sur le Gilet d’un Pissenlit –
Alors – je courus moi aussi –
Et Lui – Il me serrait – de près –
Je sentis sur ma Cheville
Son Talon d’Argent – Mes Souliers allaient
Déborder de Perles –
Enfin ce fut la Cité Ferme –
Nul, semblait-il, qu’Il connût là –
Et m’adressant un Impérieux – salut –
L’Océan se retira –
Car l’adieu, c’est la nuit. Poésie / Gallimard n°435. 2007. Traduction Claire Malroux.
Claire Malroux, Chambre avec vue sur l’éternité Emily Dickinson. (Pages 66-67)
” Aucun poème ne donne une image aussi vivante d’Emily dans sa jeunesse, ni une idée aussi juste de son caractère à la fois intrépide et angoissé que celui qui débute par ces mots : ” Je partis Tôt – Avec mon Chien – “
Emily Dickinson avait un grand chien, appelé Carlo, offert par son père.
Elle écrivait à Thomas W. Higginson (1823-1911) à qui on doit la publication de l’oeuvre de la poétesse américaine, à titre posthume : ” Vous me demandez quels sont mes Compagnons : les Collines – Monsieur – et le Couchant – et un Chien – aussi grand que moi – que mon père m’a acheté. – Ils valent mieux que des Êtres – parce qu’ils savent – mais sont muets. ” (25 avril 1862)
Christian Garcin vient de publier chez Actes Sud un récit biographique La Vie singulière de Thomas Higginson.
” Pasteur, militant abolitionniste, soutien de Lincoln, colonel dans l’armée de l’union, féministe avant l’heure, écrivain proche de Threau, d’Emerson et de Jack London, Thomas W. Higginson (1823-1911) a fréquenté les personnages les plus importants de la construction houleuse et tragique de l’Amérique. Pourtant, personne ne se souvient de lui aujourd’hui. Sauf, peut-être, les plus ardents admirateurs d’Emily Dickinson. ” (Quatrième de couverture)