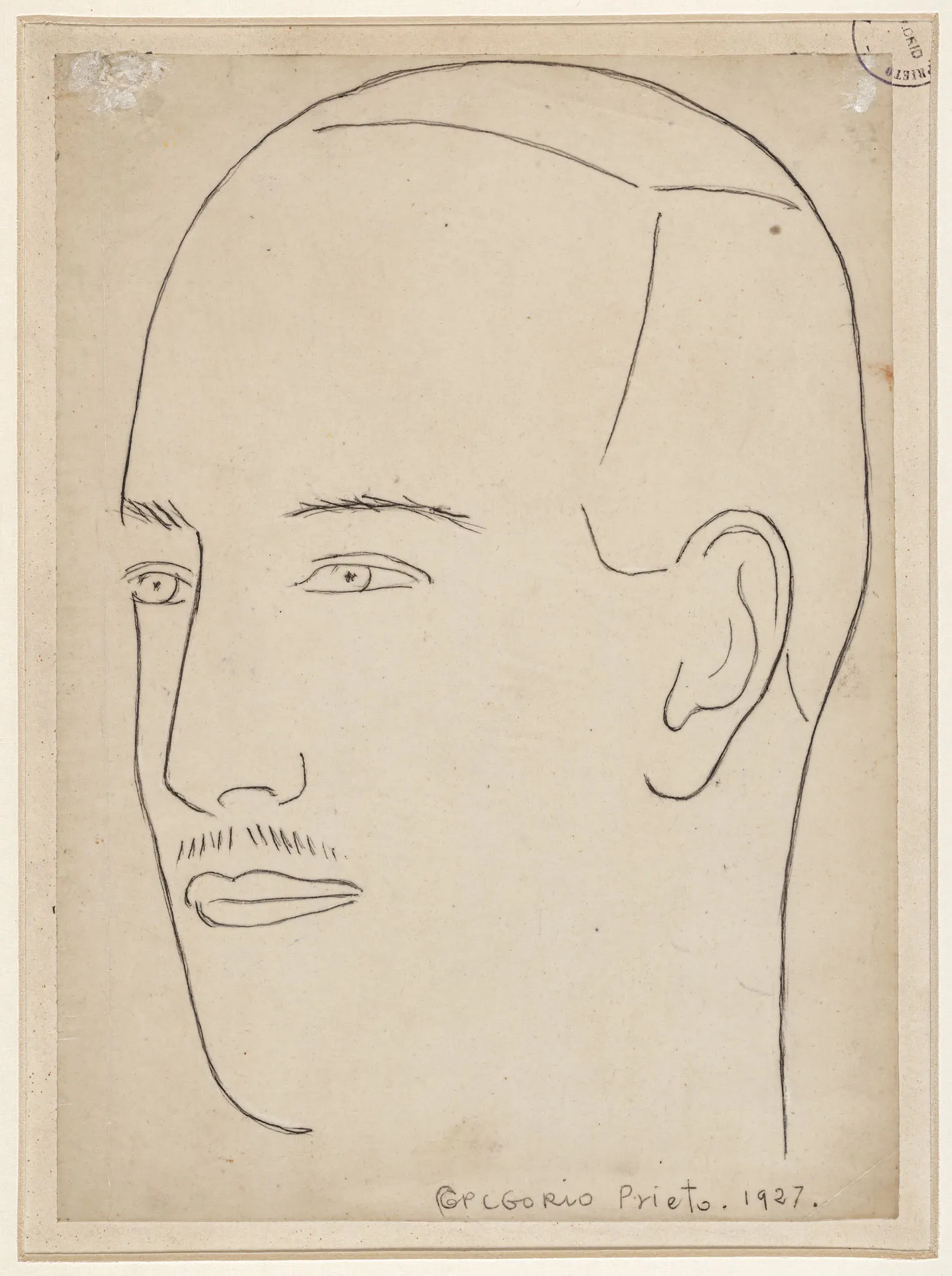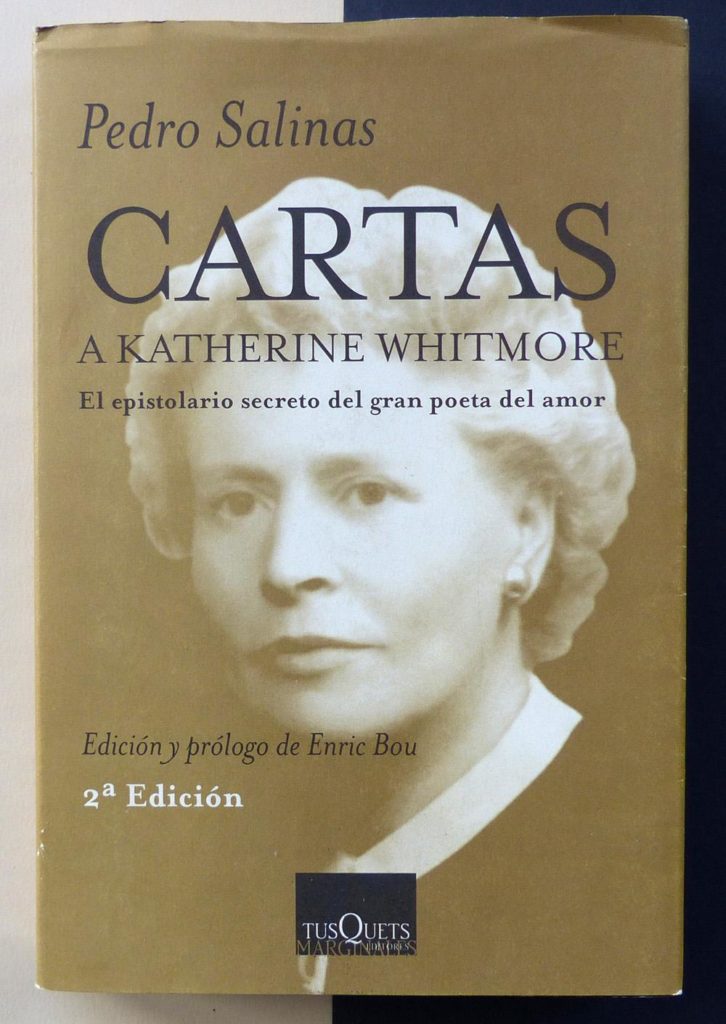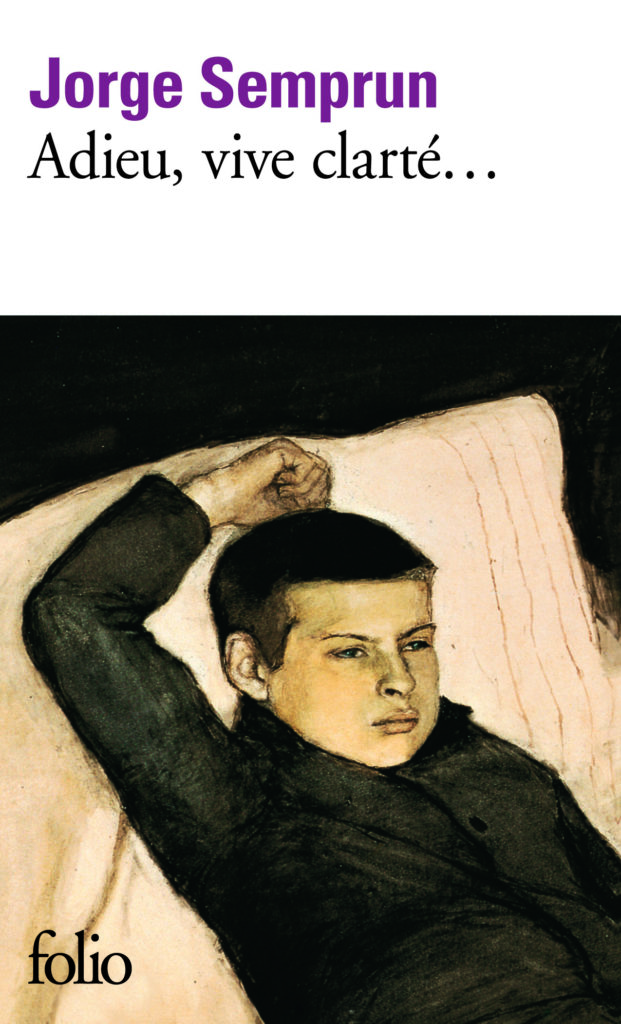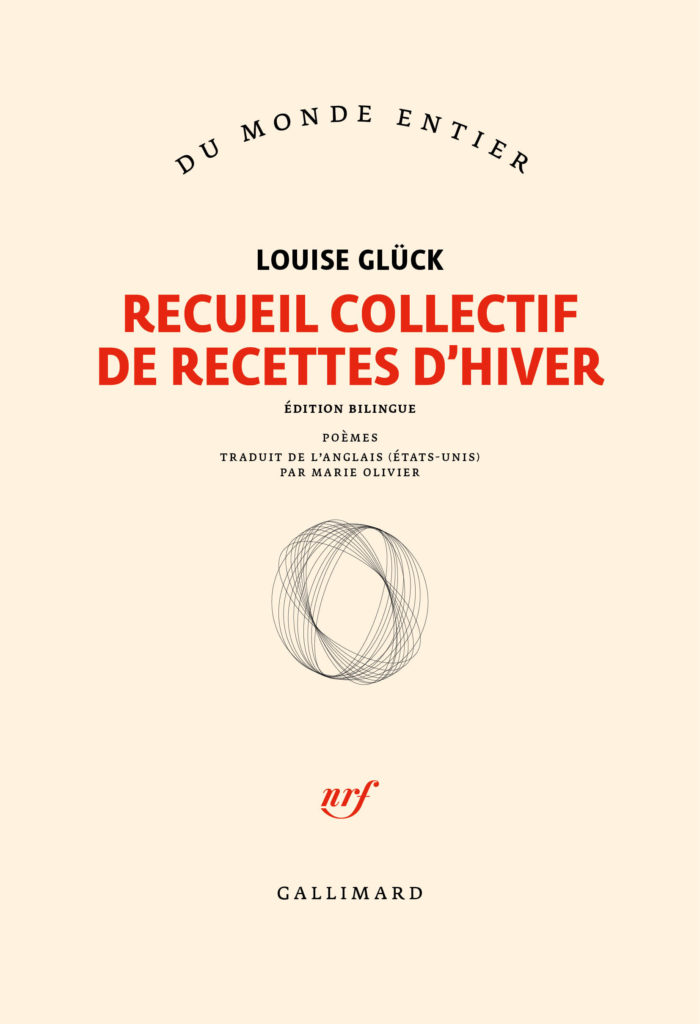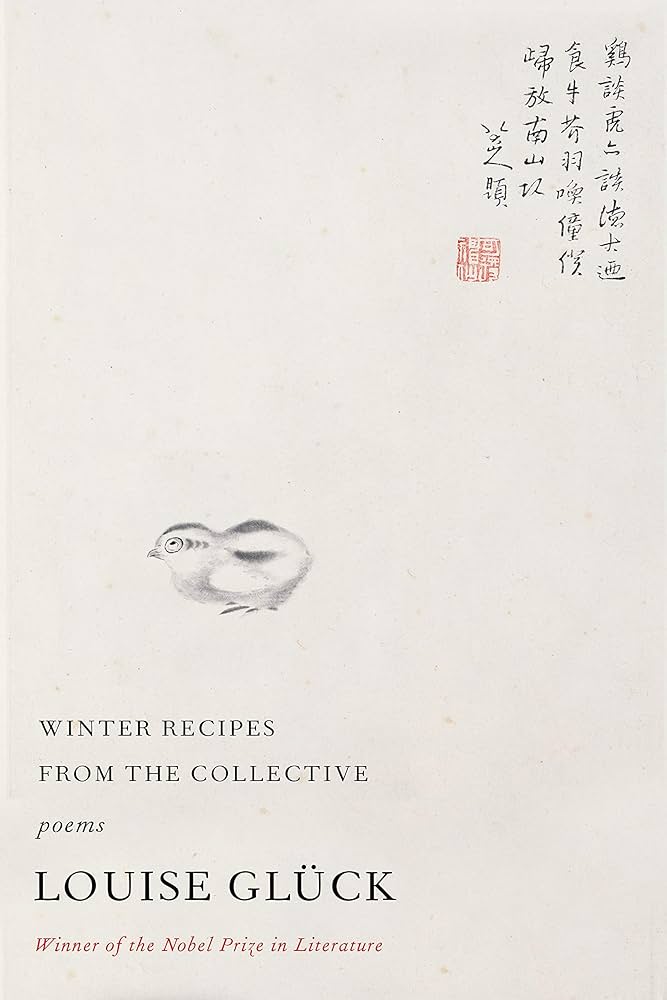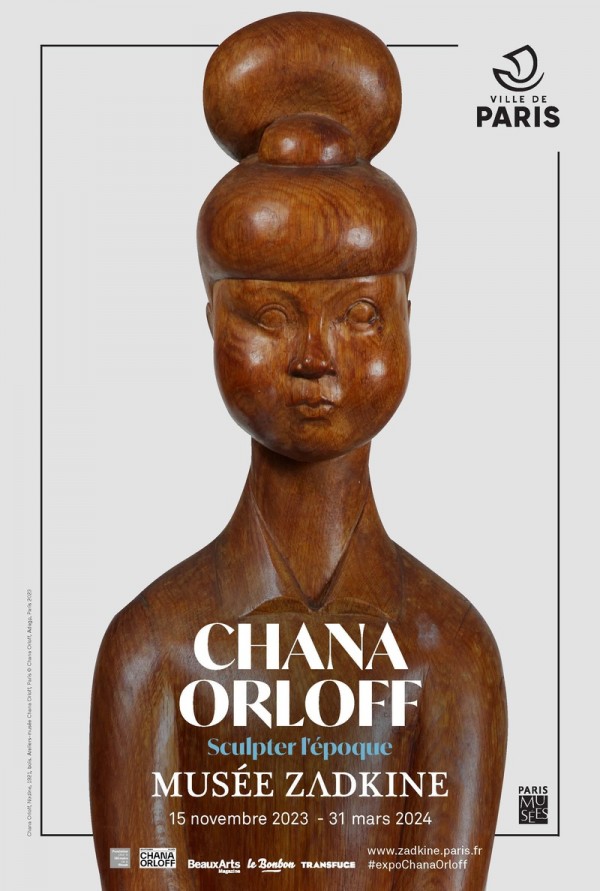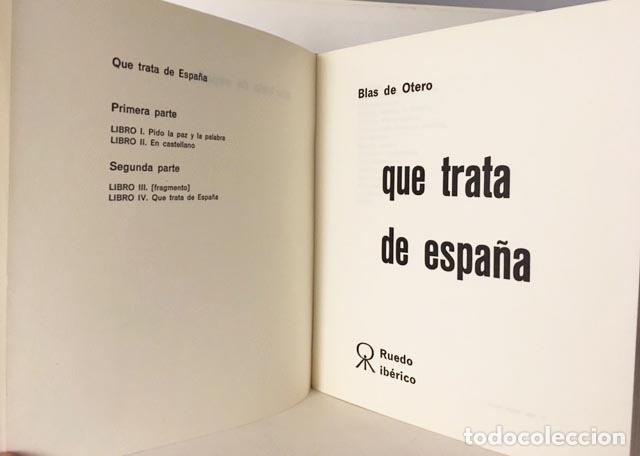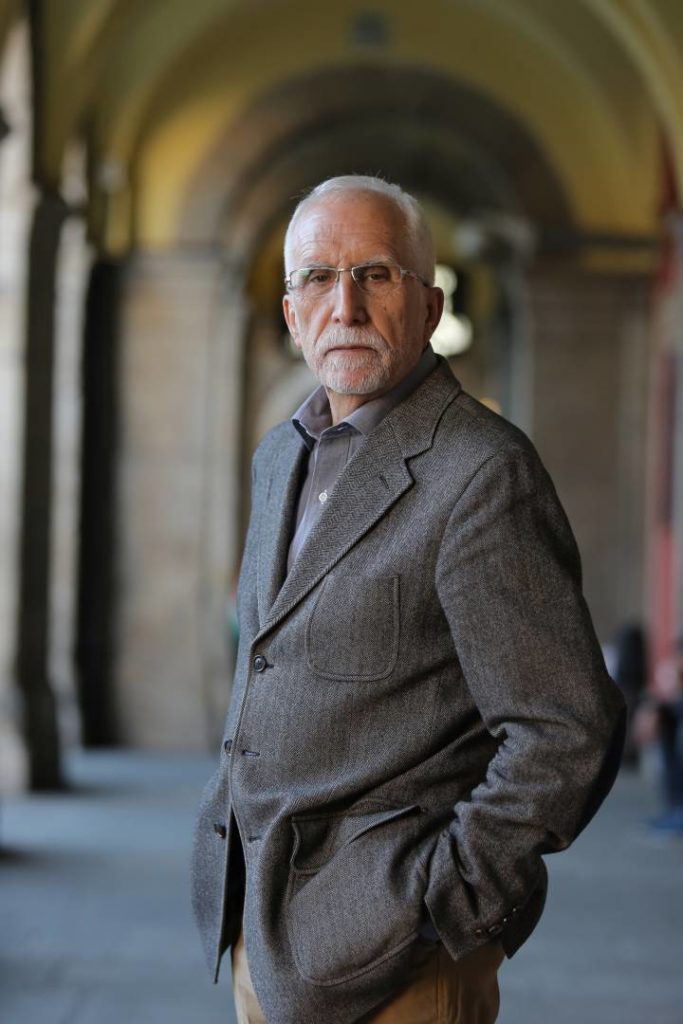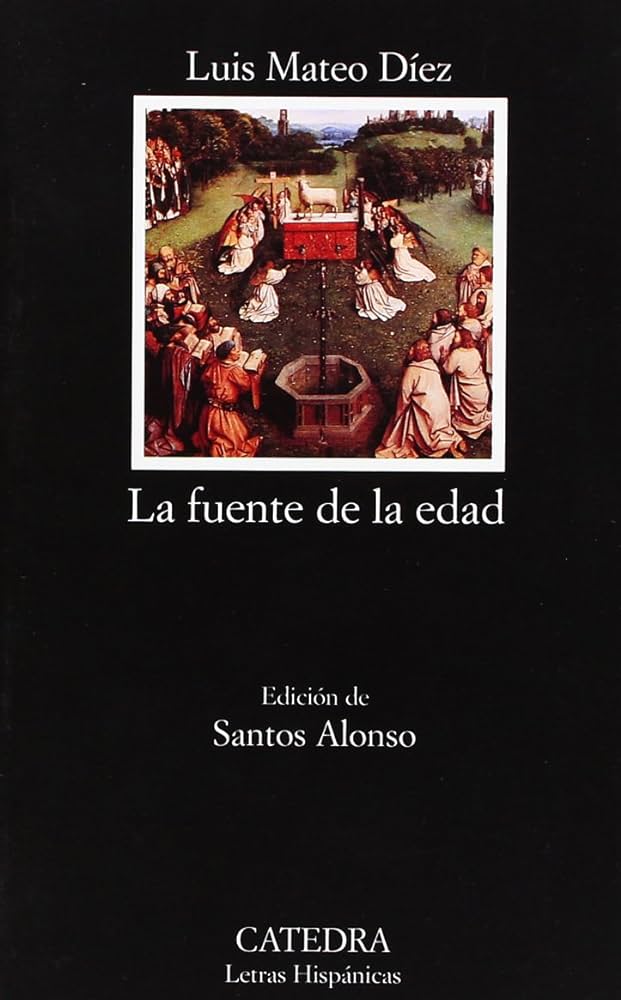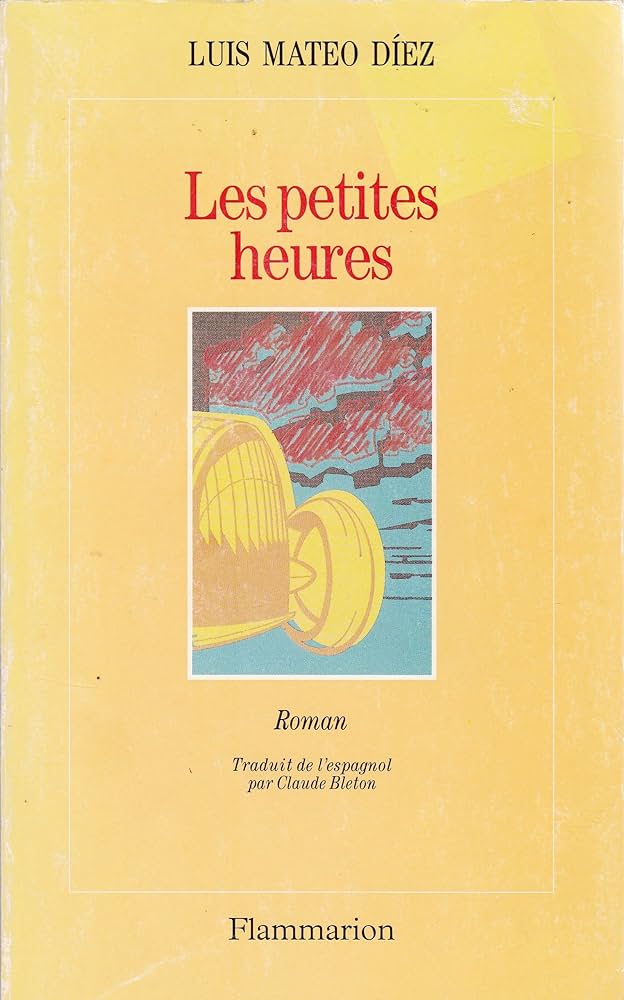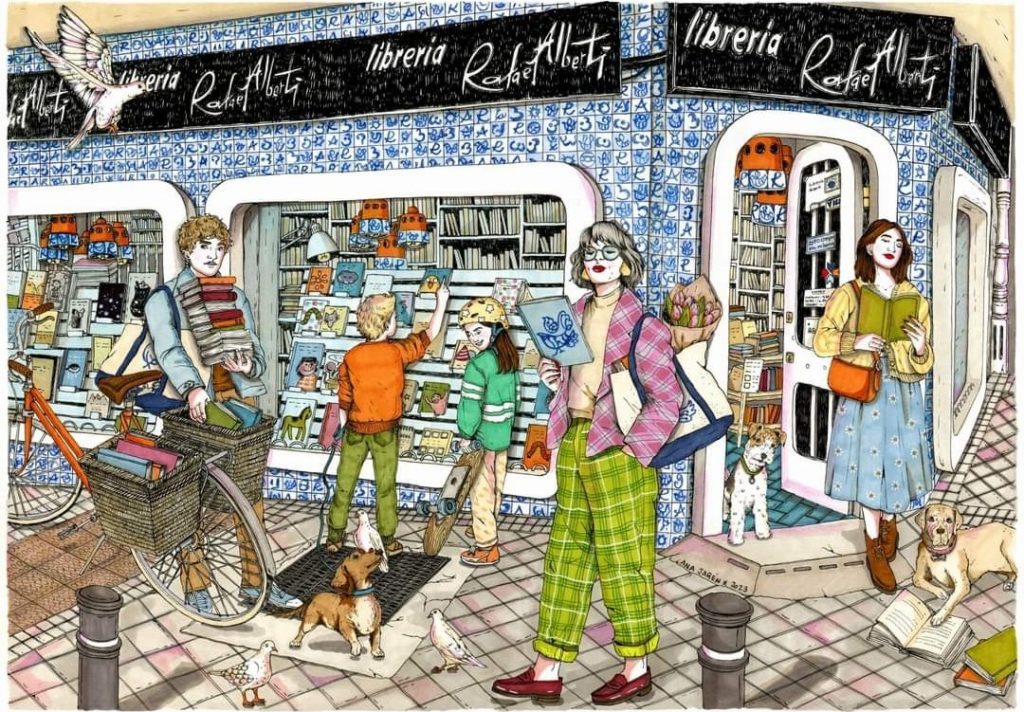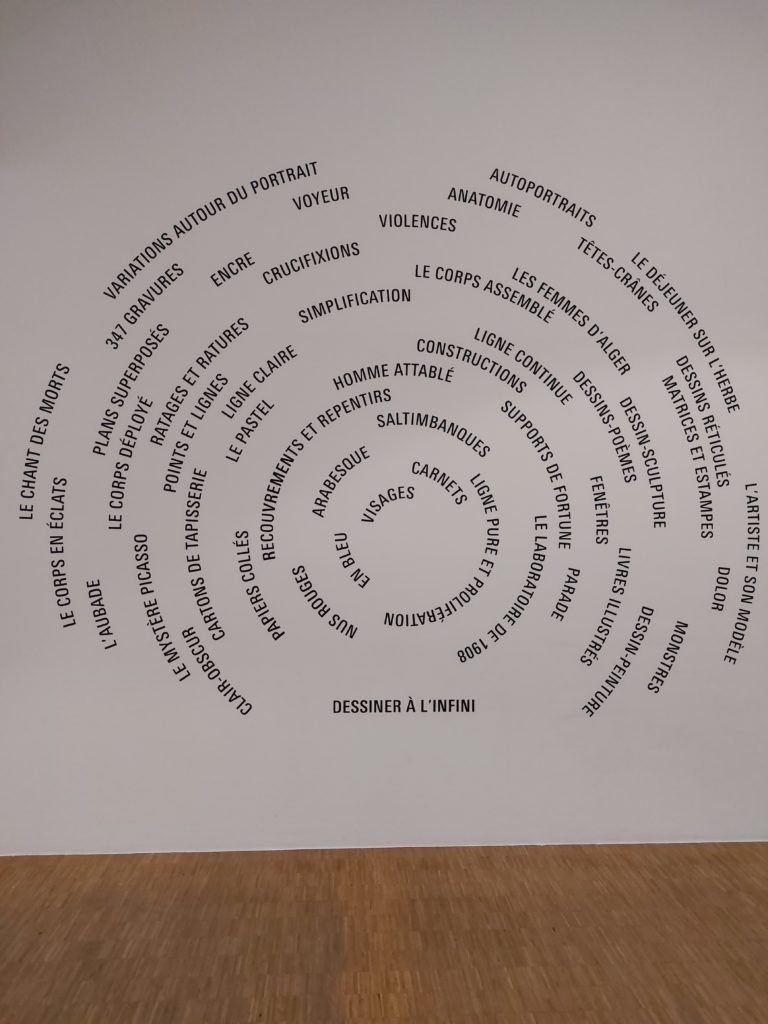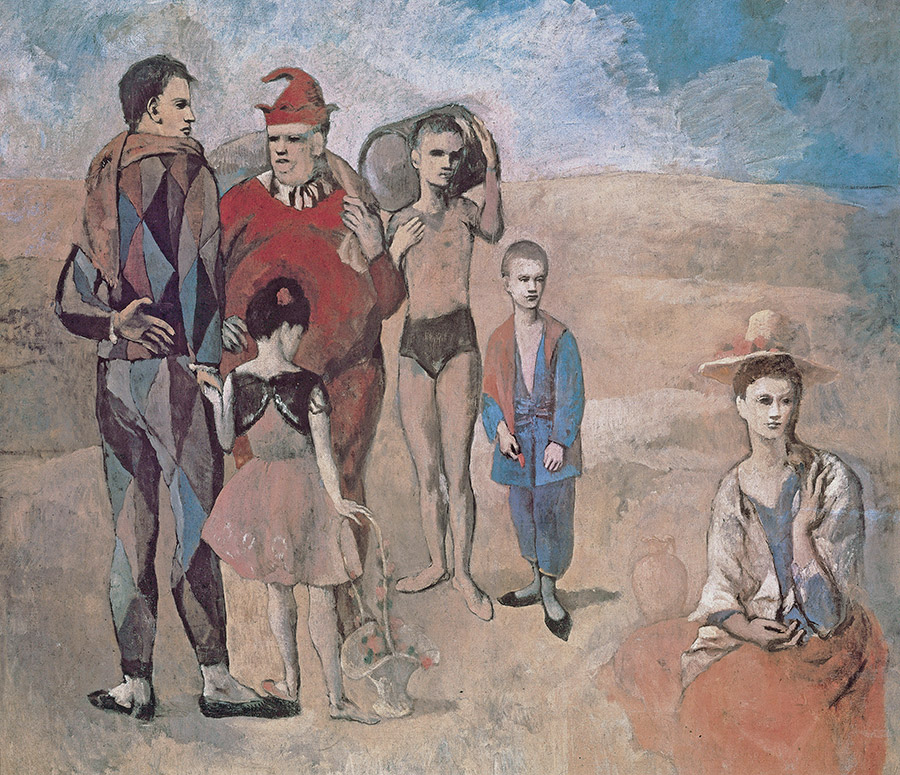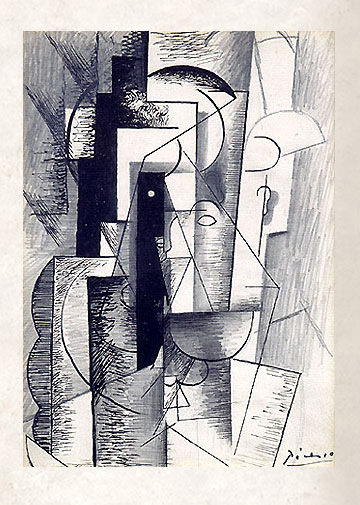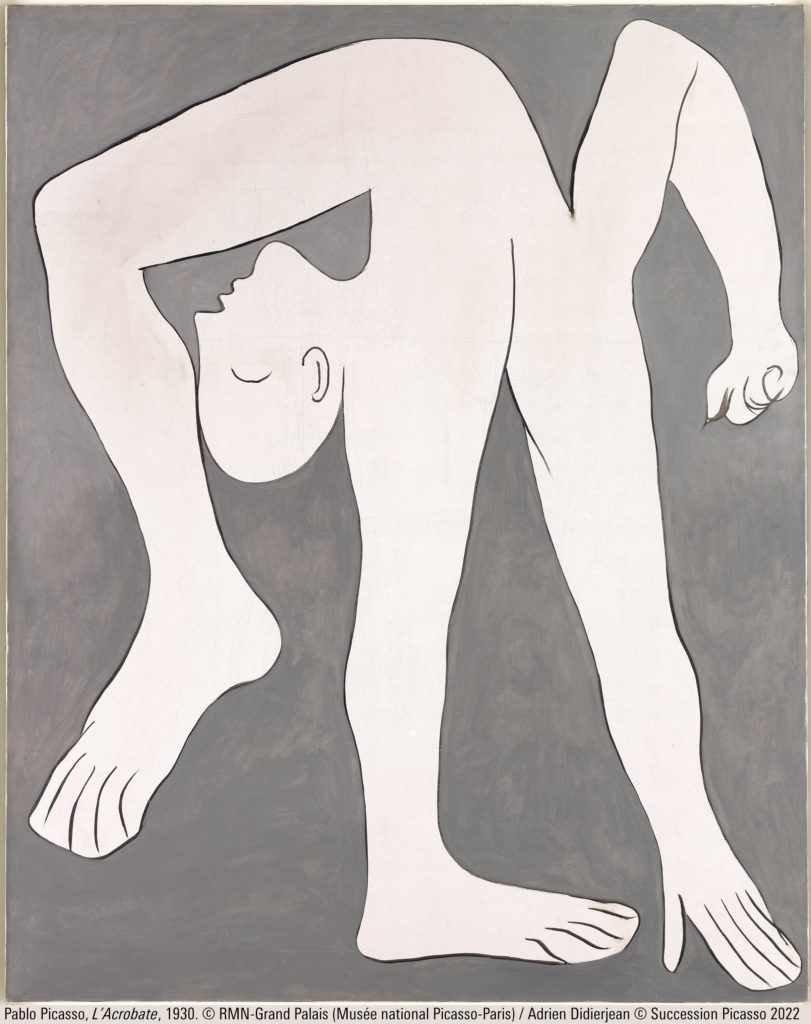Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, connu sous le nom de Gustavo Adolfo Bécquer, vient d’une famille de peintres d’origine flamande installée à Séville au XVII ème siècle. Orphelin à onze ans, il eut une vie marquée par la maladie, les déceptions et la pauvreté. Il découvre dans sa jeunesse la poésie dans la bibliothèque de sa marraine. Il fréquente les ateliers de peinture de sa ville où son père José María Domínguez Bécquer (1805-1841) est connu. Son frère, Valeriano Domínguez Bécquer (1833-1870), dont il sera très proche, est aussi peintre. Il arrive à Madrid en 1854 et connaît la misère jusqu’en 1860. C’est à cette période qu’il écrit la plupart des poèmes qui composeront Rimas. En 1861, il se marie et devient journaliste. Il est censeur de romans de 1865 à 1868 et mène alors une vie plus confortable. Son frère Valeriano meurt le 23 septembre 1870. Gustavo Adolfo disparaît le 22 décembre 1870. Il est considéré comme le précurseur de la poésie espagnole contemporaine. Ses oeuvres sont publiées par ses amis en deux tomes après sa mort au cours de l’été 1871. Le recueil Rimas est constitué de 86 poèmes. Il est marqué par la poésie andalouse, les chants populaires, le romantisme (Heine, Hugo, Espronceda, Zorrilla). On retrouve des échos de sa poésie chez Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez et chez les poètes de la génération de 1927, particulièrement chez Luis Cernuda.

I
Yo sé un himno gigante y extraño
que anuncia en la noche del alma una aurora,
y estas páginas son de este himno
cadencias que el aire dilata en la sombras.
Yo quisiera escribirlo, del hombre
domando el rebelde, mezquino idioma,
con palabras que fuesen a un tiempo
suspiros y risas, colores y notas.
Pero en vano es luchar; que no hay cifra
capaz de encerrarle, y apenas ¡oh hermosa!
si teniendo en mis manos las tuyas
pudiera, al oído, cantártelo a solas.
Rimas.
I
Je sais un hymne géant et étrange
Qui annonce dans la nuit de l’âme une aurore,
Et ces pages sont de cet hymne
Cadences que l’air dilate dans les ombres.
Je voudrais l’écrire, de l’homme
Domptant le rebelle et mesquin langage,
Avec des paroles qui fussent en un seul temps
Soupirs et ris, couleurs et notes.
Mais c’est en vain lutter ; point de chiffre
Capable de l’enserrer et c’est à peine – oh belle ! –
Si, ayant dans mes mains les tiennes,
Je pourrais, à l’oreille, te le chanter dans notre solitude.
Anthologie bilingue de la poésie espagnole. Bibliothèque de la Pléiade. NRF. 1995. Traduction Robert Pingeard.
Paco Ibáñez a chanté les poèmes de Bécquer.
https://www.youtube.com/watch?v=vfdhl-7-lQU
LIII
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y, otra vez, con el ala a sus cristales
jugando llamarán;
pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha al contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nombres…
ésas… ¡no volverán!
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde, aun más hermosas,
sus flores se abrirán;
pero aquéllas, cuajadas de rocío,
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer, como lágrimas del día…
ésas… ¡no volverán!
Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón, de su profundo sueño
tal vez despertará;
pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido…, desengáñate:
¡así no te querrán!
Rimas.
LIII
Les noires hirondelles reviendront
Suspendre à ta fenêtre leurs doux nids
Et de nouveau, de l’aile, dans leurs jeux,
Frapperont à ta vitre.
Mais celles qui volaient plus doucement
Pour mieux voir ta beauté et mon bonheur,
Celles qui surent ton nom et le mien,
Non, ne reviendront plus.
Le chèvrefeuille en touffes reviendra
Escalader les murs de ton jardin
Et de nouveau, le soir, encor plus belles,
Les fleurs en écloront.
Mais celles dont nous regardions les gouttes
De la rosée qui les comblait trembler
Et s’écouler comme larmes du jour,
Non, ne reviendront plus.
Les accents de l’amour, à tes oreilles,
Reviendront faire leur ardent murmure ;
De son profond sommeil ton cœur peut-être,
Ton cœur s’éveillera.
Mais, en suspens, muet, agenouillé,
Comme on adore Dieu devant l’autel,
Comme je t’ai aimée, détrompe-toi,
On ne t’aimera plus.
Anthologie de la poésie espagnole, Stock, 1957. Traduction Mathilde Pomès.
LX
Mi vida es un erial,
flor que toco se deshoja;
que en mi camino fatal
alguien va sembrando el mal
para que yo lo recoja.
Rimas.
LX
Ma vie est un désert ;
fleur que je touche est fleur qui meurt.
Sur mon chemin fatal,
quelqu’un sème le mal
pour que je le recueille.

Merci à Gio Bonzon de m’avoir rappelé “Mi vida es un erial”,