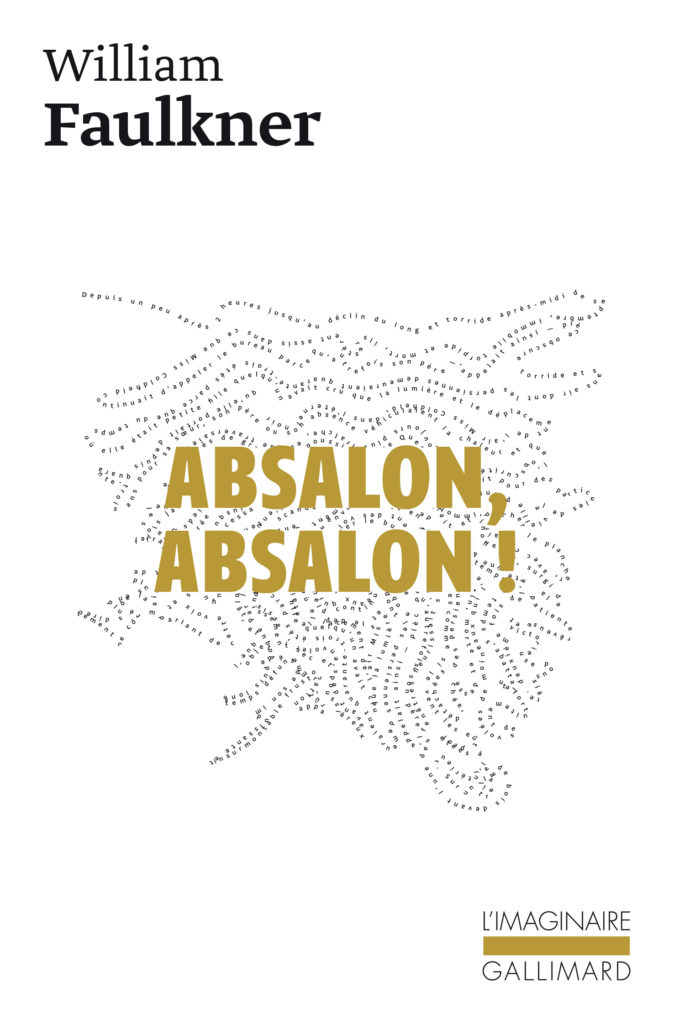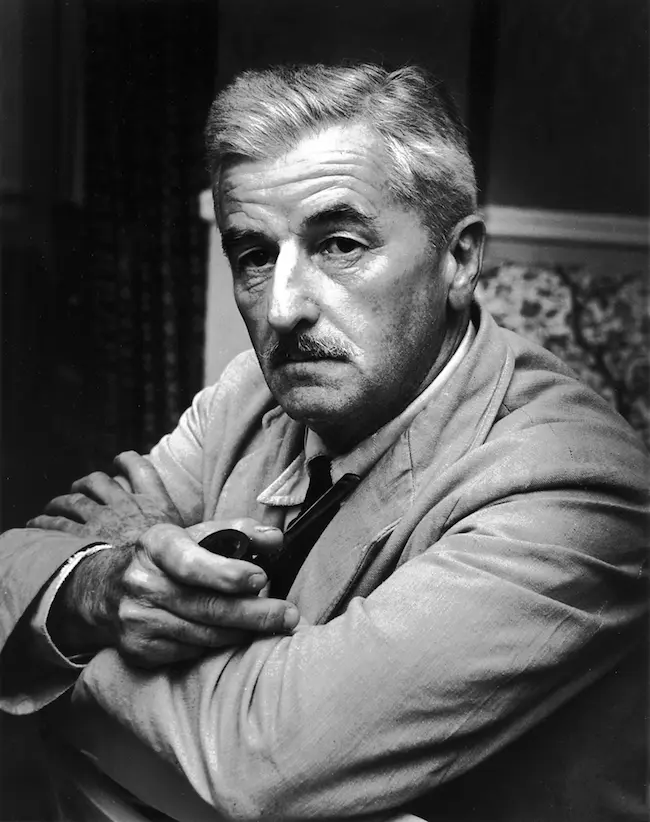
Je viens de terminer la relecture d’Absalon, Absalon ! de William Faulkner. Le bruit et la fureur (1928) et Absalon Absalon ! (1936) sont le plus souvent cités comme les deux plus grands romans du grand auteur américain. Le processus de la création littéraire et l’histoire du Sud des États-Unis sont au centre de ce livre. Le bruit et la fureur, écrit entre mars et septembre 1928, était son roman favori. ” Avec Le bruit et la fureur, j’appris à lire et à cesser de lire (…) “. Absalon Absalon ! évoque la chute de la maison Sutpen et l’histoire du Deep South de 1807 à janvier 1910. Il s’agit d’une réflexion sur l’héritage sudiste. Quentin pense comme l’auteur et répond à son ami Shreve à la fin du roman :
” (…) Pourquoi est-ce que tu hais le sud ?
– Je ne le hais pas, répondit vivement Quentin, sur-le-champ, immédiatement. Je ne le hais pas. “
William Faulkner a écrit deux projets pour une introduction au Bruit et à la fureur. On les retrouve dans les notices du premier tome de ses Oeuvres romanesques dans la Bibliothèque de la Pléiade, édition présentée et annotée par Michel Gresset. NRF Gallimard, 1977 (pages 1267 – 1273). Voici le premier.
Premier projet d’introduction au Bruit et la fureur de William Faulkner [version courte]. Non daté. Probablement 1933.
” J’ai écrit ce livre et j’ai appris à lire. J’avais appris un peu de l’art d’écrire en travaillant à Monnaie de singe : comment approcher la langue, les mots, moins avec sérieux, comme le fait un essayiste, qu’avec une sorte de respect, de circonspection, comme lorsqu’on approche de la dynamite ; avec joie même, comme on approche les femmes, peut-être avec les mêmes intentions perfides. Mais, quand j’eus fini Le Bruit et la fureur, je découvris qu’il y a vraiment quelque chose à quoi le mot art, ce terme rebattu, non seulement peut mais doit être appliqué. Je découvris alors que j’avais parcouru tout ce que j’avais lu, de Henry James aux histoires de meurtres des journaux en passant par Henty, sans faire aucune discrimination, sans en rien digérer, comme l’aurait pu faire une mite ou une chèvre. Après Le Bruit et la fureur, sans me soucier d’ouvrir un autre livre, et à travers une série de répercussions à retardement semblables à celles d’un orage d’été, je découvris les Flaubert, les Dostoïevski, les Conrad dont j’avais lu les œuvres dix ans auparavant. Avec Le Bruit et la fureur, j’appris à lire et à cesser de lire car, depuis, je n’ai rien lu.
Je n’ai pas non plus l’impression d’avoir jamais rien appris par la suite. Pendant que j’écrivais Sanctuaire, le roman qui suivit Le Bruit et la fureur, cette partie de moi-même qui apprenait au fur et à mesure que j’écrivais, cette partie où se trouve peut-être la force première qui pousse un écrivain au labeur qu’est l’invention et à la besogne qui consiste à aligner soixante-quinze ou cent mille mots sur le papier, cette partie-là était absente, parce que je lisais encore par répercussion les livres que j’avais avalés tout ronds dix ans au moins auparavant. Ce n’est qu’en écrivant Sanctuaire que j’appris qu’il y manquait quelque chose, quelque chose que m’avait donné Le Bruit et la fureur et que Sanctuaire ne me donnait pas. En entreprenant Tandis que j’agonise, je savais ce que c’était, et je savais que j’en serais encore privé, parce que ce livre allait être un livre délibéré. J’avais fermement l’intention d’écrire un tour de force. Avant même d’avoir posé la plume sur le papier et tracé le premier mot, je savais quel serait le dernier, et presque où tomberait le point final. Avant de commencer, je m’étais dit : je vais écrire un livre qui sera, au besoin, mon triomphe ou ma faillite si jamais plus je ne touche à l’encre. Aussi, quand j’eus fini, la froide satisfaction était bien là, comme je m’y attendais mais, comme je m’y attendais également, l’autre qualité que j’avais trouvée dans Le Bruit et la fureur était absente : cette émotion définie, physique et pourtant vague et difficile à décrire : cette extase, cette foi ardente et joyeuse, cette anticipation de surprise que la feuille encore immaculée sous ma main retenait, inviolée, inépuisable, attendant que je la libère. Cela ne se trouvait pas dans Tandis que j’agonise. Je me dis : C’est parce que j’en savais trop sur ce livre avant de commencer à l’écrire. Je me dis : vraisemblablement je n’aurai plus jamais besoin d’en savoir autant sur un livre avant de me mettre à l’écrire ; la prochaine fois, ça reviendra. J’attendis presque deux ans, puis je commençai Lumière d’août sans en savoir davantage que ceci : il y a une jeune femme, enceinte, qui marche le long d’une route de campagne inconnue. Je pensai : maintenant je vais retrouver cela, puisque je n’en sais pas plus sur ce livre que je n’en savais sur
Le Bruit et la fureur le jour où je me suis assis devant la première page blanche.
Cela n’est pas revenu. Les pages écrites croissaient en nombre. L’histoire marchait assez bien ; je m’y mettais tous les matins, sans hésitation et pourtant sans cette anticipation et cette joie qui seules ont fait pour moi de l’acte d’écrire un plaisir. Il me fallut attendre que le livre fût presque achevée, pour que je m’incline devant l’évidence : cela ne reviendrait pas, car maintenant, avant que chaque mot tombe en place, j’étais conscient des actions précises qu’allaient accomplir les personnages, puisque maintenant je choisissais délibérément leur conduite parmi les possibilités et les probabilités, et je pesais, mesurais chacun de mes choix à la balance des James, des Conrad, des Balzac. Je savais que j’avais trop lu, que j’avais atteint cette période que chaque écrivain doit traverser, pendant laquelle il croit en savoir trop sur son métier. Je reçus un exemplaire du livre imprimé et je constatai que je ne tenais même pas à savoir quelle espèce de couverture Smith lui avait mise. Il me semblait l’apercevoir placé sur un rayon avec tous ceux qui suivaient Le Bruit et la fureur tandis que je regardais les dos titrés avec une attention déclinante qui tenait presque du dégoût, et sur laquelle chacun des titres s’enregistrait de moins en moins jusqu’au moment où l’Attention elle-même sembla dire enfin : Dieu merci, jamais plus je n’aurai à en ouvrir un seul. Je crus que je savais alors pourquoi je n’avais pas retrouvé cette première extase et que jamais plus je ne la retrouverais ; que les romans quels qu’ils fussent que j’écrirais par la suite seraient écrits sans hésitation, mais aussi sans anticipation et sans joie : que dans Le Bruit et la fureur, j’avais déjà mis la seule chose en littérature qui parviendrait jamais à m’émouvoir profondément : Caddy grimpant dans le poirier pour regarder par la fenêtre la veillée funèbre de sa grand-mère tandis que Quentin, Jason, Benny et les Noirs lèvent les yeux vers son fond de culotte souillé de boue.
Ce roman-ci est le seul des sept romans que j’ai écrits sans avoir en même temps l’impression d’effort, de tension, sans avoir ensuite l’impression d’épuisement, de soulagement ou de dégoût. Quand je l’ai commencé je n’avais aucun plan, je n’écrivais même pas un livre. Je pensais bien aux livres, à la publication, mais à l’envers, en me disant : peu m’importe que les éditeurs aiment ça ou non. Quatre ans auparavant j’avais écrit Monnaie de singe. Il ne m’avait pas fallu longtemps pour l’écrire et le livre fut publié rapidement, et il me rapporta environ cinq cents dollars. Je me dis : écrire des romans, c’est facile. Ça ne rapporte pas grand-chose, mais c’est facile. J’écrivis Moustiques. Ce ne fut pas tout à fait aussi facile à écrire ni aussi rapide à publier et cela me rapporta environ quatre cents dollars. Je me dis : apparemment ce n’est pas aussi simple que ça d’écrire des romans, d’être romancier. J’écrivis Sartoris. Il me fallut beaucoup plus longtemps et l‘éditeur le refusa tout de suite. Mais je continuai à le colporter pendant environ trois ans, m’entêtant dans un espoir qui s’amenuisait, peut-être pour justifier le temps que j’avais mis à l’écrire. Cet espoir s’éteignit lentement, mais je n’en éprouvai aucune douleur. Un jour, il me semble que je fermais une porte entre moi et toutes les adresses et catalogues d’éditeurs. Je me dis : maintenant je vais me faire une urne comme celle que cet ancien Romain gardait toujours à son chevet et dont il usa lentement le bord sous ses baisers. Ainsi, moi qui n’ai jamais eu de sœur et qui étais voué à perdre ma fille peu après sa naissance, j’entrepris de me faire une belle et tragique petite fille. “