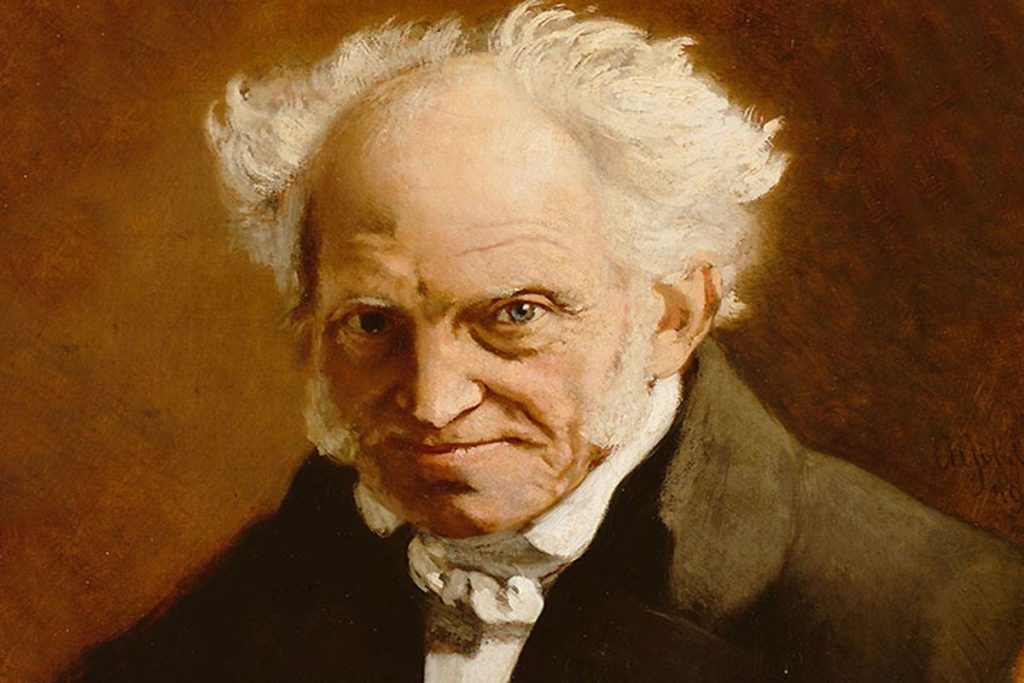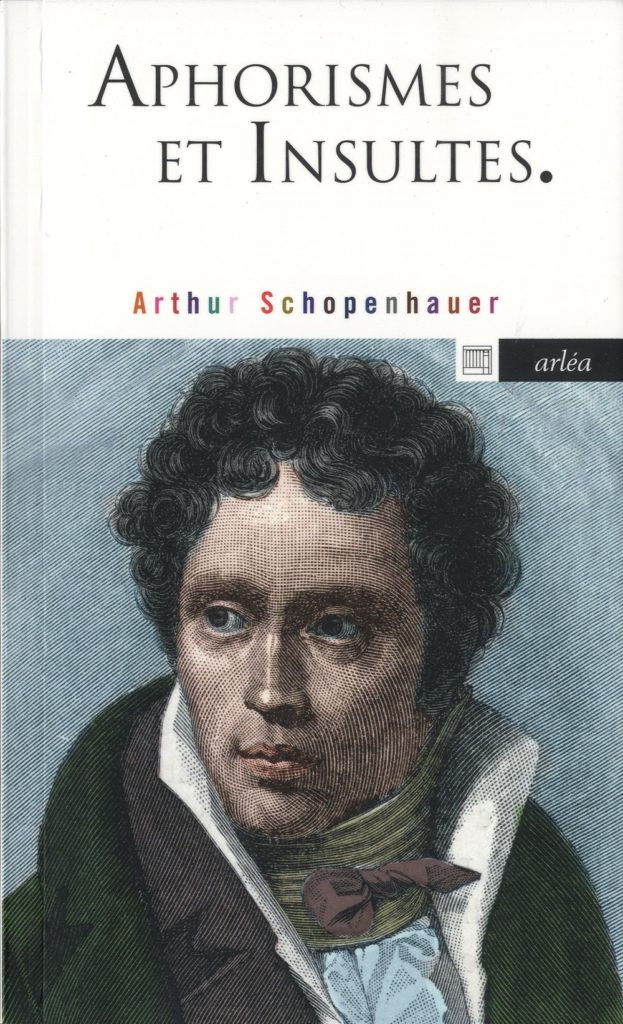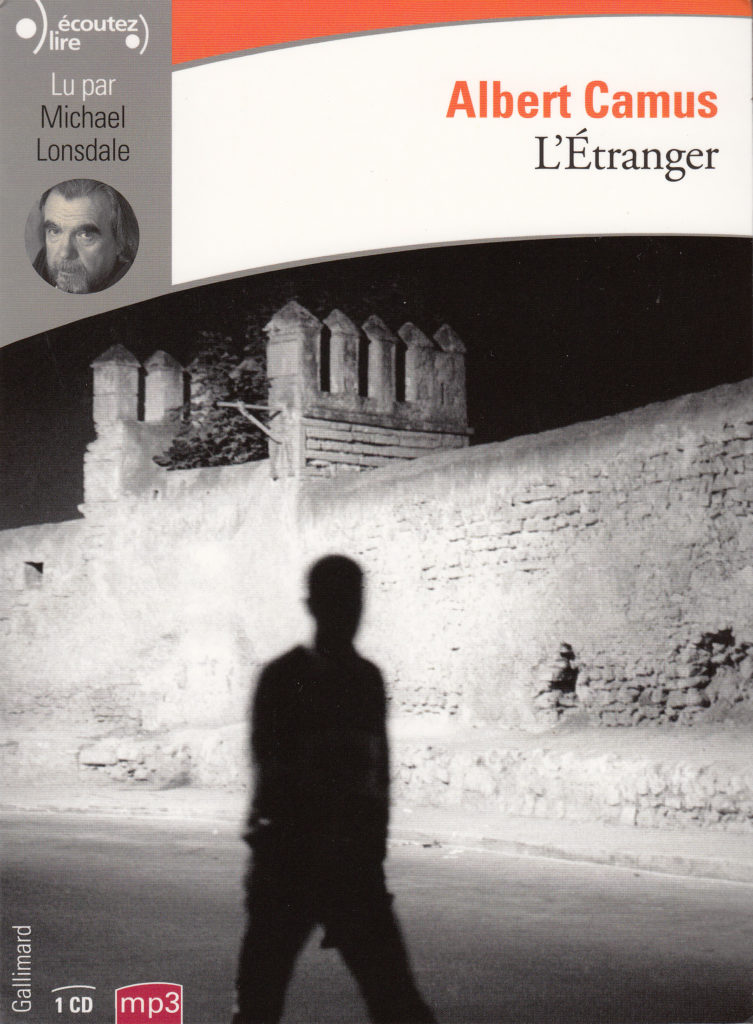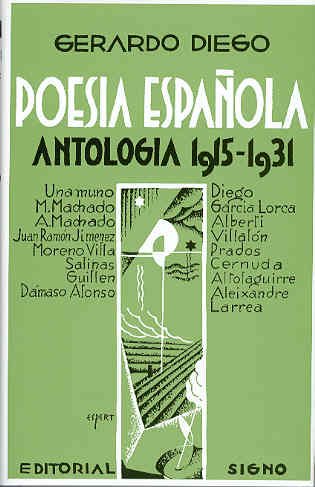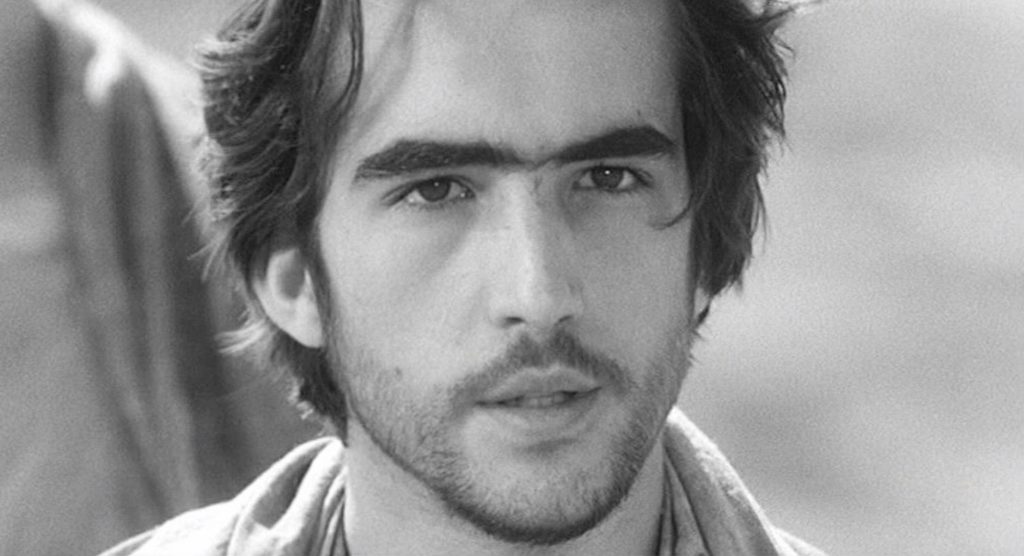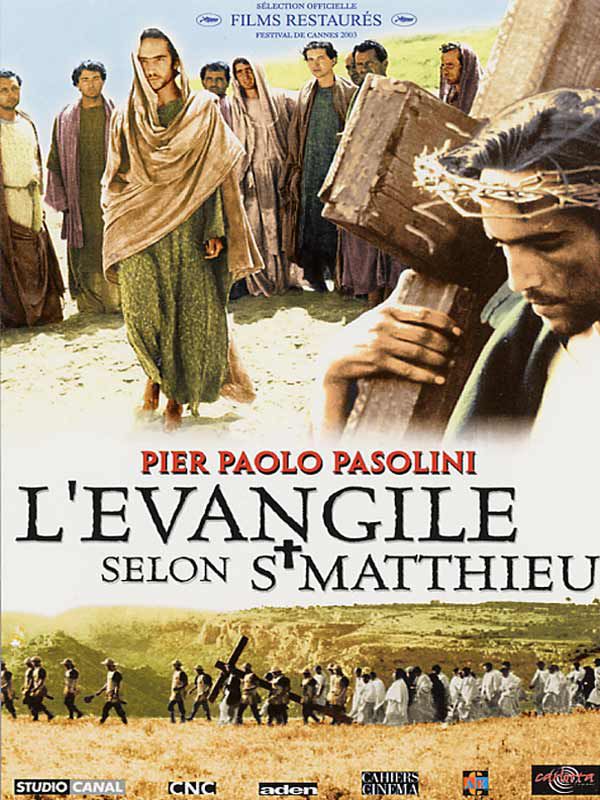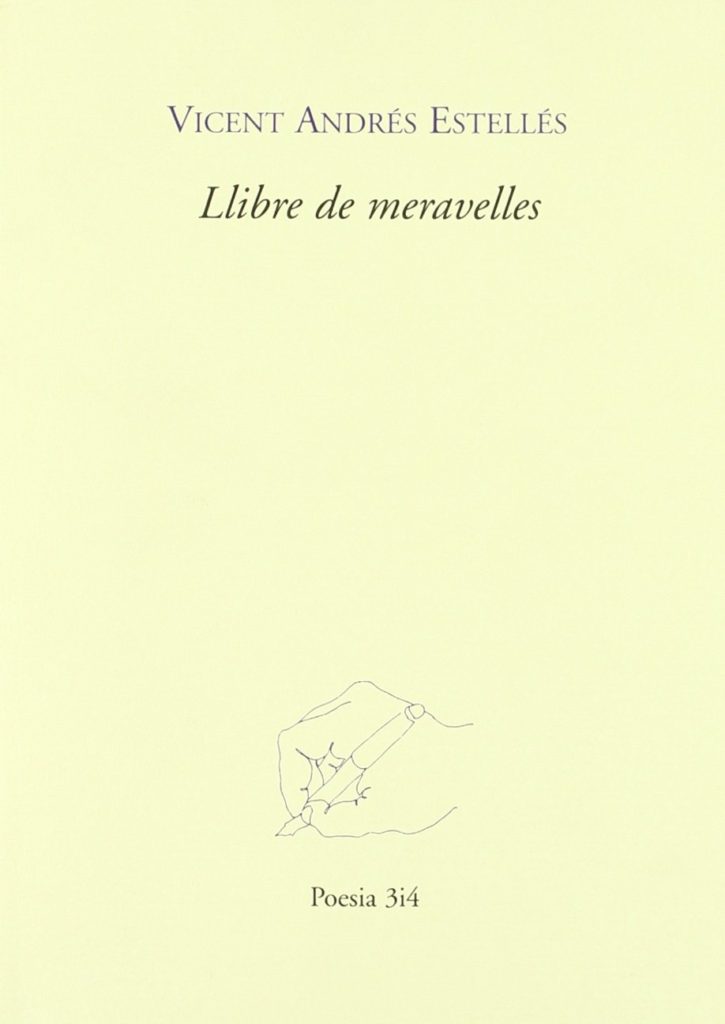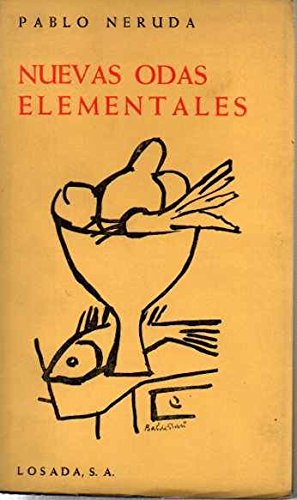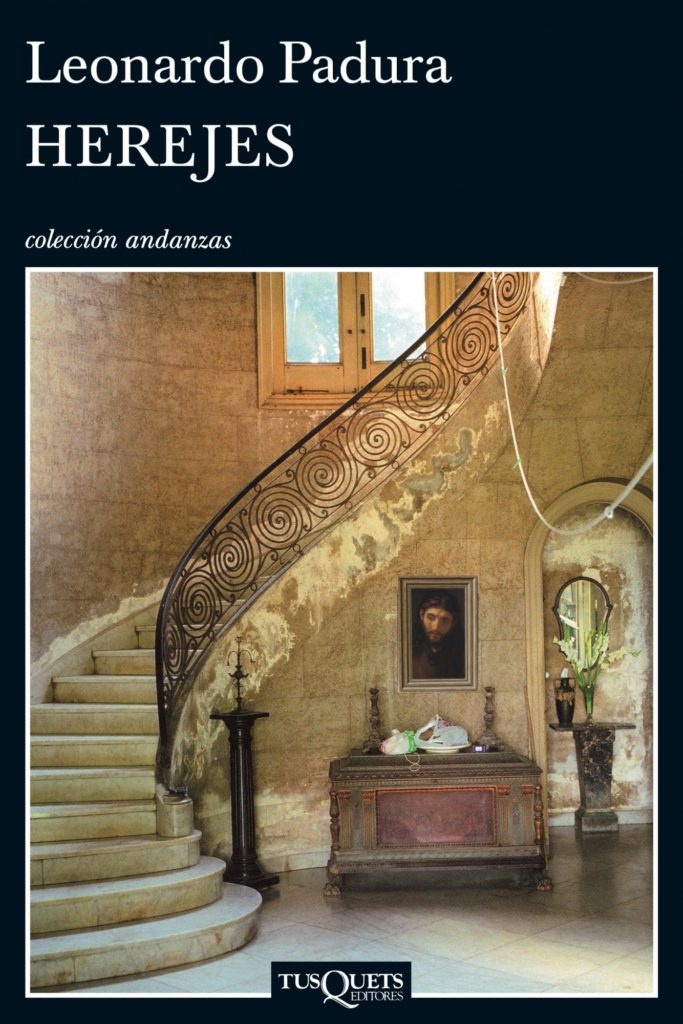
Herejes (éd. Tusquets, Barcelone, 2013 ). Traduction française: Hérétiques. septembre 2014 chez Métailié).
J’ai enfin terminé ce gros roman de Leonardo Padura (528 pages) qui m’attendait depuis quelques années. J’avais déjà lu les autres livres dont le héros est l’alter ego de l’auteur, Mario Conde. Les premières aventures de cet ancien policier, qui vit maintenant encore plus chichement de la vente de vieux livres, étaient courtes et assez dynamiques. Ce livre est long et trop ambitieux. La recherche des origines d’un portrait peint par Rembrandt au XVIIe siècle nous mène à Amsterdam, tandis que l’épilogue nous transporte vers les persécutions antisémites de la même époque en Pologne. L’oeuvre se présente comme un plaidoyer pour la liberté d’expression et de création et un hommage aux hérétiques et aux déviants.
Le modèle de Padura est le plus grand romancier cubain Alejo Carpentier (1904-1980) auquel il a consacré un essai: Un camino de medio siglo: Alejo Carpentier y la narrativa de lo real maravilloso, Letras Cubanas, La Habana, 1994 (Fondo de Cultura Económica, México, 2002). L’auteur du Siglo de las Luces (1962) est d’ailleurs précisément cité:
“Pero ahora, sin tener a quien confiarse, Esteban seguía preso con toda una ciudad, con todo un país, por cárcel. Y ese país tenía tales espesores de selva en La Tierra Firme que sólo el mar era puerta, y esa puerta estaba cerrada con enormes llaves de papel, que eran las peores. Asistíase en esta época a una multiplicación, a una universal proliferación de papeles, cubiertos de cuños, sellos, firmas y contrafirmas, cuyos nombres agotaban los sinónimos de «permiso», «salvoconducto», «pasaporte» y cuantos vocablos pudiesen significar una autorización para moverse de un país a otro, de una comarca a otra, a veces de una ciudad a otra. Los almojarifes, diezmeros, portazgueros, alcabaleros y aduaneros de otros tiempos quedaban apenas en pintoresco anuncio de la mesnada policial y política que ahora se aplicaba, en todas partes -unos por temor a la Revolución, otros por temor a la contrarrevolución- a coartar la libertad del hombre, en cuanto se refería a su primordial, fecunda, creadora posibilidad de moverse sobre la superficie del planeta que le hubiese tocado en suerte habitar. Esteban se exasperaba, pataleaba de furor, al pensar que el ser humano, renegando de un nomadismo ancestral, tuviese que someter su soberana voluntad de traslado a un papel. «Decididamente – pensaba – no he nacido para ser lo que hoy se entiende por un buen ciudadano…» (page 241. Seix Barral. Biblioteca Formentor)
Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, a du mal à soutenir la comparaison avec son aîné qui subjuguait par sa virtuosité baroque (surabondance d’adjectifs, longues descriptions, digressions nombreuses). Il faut le relire. Je vais rechercher aussi la traduction française René L.-F. Durand. Première édition chez Gallimard en 1962. Collection Folio (n° 981) en 1977.