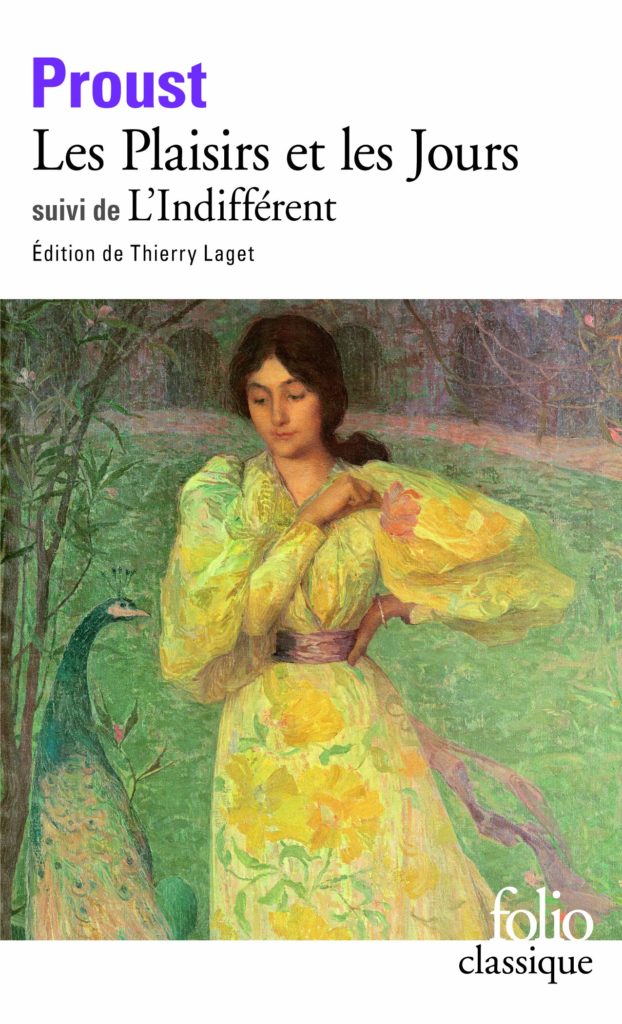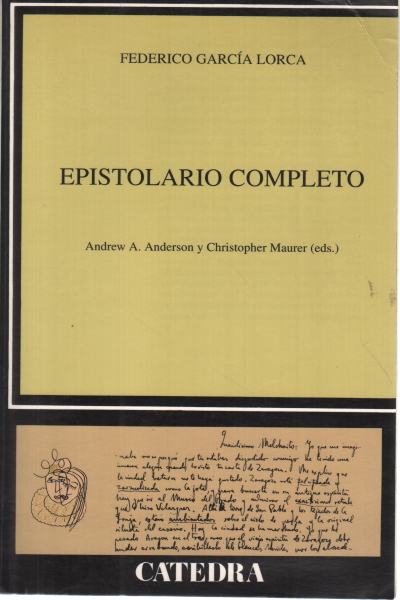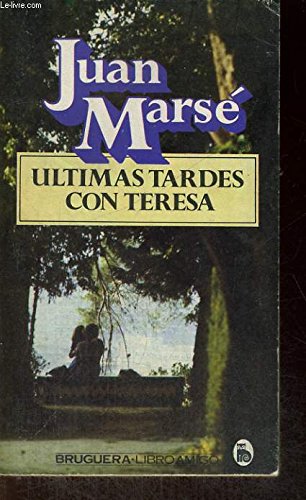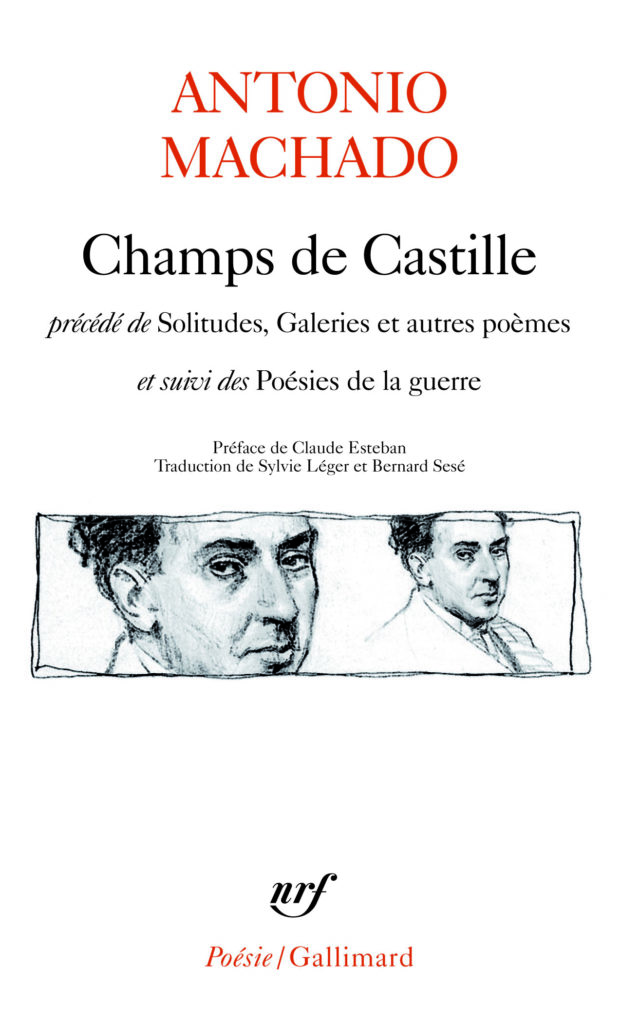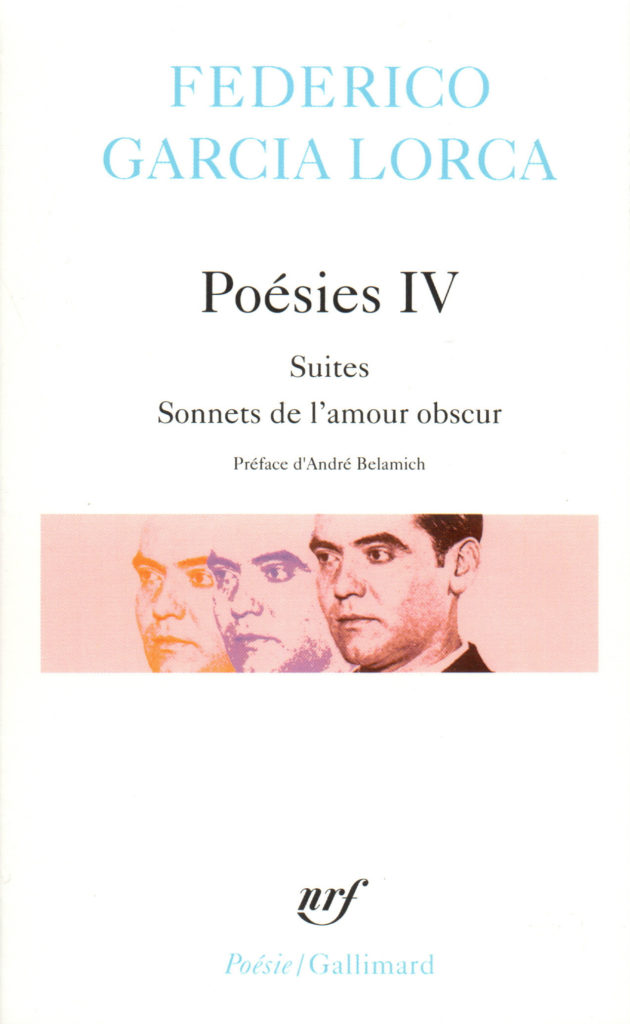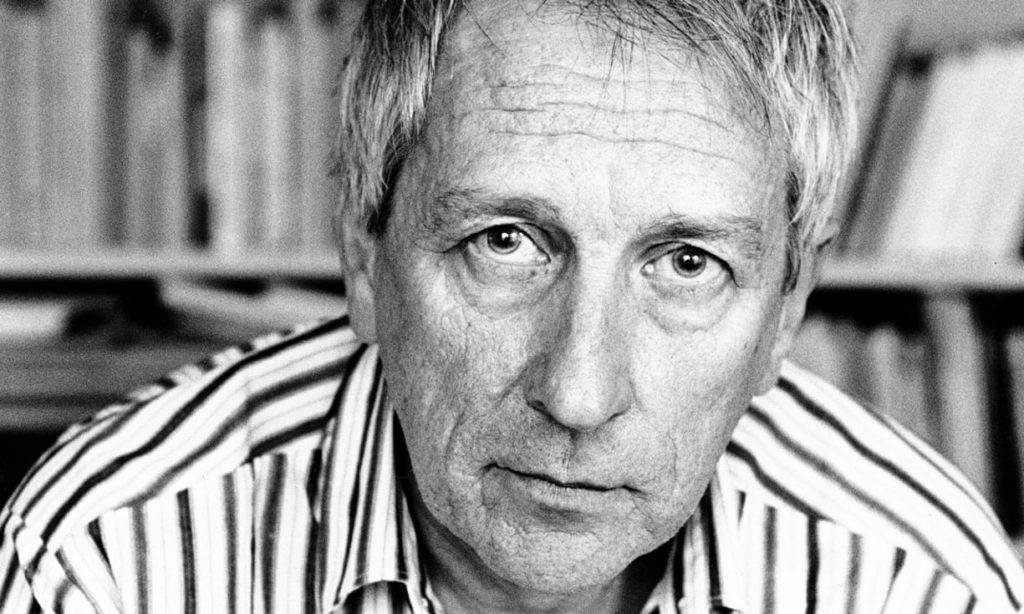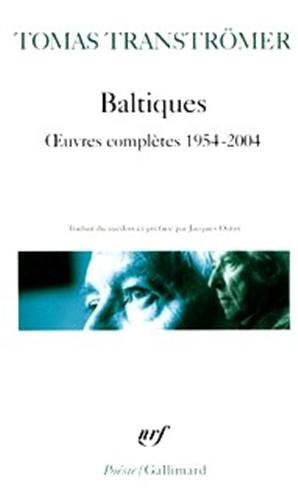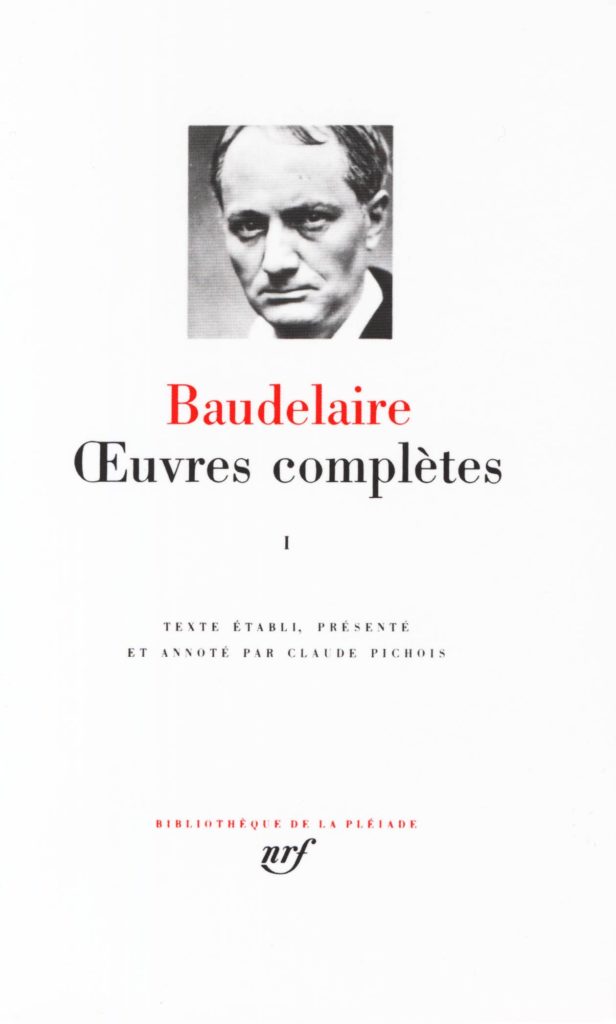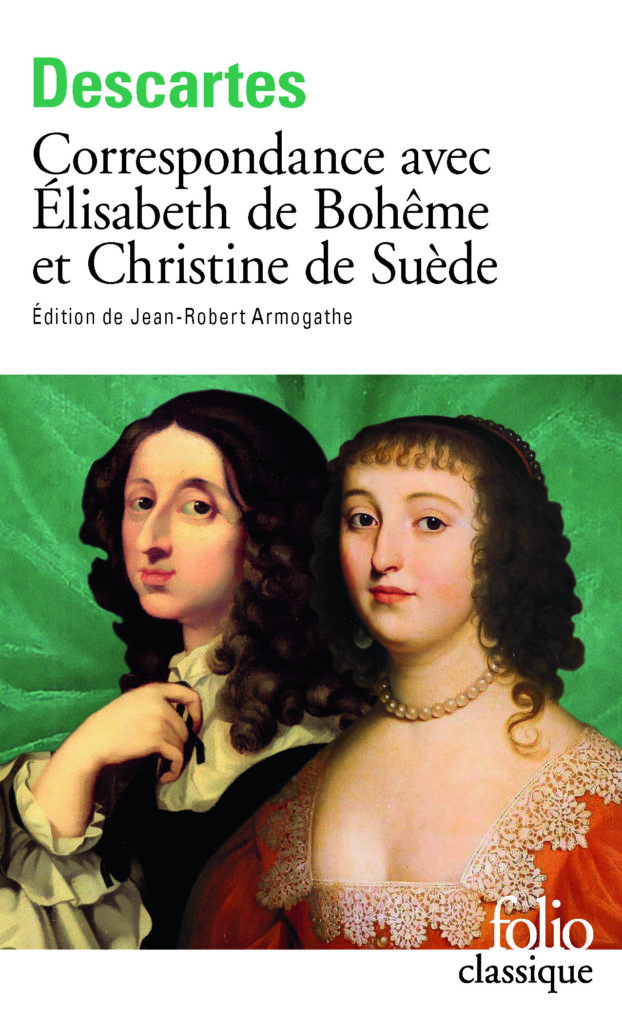XXVIII
La mer
La mer fascinera toujours ceux chez qui le dégoût de la vie et l’attrait du mystère ont devancé les premiers chagrins, comme un pressentiment de l’insuffisance de la réalité à les satisfaire. Ceux-là qui ont besoin de repos avant d’avoir éprouvé encore aucune fatigue, la mer les consolera, les exaltera vaguement. Elle ne porte pas comme la terre les traces des travaux des hommes et de la vie humaine. Rien n’y demeure, rien n’y passe qu’en fuyant, et des barques qui la traversent, combien le sillage est vite évanoui ! De là cette grande pureté de la mer que n’ont pas les choses terrestres. Et cette eau vierge est bien plus délicate que la terre endurcie qu’il faut une pioche pour entamer. Le pas d’un enfant sur l’eau y creuse un sillon profond avec un bruit clair, et les nuances unies de l’eau en sont un moment brisées; puis tout vestige s’efface, et la mer est redevenue calme comme aux premiers jours du monde. Celui qui est las des chemins de la terre ou qui devine, avant de les avoir tentés, combien ils sont âpres et vulgaires, sera séduit par les pâles routes de la mer, plus dangereuses et plus douces, incertaines et désertes. Tout y est plus mystérieux, jusqu’à ces grandes ombres qui flottent parfois paisiblement sur les champs nus de la mer, sans maisons et sans ombrages, et qu’y étendent les nuages, ces hameaux célestes, ces vagues ramures.
La mer a le charme des choses qui ne se taisent pas la nuit, qui sont pour notre vie inquiète une permission de dormir, une promesse que tout ne va pas s’anéantir, comme la veilleuse des petits enfants qui se sentent moins seuls quand elle brille. Elle n’est pas séparée du ciel comme la terre, est toujours en harmonie avec ses couleurs, s’émeut de ses nuances les plus délicates. Elle rayonne sous le soleil et chaque soir semble mourir avec lui. Et quand il a disparu, elle continue à le regretter, à conserver un peu de son lumineux souvenir, en face de la terre uniformément sombre. C’est le moment de ses reflets mélancoliques et si doux qu’on sent son coeur se fondre en les regardant. Quand la nuit est presque venue et que le ciel est sombre sur la terre noircie, elle luit encore faiblement, on ne sait par quel mystère, par quelle brillante relique du jour enfouie sous les flots. Elle rafraîchit notre imagination parce qu’elle ne fait pas penser à la vie des hommes, mais elle réjouit notre âme, parce qu’elle est, comme elle, aspiration infinie et impuissante, élan sans cesse brisé de chutes, plainte éternelle et douce. Elle nous enchante ainsi comme la musique, qui ne porte pas comme le langage la trace des choses, qui ne nous dit rien des hommes, mais qui imite les mouvements de notre âme. Notre coeur en s’élançant avec leurs vagues, en retombant avec elles, oublie ainsi ses propres défaillances, et se console dans une harmonie intime entre sa tristesse et celle de la mer, qui confond sa destinée et celle des choses.
Septembre 1892
Les Plaisirs et les jours, 1896.