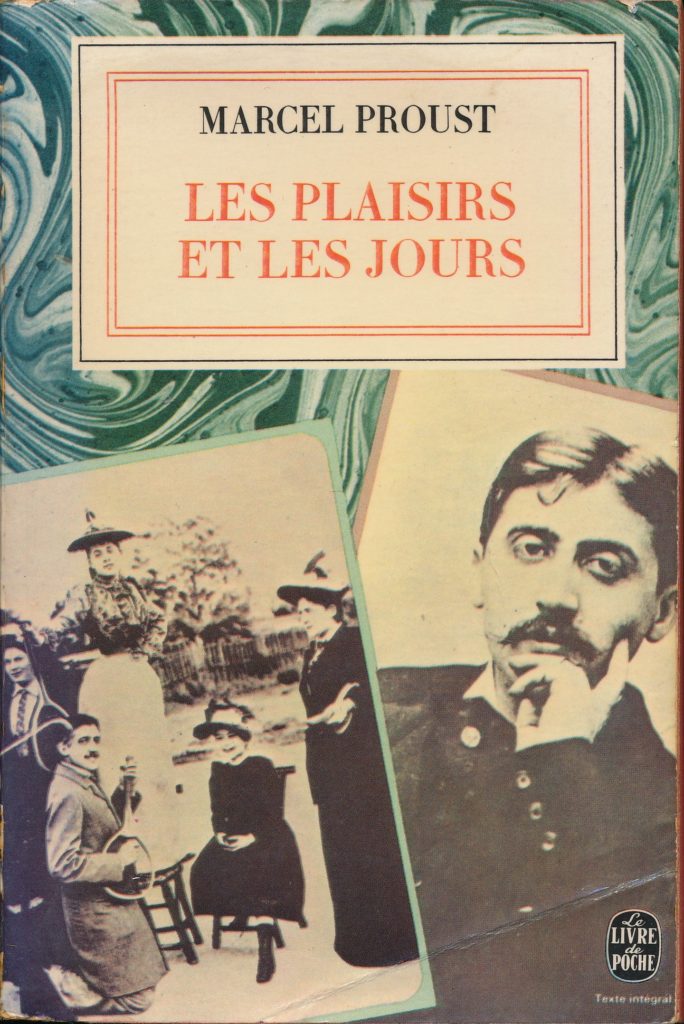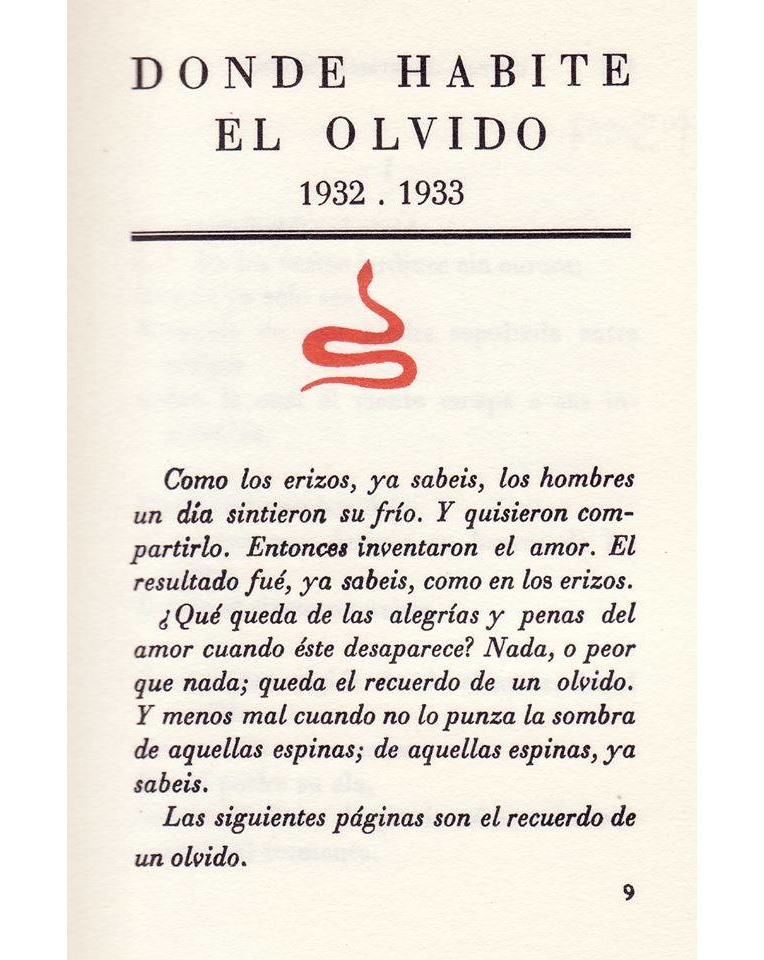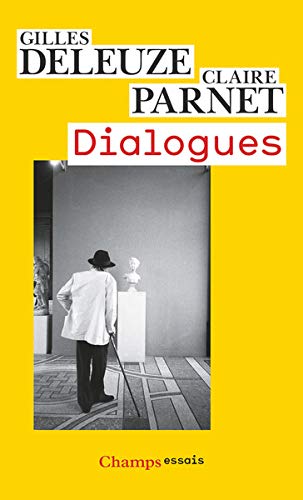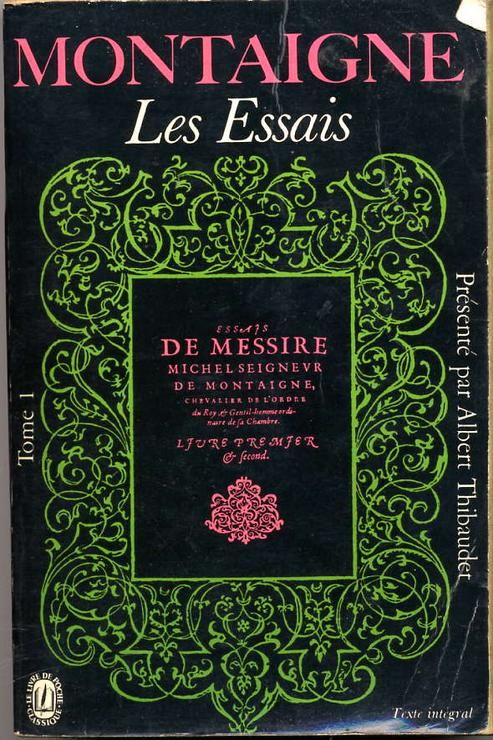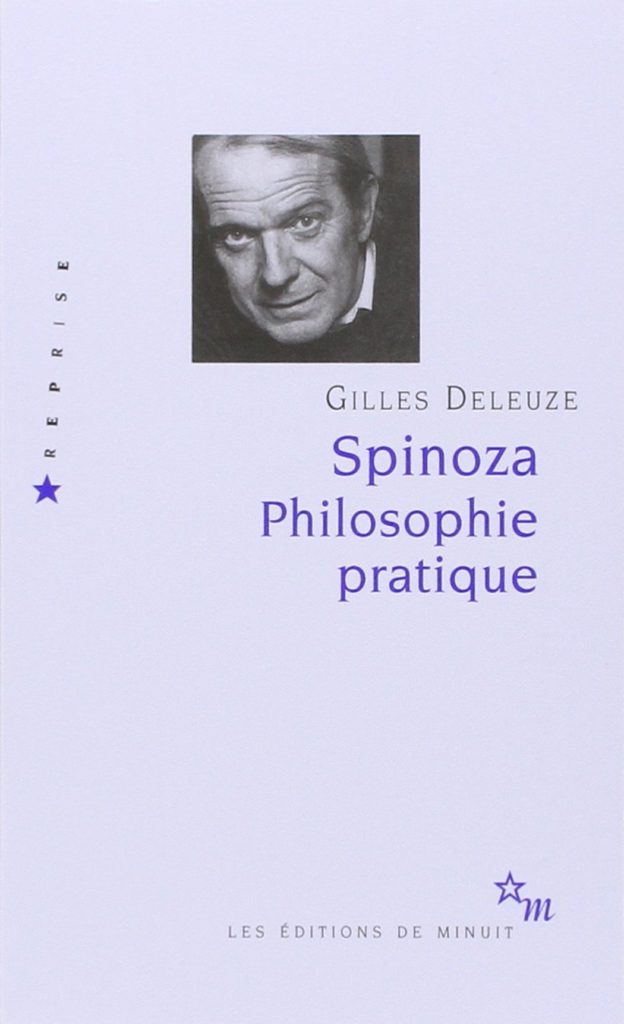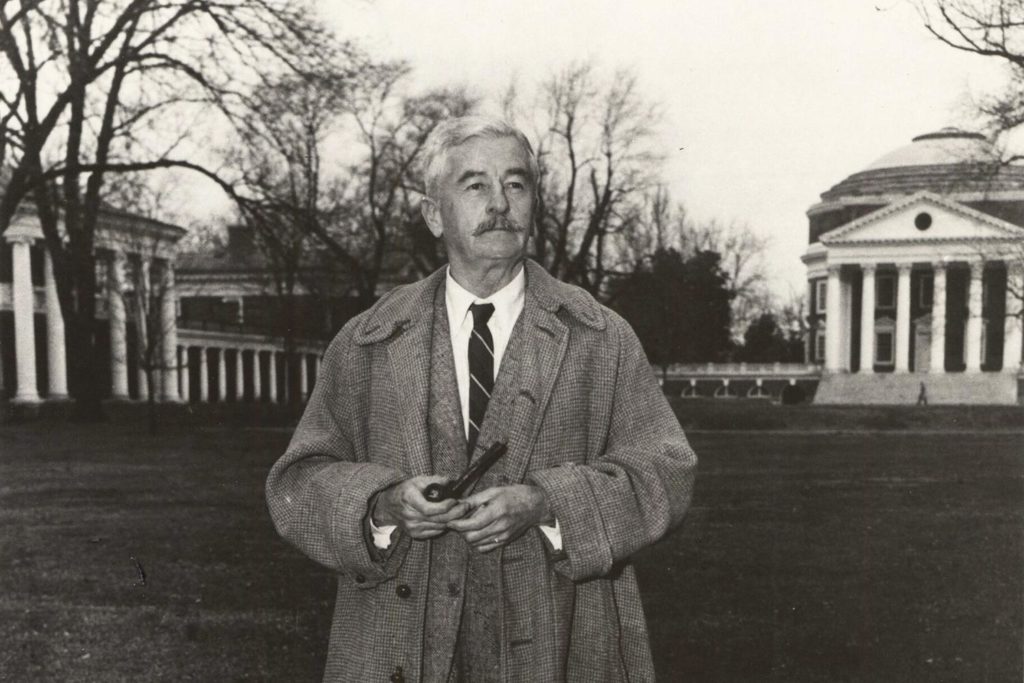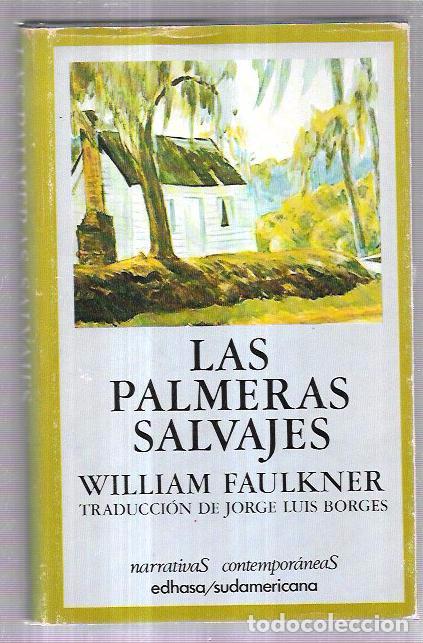XII. Ephémère efficacité du chagrin.
Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur; elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Mais soyons plus reconnaissants aux femmes méchantes ou seulement indifférentes, aux amis cruels qui nous ont causé du chagrin. Ils ont dévasté notre cœur, aujourd’hui jonché de débris méconnaissables, ils ont déraciné les troncs et mutilé les plus délicates branches, comme un vent désolé, mais qui sema quelques bons grains pour une moisson incertaine.
En brisant tous les petits bonheurs qui nous cachaient notre grande misère, en faisant de notre cœur un nu préau mélancolique, ils nous ont permis de le contempler enfin et de le juger. Les pièces tristes nous font un bien semblable; aussi faut-il les tenir pour bien supérieures aux gaies, qui trompent notre faim au lieu de l’assouvir: le pain qui doit nous nourrir est amer. Dans la vie heureuse, les destinées de nos semblables ne nous apparaissent pas dans leur réalité, que l’intérêt les masque ou que le désir les transfigure. Mais dans le détachement que donne la souffrance, dans la vie, et le sentiment de la beauté douloureuse, au théâtre, les destinées des autres hommes et la nôtre même font entendre enfin à notre âme attentive l’éternelle parole inentendue de devoir et de vérité. L’œuvre triste d’un artiste véritable nous parle avec cet accent de ceux qui ont souffert, qui forcent tout homme qui a souffert à laisser là tout le reste et à écouter.
Hélas! ce que le sentiment apporta, ce capricieux le remporte et la tristesse plus haute que la gaieté n’est pas durable comme la vertu. Nous avons oublié ce matin la tragédie qui hier soir nous éleva si haut que nous considérions notre vie dans son ensemble et dans sa réalité avec une pitié clairvoyante et sincère. Dans un an peut-être, nous serons consolés de la trahison d’une femme, de la mort d’un ami. Le vent, au milieu de ce bris de rêves, de cette jonchée de bonheurs flétris a semé le bon grain sous une ondée de larmes, mais elles sécheront trop vite pour qu’il puisse germer.
(Après l’Invitée de M. de Curel.)
Les plaisirs et les jours. 1896. Les regrets, rêveries couleur du temps.