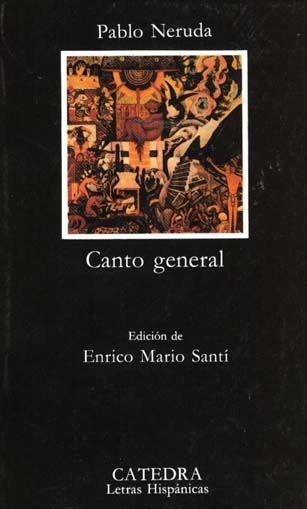Pablo Neruda évoque son enfance à plusieurs reprises dans son oeuvre. Elle apparaît entre autres dans Chant général, poème épique en quinze chants, publié en 1950 à Mexico par Talleres Gráficos de la Nación. Il a commencé à le composer dès 1938. Cette épopée comporte 15 sections, 231 poèmes et plus de quinze mille vers et ambitionne d’être une chronique encyclopédique de toute l’Amérique latine.
XV. Yo soy
I. La frontera (1904)
Lo primero que vi fueron árboles, barrancas
decoradas con flores de salvaje hermosura,
húmedo territorio, bosques que se incendiaban,
y el invierno detrás del mundo, desbordado.
Mi infancia son zapatos mojados, troncos rotos
caídos en la selva, devorados por lianas
y escarabajos, dulces días sobre la avena,
y la barba dorada de mi padre saliendo
hacia la majestad de los ferrocarriles.
Frente a mi casa el agua austral cavaba
hondas derrotas, ciénagas de arcillas enlutadas,
que en el verano eran atmósfera amarilla
por donde las carretas crujían y lloraban,
embarazadas con nueve meses de trigo.
Rápido sol del Sur:
rastrojos, humaredas
en caminos de tierras escarlatas, riberas
de ríos de redondo linaje, corrales y potreros
en que reverberaba la miel del mediodía.
El mundo polvoriento entraba grado a grado
en los galpones, entre barricas y cordeles,
a bodegas cargadas con el resumen rojo
del avellano, todos los párpados del bosque.
Me pareció ascender en el tórrido traje
del verano, con las máquinas trilladoras,
por las cuestas, en la tierra barnizada de boldos,
erguida entre los robles, indeleble,
pegándose en las ruedas como carne aplastada.
Mi infancia recorrió las estaciones: entre
los rieles, los castillos de madera reciente,
la casa sin ciudad, apenas protegida
por reses y manzanos de perfume indecible,
fui yo, delgado niño cuya pálida forma
se impregnaba de bosques vacíos y bodegas.
Canto general, 1950.
XV. Je suis
I. La frontière
Ce que je vis d’abord ce fut des arbres, des ravins
décorés de fleurs belles et sauvages,
un territoire humide, des forêts en feu,
et l’hiver en crue derrière le monde.
J’eus pour enfance des souliers mouillés, des troncs brisés
tombés dans la forêt, dévorés par les lianes
et les scarabées, j’eus des journées douces sur l’avoine,
et la barbe dorée de mon père partant
pour la majesté des chemins de fer.
La pluie australe creusait devant la maison
de profondes mares, des bourbiers d’argile endeuillée,
qui, l’été, se transmuaient en un jaune climat
où les charrettes grinçaient, où elles pleuraient
enceintes de neuf mois de blé.
Soleil du Sud: soleil rapide:
chaumes, denses fumées
dans des chemins de terre écarlates, berges
de fleuves à ronde lignée, prairies, enclos
où le miel du midi était réverbéré.
Le monde poussiéreux pénétrait par degré
dans les hangars, parmi des tonneaux et des cordes,
jusqu’aux caves entassant le rouge résumé
du noisetier, toutes les paupières de la forêt.
Il me parut monter dans la robe torride
de l’été, avec les batteuses, au long
des côtes, sur la terre au vernis de boldos
dressée entre les chênes, indélébile,
et qui collait aux roues comme chair écrasée.
Mon enfance parcourut les saisons: avec, autour de moi,
les rails, les châteaux de bois frais
et la maison sans ville, à peine protégée
par des troupeaux et des pommiers au parfum ineffable,
je vécus, mince enfant à la forme pâlotte,
en m’imprégnant de forêts vides et d’entrepôts.
Chant général, 1977. Éditions Gallimard (Traduction de Claude Couffon).
XV Yo soy
III. La casa
Mi casa, las paredes cuya madera fresca,
recién cortada, huele aún: destartalada
casa de la frontera, que crujía
a cada paso, y silbaba con el viento de guerra
del tiempo austral, haciéndose elemento
de tempestad, ave desconocida
bajo cuyas heladas plumas creció mi canto.
Vi sombras, rostros que como plantas
en torno a mis raíces crecieron, deudos
que cantaban tonadas a la sombra de un árbol
y disparaban entre los caballos mojados,
mujeres escondidas en la sombra
que dejaban las torres masculinas,
galopes que azotaban la luz,
enrarecidas
noches de cólera, perros que ladraban.
Mi padre, con el alba oscura
de la tierra, hacia qué perdidos archipiélagos
en sus trenes que aullaban se deslizó?
Más tarde amé el olor del carbón en el humo,
los aceites, los ejes de precisión helada,
y el grave tren cruzando el invierno extendido
sobre la tierra,como una oruga orgullosa.
De pronto trepidaron las puertas.
Es mi padre.
Lo rodean los centuriones del camino:
ferroviarios envueltos en sus mantas mojadas,
el vapor y la lluvia con ellos revistieron
la casa, el comedor se llenó de relatos
enronquecidos, los vasos se vertieron,
y hasta mí, de los seres, como una separada
barrera, en que vivían los dolores,
llegaron las congojas, las ceñudas
cicatrices, los hombres sin dinero,
la garra mineral de la pobreza.
Canto general, 1950.
XV. Je suis
III. La maison
Ma maison et ses murs de planches fraîches
dont je sens encor le parfum; branlante et biscornue
maison de la frontière qui craquait
à chaque pas, et où sifflait le vent de guerre
du temps austral, maison qui devenait alors
élément de tempête ou oiseau inconnu
aux plumes glacées sous lesquelles grandissait mon chant.
Je vis des ombres, des visages qui poussèrent
comme des plantes autour de mes racines, des parents
qui fredonnaient sous les grands arbres et qui tiraient
des coups de feu au milieu des chevaux mouillés,
des femmes qui, cachées dans l’ombre,
délaissaient les tours masculines,
des galops qui fouettaient le jour,
des nuits
coléreuses et sans air, des chiens qui aboyaient.
Avec l’aube, mon père, sur la terre enténébrée,
se faufilait dans ses trains qui hurlaient.
Vers quels archipels oubliés?
Plus tard j’ai aimé l’odeur du charbon dans la fumée,
les huiles, les essieux, leur précision glacée,
l’hiver allongé sur la terre.
Soudain les portes ont trépidé.
Voici mon père
entouré de ses centurions: les cheminots,
ils sont enveloppés dans leurs couvertures trempées,
la vapeur et la pluie avec eux ont vêtu
la maison, dans la salle à manger, leurs récits
foisonnent et s’enrouent, les verres se répandent,
et de ces êtres, jusqu’à moi, comme d’une barrière
écartée, où nichaient, où vivaient les douleurs,
sont arrivés les angoisses, les cicatrices
taciturnes, les hommes sans argent,
la griffe minérale de la pauvreté.
Chant général, 1977. Éditions Gallimard (Traduction de Claude Couffon).