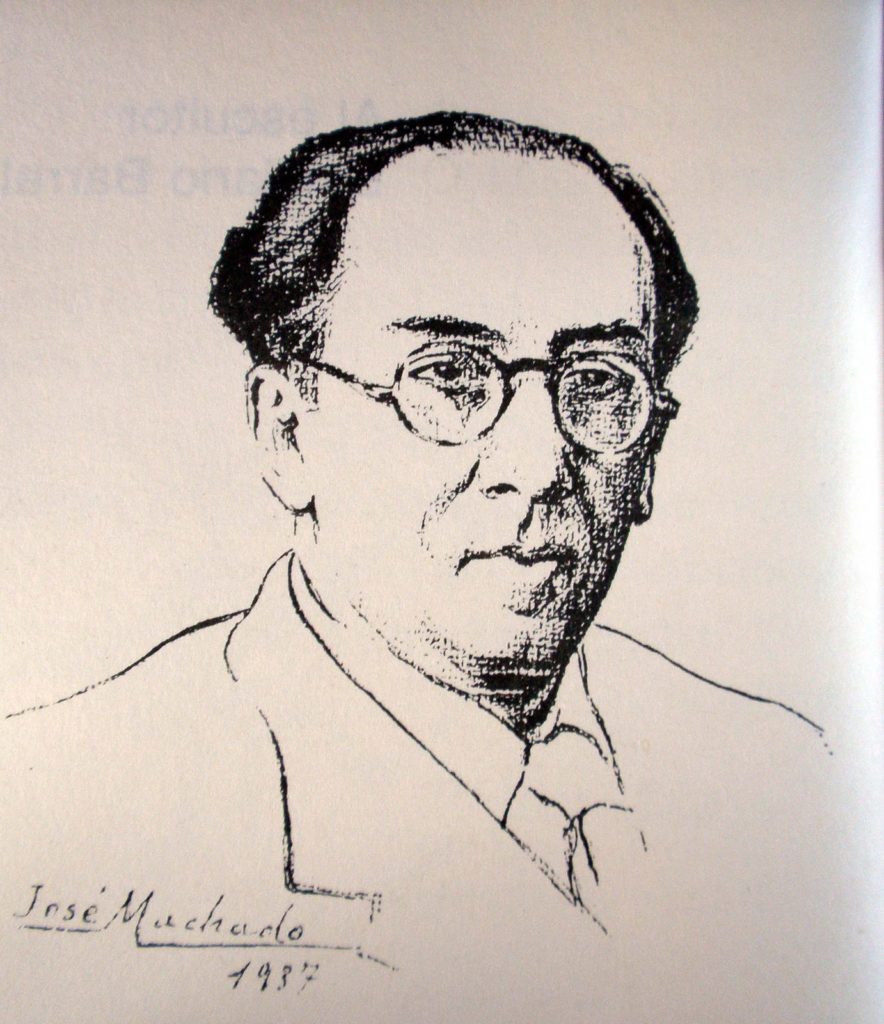
Consejos
I
Este amor que quiere ser
acaso pronto será;
pero ¿cuándo ha de volver
lo que acaba de pasar?
Hoy dista mucho de ayer.
¡Ayer es Nunca jamás!
Soledades (1903)
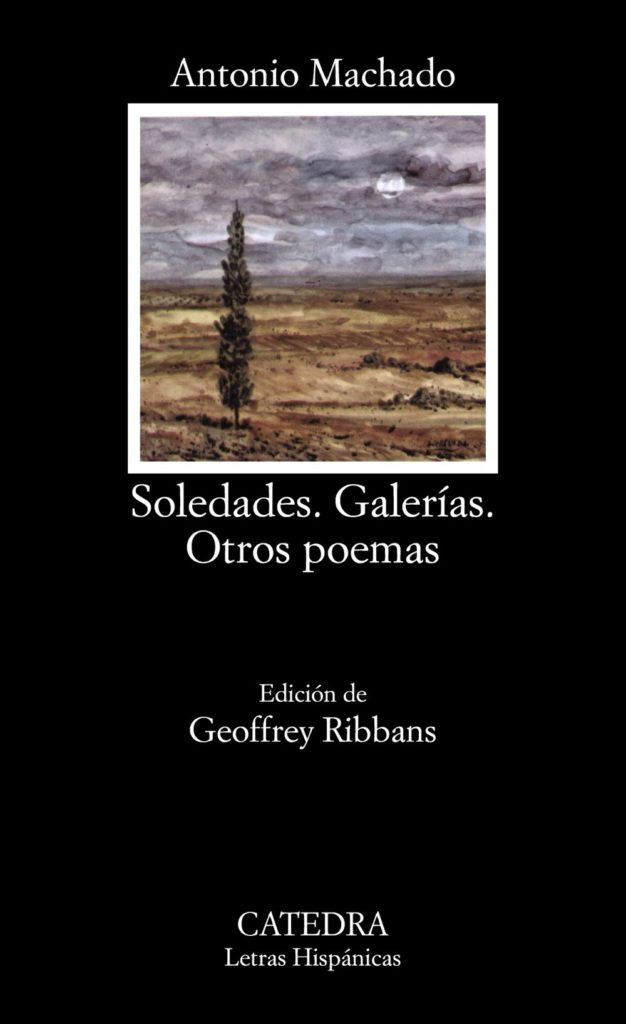

"Il faut voyager pour frotter et lisser sa cervelle contre celle d'aultruy" Montaigne, Essais Livre I, 1595
Julio Cortázar narrando su “Torito”, cuento que es un homenaje al boxeador argentino Justo Suárez, alias “el Torito de Mataderos”, que recibiera este apodo por ser del barrio porteño de Mataderos. Originalmente, se publicó este cuento en “Final del Juego”, libro de Cortázar de 1956, y a su vez esta narración del propio autor vería la luz en el LP “Cortázar Por Él Mismo: Un Libro Sonoro”, de 1970, y que fuera grabado en París (de hecho Julio hace las erres muy francesas en el mismo) en febrero de tal año. En el minuto 2:01 empieza la dedicatoria a Jacinto Cúcara con la que empezara el cuento, comenzando este en sí en el minuto 2:12.
https://www.literatura.us/cortazar/torito.html


L’Amour du mensonge
Quand je te vois passer, ô ma chère indolente,
Au chant des instruments qui se brise au plafond
Suspendant ton allure harmonieuse et lente,
Et promenant l’ennui de ton regard profond;
Quand je contemple, aux feux du gaz qui le colore,
Ton front pâle, embelli par un morbide attrait,
Où les torches du soir allument une aurore,
Et tes yeux attirants comme ceux d’un portrait,
Je me dis: Qu’elle est belle! et bizarrement fraîche!
Le souvenir massif, royale et lourde tour,
La couronne, et son cœur, meurtri comme une pêche,
Est mûr, comme son corps, pour le savant amour.
Es-tu le fruit d’automne aux saveurs souveraines?
Es-tu vase funèbre attendant quelques pleurs,
Parfum qui fait rêver aux oasis lointaines,
Oreiller caressant, ou corbeille de fleurs?
Je sais qu’il est des yeux, des plus mélancoliques,
Qui ne recèlent point de secrets précieux;
Beaux écrins sans joyaux, médaillons sans reliques,
Plus vides, plus profonds que vous-mêmes, ô Cieux!
Mais ne suffit-il pas que tu sois l’apparence,
Pour réjouir un cœur qui fuit la vérité?
Qu’importe ta bêtise ou ton indifférence?
Masque ou décor, salut! J’adore ta beauté.
Les Fleurs du mal. Tableaux parisiens. 1861.
Les promesses d’un visage
J’aime, ô pâle beauté, tes sourcils surbaissés,
D’où semblent couler des ténèbres,
Tes yeux, quoique très noirs, m’inspirent des pensers
Qui ne sont pas du tout funèbres.
Tes yeux, qui sont d’accord avec tes noirs cheveux,
Avec ta crinière élastique,
Tes yeux, languissamment, me disent : ” Si tu veux,
Amant de la muse plastique,
Suivre l’espoir qu’en toi nous avons excité,
Et tous les goûts que tu professes,
Tu pourras constater notre véracité
Depuis le nombril jusqu’aux fesses ;
Tu trouveras au bout de deux beaux seins bien lourds,
Deux larges médailles de bronze,
Et sous un ventre uni, doux comme du velours,
Bistré comme la peau d’un bonze,
Une riche toison qui, vraiment, est la soeur
De cette énorme chevelure,
Souple et frisée, et qui t’égale en épaisseur,
Nuit sans étoiles, Nuit obscure ! “
Les épaves, 1866


«Diálogo con García Lorca». 10 de junio de 1936. Diario El Sol. Encuentro entre el periodista , pintor, dibujante y caricaturista catalán Luis Bagaría i Bou (1882-1940). y Federico García Lorca.
El 19 de agosto de 1936, Federico García Lorca fue asesinado por los franquistas en Víznar (Granada) . Luis Bagaría se exilió, primero a París y después a La Habana, donde falleció en 1940.
“Tú que has dado categoría lírica a la calabaza de Gil Robles y has visto el búho de Unamuno y el perro sin amo de Baroja, ¿me quieres decir el sentido que tiene el caracol en el paisaje puro de tu obra?
Amigo Federico me preguntas el por qué de esa predilección por los caracoles de mis dibujos. Pues muy sencilla: para mí, el caracol tiene un recuerdo sentimental de mi vida. Una vez, estando dibujando, se acercó mi madre, y al contemplar mis garabatos me dijo: “Hijo mío: Me moriré sin poder comprender cómo te puedes ganar la vida haciendo caracoles”. Desde entonces, yo a mis dibujos los bauticé así. Aquí tienes saciada tu curiosidad, poeta García Lorca. Poeta García Lorca, sutil y profundo, pues tu verso tenue y bello, verso con alas de acero bien templado, horada la entraña de la tierra. ¿Crees tú, poeta, en el arte por el arte o, en caso contrario, el arte debe ponerse al servicio de un pueblo para llorar con él cuando llora y reír cuando este pueblo ríe?
A tu pregunta, grande y tierno Bagaría, tengo que decir que este concepto del arte es una cosa que sería cruel si no fuera, afortunadamente, cursi. Ningún hombre verdadero cree ya en esta zarandaja del arte puro, arte por el arte mismo.
En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Particularmente, yo tengo un ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a las puertas del teatro y al teatro consagro toda mi sensibilidad.
¿Crees tú que al engendrar la poesía se produce un acercamiento hacia un futuro más allá, o al contrario, hace que se alejen más los sueños de la otra vida?
Esta pregunta insólita y difícil nace de la aguda preocupación metafísica que llena tu vida y que sólo los que te conocen comprenden. La creación poética es un misterio indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se oyen voces no se sabe dónde, y es inútil preocuparse de dónde vienen. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Escucho a la Naturaleza y al hombre con asombro, y copio lo que me enseñan sin pedantería y sin dar a las cosas un sentido que no sé si lo tienen. Ni el poeta ni nadie tienen la clave y el secreto del mundo. Quiero ser bueno, sé que la poesía eleva, y siendo bueno con el asno y con el filósofo, creo firmemente que si hay un más allá tendré la agradable sorpresa de encontrarme en él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que mana del mundo, y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento, me evitan trasladar mi casa a las estrellas.
¿No crees, poeta, que sólo la felicidad radica en la niebla de una borrachera, borrachera de labios de mujer, de vino, de bello paisaje, y que al ser coleccionista de momentos de intensidad se crean momentos de eternidad, aunque la eternidad no existiera y tuviera que aprender de nosotros?
Yo no sé, Bagaría, en qué consiste la felicidad. Si voy a creer al texto que estudié en el Instituto, del inefable catedrático Ortí y Lara, la felicidad no se puede hallar más que en el cielo; pero si el hombre ha inventado la eternidad, creo que hay en el mundo hechos y cosas que son dignos de ella, y por su belleza y transcendencia, modelos absolutos para un orden permanente. ¿Por qué me preguntas estas cosas? Tú lo que quieres es que nos encontremos en el otro mundo y sigamos nuestra conversación bajo el techo de un prodigioso café de música con alas, risa y eterna cerveza inefable. Bagaría: no temas… ten la seguridad de que nos encontraremos.
Te extrañarás, poeta, de las preguntas de este caricaturista salvaje. Soy, como sabes, un ser con muchas plumas y pocas creencias, salvaje con dolorida materia; y piensa, poeta, que todo este equipaje trágico del vivir floreció en un verso que balbucearon los labios de mis padres. ¿No crees que tenía más razón Calderón de la Barca cuando decía “Pues el delito mayor/ del hombre es haber nacido” que el optimismo de Muñoz Seca?
Tus preguntas no me extrañan nada. Eres un verdadero poeta, que en todo momento pone la llaga en el dedo. Te contesto con verdadera sinceridad, con simpleza, y si no acierto y balbuceo, sólo es por ignorancia.
Las plumas de tu salvajismo son plumas de ángel, y detrás del tambor que lleva el ritmo de tu danza macabra hay una lira rosa de las que pintaron los primitivos italianos. El optimismo es propio de las almas que tienen una sola dimensión; de las que no ven el torrente de lágrimas que nos rodea, producido por cosas que tienen remedio.
Sensible y humano poeta Lorca: seguimos hablando de cosas del más allá. Soy repetidor del mismo tema, porque también el tema se repite él mismo. A los creyentes que creen en una futura vida, ¿les puede alegrar encontrarse en un país de almas que no tengan labios carnales para poder besar? ¿No es mejor el silencio de la nada?
Bonísimo y atormentado Bagaría: ¿No sabes que la Iglesia habla de la resurrección de la carne como el gran premio a sus fieles? El profeta Isaías lo dice en un versículo tremendo: “Se regocijarán en el Señor los huesos abatidos”. Y yo vi en el cementerio de San Martín una lápida en una tumba ya vacía, lápida que colgaba como un diente de vieja del muro destrozado, que decía así: “Aquí espera la resurrección de la carne doña Micaela Gómez”. Una idea se expresa y es posible porque tenemos cabeza y manos. Las criaturas no quieren ser sombras.
¿Tú crees que fue un momento acertado devolver las llaves de tu tierra granadina?
Fue un momento malísimo aunque digan lo contrario en las escuelas. Se perdieron una civilización admirable, una poesía, una astronomía, una arquitectura y una delicadeza únicas en el mundo para dar paso a una ciudad pobre, acobardada; a una “tierra del chavico”, donde se agita actualmente la peor burguesía de España.
¿No cree, Federico, que la patria no es nada, que las fronteras están llamadas a desaparecer? ¿Por qué un español malo tiene que ser más hermano nuestro que un chino bueno?
Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos; pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula; pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política.
Amigo Bagaría: No siempre los interviuvadores van a preguntar. Creo que también tienen derecho los interviuvados. ¿A qué responde esta ansia, esta sed de más allá que te persigue? ¿Tienes verdaderamente deseos de sobrevivirte? ¿No crees que esto está ya resuelto y que el hombre no puede hacer nada, con fe o sin ella?
Conformes, desgraciadamente, conformes. Yo soy en el fondo un descreído hambriento de creer. Es tan trágicamente doloroso el desaparecer para siempre. ¡Salud, labios de mujer, vaso del buen vino que supiste hacer olvidar la trágica verdad: paisaje, luz que hiciste olvidar la sombra! En el trágico fin sólo desearía una perduración: que mi cuerpo fuera enterrado en una huerta: que por lo menos mi más allá fuese un más allá de abono.
¿Me quieres decir por qué tienen carne de rana todos los políticos que caricaturizas?
Porque la mayoría vive en las charcas.
¿En qué prado corta Romanones las inefables margaritas de su nariz?
Querido poeta: aludes a una de las cosas que llegan más al fondo de mi alma. ¡Nariz de Romanones, excelsa nariz! La de Cyrano era una nariz desaparecida al lado de la nariz de mis amores. Rostand gozó menos que yo con la mía. ¡Oh “panneaux” para mis visiones decorativas! Mis margaritas se fueron cuando las entregaron en una solitaria estación, camino de Fontainebleau.
Nunca te habrán preguntado, porque ya no es moda, cuál es tu flor preferida. Como yo ahora he estudiado el lenguaje de las flores, te pregunto: ¿Cuál es la flor qué prefieres? ¿Te la has puesto alguna vez en la solapa?
Querido amigo: ¿Es que piensas dar conferencias como García Sanchíz para preguntar esas cosas?
¡Dios me libre! No aspiro a tocar mal el violoncelo. ¿A qué responde, querido Bagaría, el sentimiento humano que imprimes a los animales que pintas?
Querido Lorca: te voy a preguntar por las dos cosas que creo tienen más valor en España: el canto gitano y el toreo. Al canto gitano, el único defecto que le encuentro es que en sus versos sólo se acuerda de la madre; y al padre, que lo parta un rayo. Y eso me parece una injusticia. Bromas aparte, creo que este canto es el gran valor de nuestra tierra.
Muy poca gente conoce el canto gitano, porque lo que se da frecuentemente en los tablados es el llamado flamenco, que es una degeneración de aquél. No cabe en este diálogo decir nada, porque sería demasiado extenso y poco periodístico. En cuanto a lo que tú dices, con gracia de que los gitanos sólo se acuerdan de su madre, tienes cierta razón, ya que ellos viven un régimen de matriarcado, y los padres no son tales padres, sino que son siempre y viven como hijos de sus madres. De todos modos, hay en la poesía popular gitana admirables poemas dedicados al sentimiento paternal; pero son los menos. El otro gran tema porque me preguntas, el toreo, es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. Es el drama puro, en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y su mejor bilis. Es el único sitio adonde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza. ¿Qué sería de la primavera española, de nuestra sangre y de nuestra lengua si dejaran de sonar los clarines dramáticos de la corrida? Por temperamento y por gusto poético soy un profundo admirador de Belmonte.
¿Qué poetas te gustan más de la actualidad española?
Hay dos maestros: Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. El primero, en un plano puro de serenidad y perfección poética, poeta humano y celeste, evadido ya de toda lucha, dueño absoluto de su prodigioso mundo interior. El segundo, gran poeta turbado por una terrible exaltación de su yo, lacerado por la realidad que lo circunda, increíblemente mordido por cosas insignificantes, con los oídos puestos en el mundo, verdadero enemigo de su maravillosa y única alma de poeta.
Adiós, Bagaría. Cuando te vuelvas a tus chozas con las flores, las fieras y las torrentes, diles a tus compañeros salvajes que no se fíen de viajes de ida y vuelta a nuestras ciudades; a las fieras que tú has pintado con ternura franciscana, que no tengan un momento de locura y se hagan animales domésticos, y a las flores, que no galleen demasiado su hermosura, porque les pondrán esposas y las harán vivir sobre los vientres corrompidos de los muertos.
Tienes razón, poeta. Vuelvo a mi selva, a rugir con mis rugidos, más amables que las bellas palabras de los amigos, que a veces son blasfemias en baja voz.”


Des cannibales
(…) Trois d’entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu’elle soit déjà avancée, bien misérables de s’être laissé piper au désir de la nouvelleté, et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen, du temps que leur feu roi Charles neuvième y était. Le Roi parla à eux longtemps; on leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d’une belle ville. Après cela, quelqu’un en demanda à leur avis, et voulut savoir d’eux ce qu’ils y avaient trouvé de plus admirable;ils répondirent trois choses, d’où j’ai perdu la troisième, et en suis bien marri; mais j’en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu’ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du Roi (il est vraisemblable qu’ils parlaient des Suisses de sa garde), se soumissent à obéir à un enfant, et qu’on ne choisissait plutôt quelqu’un d’entre eux pour commander; secondement (ils ont une façon de leur langage telle, qu’ils nomment les hommes moitié les uns des autres) qu’ils avaient aperçu qu’il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leurs moitiés étaient mendiants à leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté; et trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice, qu’ils ne prissent les autres à la gorge, ou missent le feu à leurs maisons.
Je parlai à l’un deux fort longtemps; mais j’avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n’en pus tirer guère de plaisir. Sur ce que je lui demandai quel fruit il recevait de la supériorité qu’il avait parmi les siens (car c’était un capitaine, et nos matelots le nommaient Roi), il me dit que c’était marcher le premier à la guerre; de combien d’hommes il était suivi, il me montra un espace de lieu, pour signifier que c’était autant qu’il en pourrait en un tel espace, ce pouvait être quatre ou cinq mille hommes; si, hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu’il lui en restait cela que, quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leurs bois, par où il pût passer bien à l’aise.
Tout cela ne va pas trop mal: mais quoi, ils ne portent point de hauts-de-chausses!
Essais, I, 31, 1580-1592. Orthographe modernisée, Gallimard, collection Bibliothèque de la Pléiade.


J’ai lu avec grand intérêt France Bloch-Sérazin– Une femme en résistance (1913-1943) de l’historien Alain Quella-Villéger, publié par les Editions Les femmes, 296 pages, 18 €. C’est une enquête complète, précise et agréable à lire, malgré parfois quelques approximations et errata ici ou là. Les lettres sont particulièrement émouvantes.
La journaliste et romancière Ania Francos avait publié en 1978, aux éditions Stock, Il était des femmes dans la Résistance avec un beau portrait de France Bloch en couverture. Elle rendait hommage à cette grande résistante et s’interrogeait: «Je me demande pourquoi le parti a pratiquement sanctifié Danielle Casanova et n’a consacré que quelques petites brochures à France. Il est vrai que cette dernière ne dirigeait pas l’Union de jeunes femmes de France.»
France Bloch [France Bloch-Sérazin, après son mariage avec Frédéric Sérazin] est née le 21 février 1913 à Paris. C’était la fille de l’écrivain Jean-Richard Bloch (1884-1947) et de Marguerite Bloch, née Herzog (1886-1975). sa mère était la sœur de l’écrivain André Maurois (1885-1967). France Bloch avait un frère (Michel 1911-2000) et deux sœurs (Marianne 1909-2003 et Claude 1915-2009). Titulaire d’une licence de chimie générale en juin 1934, elle entra comme assistante au Service central de la Recherche scientifique de l’Institut de chimie, rue Pierre Curie à Paris, et poursuivit jusqu’à la guerre des travaux de recherche.
En mai 1939, elle épousa Frédéric Sérazin, ouvrier métallurgiste chez Hispano-Suiza depuis 1935 et militant communiste. Ils eurent un fils, Roland, en janvier 1940.
Cette militante communiste, résistante de la première heure, fut la chimiste de l’Organisation spéciale (OS) puis des Francs-tireurs et partisans. En effet, elle entra en 1941 dans un des premiers groupes FTPF, dirigé par Raymond Losserand (1903-1942), conseiller municipal communiste du XIVe arrondissement de Paris. Elle installa un laboratoire rudimentaire dans un logement de deux pièces, 1 avenue Debidour dans XIXe arrondissement et fabriqua des bombes et des explosifs qui furent utilisés dans la lutte armée. Elle était en liaison avec le groupe de l’Ouest, commandé par le colonel Fabien et le colonel Dumont. Le 16 mai 1942, elle fut arrêtée par la police française en raison de ses activités. Après de terribles interrogatoires, la torture et quatre mois de cellule, elle comparut devant un tribunal spécial allemand. Elle fut condamnée à la peine de mort comme dix-huit autres co-inculpés le 30 septembre 1942. Ces derniers furent immédiatement exécutés au stand de tir de Balard (XVe arr.). France Bloch fut déportée en Allemagne le 10 décembre 1942 et enfermée dans une forteresse à Lübeck Le 12 février 1943, elle fut guillotinée à Hambourg dans la cour de la maison d’arrêt, Elle n’avait pas encore trente ans.
Son mari fut arrêté en février 1940. Il s’évada deux fois, mais repris à chaque fois. Résistant en zone sud, il fut arrêté par la Milice et la Gestapo à Saint-Étienne (Loire) le 15 juin 1944, torturé et assassiné le même jour. Son cousin germain, Jean-Louis Wolkowitsch, né aussi en 1913, fut arrêté le même jour qu’elle et fusillé comme otage le 11 août 1942 au Mont-Valérien. Sa grand-mère, Louise Laure Bloch, raflée à Néris-les-Bains le 12 mai 1944, mourut à Auschwitz le 4 juin 1944.
Les survivants (Louis Aragon)
A Jean-Richard Bloch
J’ai rencontré portant ses yeux de porcelaine
Celle qui vit son coeur mis en mille morceaux
Et mon ami qui rêve à sa reine lointaine
Dont l’ombre fuit dans les ruisseaux
J’ai rencontré jouet de nos jours mécaniques
Cet autre qui revint pour ne plus retrouver
Son amour emporté par le vent tyrannique
Comme une lettre inachevée
J’ai rencontré l’amant la sœur le fils la mère
Celle qui se refuse à ne pas croire absent
L’enfant qui n’écrit plus et qui tourne en chimère
Á l’horizon couleur du sang
Ils vivent d’une vie étrange et machinale
Le silence est en eux quand ils parlent pourtant
Quel songe déplient-ils en ouvrant le journal
Ô saveur de cendre du temps
Ce que vous pourriez dire ils le savent d’avance
N’allez pas leur parler surtout des disparus
Nuir des propos polis et de la survivance
Voyez-les traverser la rue
Ils vont chez le coiffeur ou font cuire la soupe
Vous n’arriverez pas à les prendre en défaut
Vous n’arriverez pas à faire qu’ils se coupent
Ils font tous les gestes qu’il faut
Ils ont su de la mort qu’ils étaient deux au monde
Quelle force mon Dieu les peut donc habiter
Un bonheur divisé se pourrait-il qu’il fonde
Cette incroyable dignité
Miroir intérieur ma terrible mémoire
Á qui vit sans son coeur tout semble indifférent
Mais tout est différent quand à ce foyer noir
Le feu de la haine reprend
Car il faut la nommer l’inhumaine l’humaine
Sans qui nous ne pourrions ni vivre ni marcher
C’est la sainte vertu qui te porte la haine
Honte à qui s’en voudrait cacher
Cela vous fait frémir Vous n’avez à la bouche
Que les mots de l’amour Comment voulez-vous donc
Aujourd’hui sans objet que ces mots-là nous touchent
Pour un sacrilège pardon
L’amour nous le gardons à ceux-là qui partirent
Et dont la voix n’a plus d’écho que notre voix
Pardonner ce serait oublier leur martyre
Ce serait les tuer deux fois
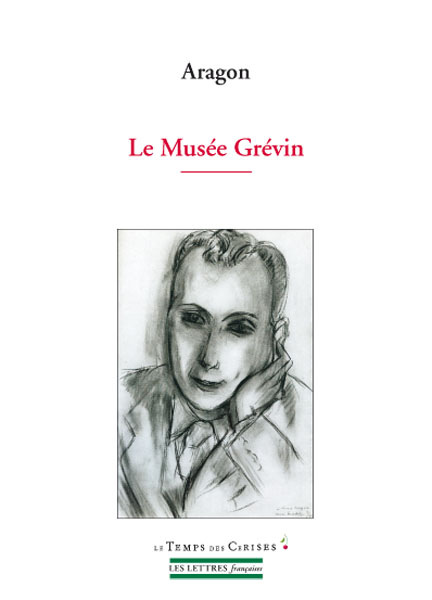

Renouveau
Le printemps maladif a chassé tristement
L’hiver, saison de l’art serein, l’hiver lucide,
Et, dans mon être à qui le sang morne préside
L’impuissance s’étire en un long bâillement.
Des crépuscules blancs tiédissent sous mon crâne
Qu’un cercle de fer serre ainsi qu’un vieux tombeau
Et triste, j’erre après un rêve vague et beau,
Par les champs où la sève immense se pavane
Puis je tombe énervé de parfums d’arbres, las,
Et creusant de ma face une fosse à mon rêve,
Mordant la terre chaude où poussent les lilas,
J’attends, en m’abîmant que mon ennui s’élève…
– Cependant l’Azur rit sur la haie et l’éveil
De tant d’oiseaux en fleur gazouillant au soleil.
Poésies, 1866.
Stéphane Mallarmé. Lettre du 27 juin 1884 à Léo d’Orfer, parue dans La Vogue, 18 avril 1886.
«Définissez la Poésie», lui demande la revue La Vogue en 1884. Par retour du courrier :
«La Poésie est l’expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence : elle doue ainsi d’authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle.»
Bertrand Maréchal, professeur à l’Université de Paris-Sorbonne, publie chez Gallimard la Correspondance 1854-1898 de Stéphane Mallarmé. Nouvelle édition augmentée en un volume. 65 euros. 3 340 lettres. Parution: 28 mars 2019.
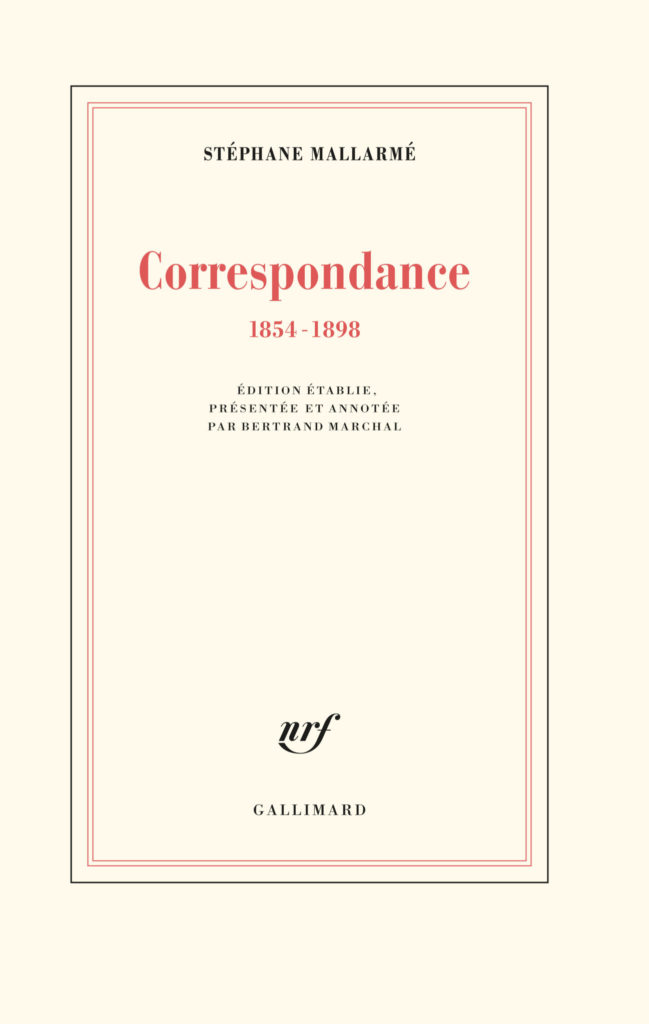

Temples grecs
Rien de moins dangereux aujourd’hui que de parcourir cette Sicile redoutée, soit en voiture, soit à cheval, soit même à pied. Toutes les excursions les plus intéressantes, d’ailleurs, peuvent être accomplies presque entièrement en voiture. La première à faire est celle du temple de Ségeste.
Tant de poètes ont chanté la Grèce que chacun de nous en porte l’image en soi ; chacun croit la connaître un peu, chacun l’aperçoit en songe telle qu’il la désire.
Pour moi, la Sicile a réalisé ce rêve ; elle m’a montré la Grèce ; et quand je pense à cette terre si artiste, il me semble que j’aperçois de grandes montagnes aux lignes douces, au lignes classiques, et, sur les sommets, des temples, ces temples sévères, un peu lourds peut-être, mais admirablement majestueux, qu’on rencontre partout dans cette île.
Tout le monde a vu Paestum et admiré les trois ruines superbes jetées dans cette plaine nue que la mer continue au loin, et qu’enferme, de l’autre côté, un large cercle de monts bleuâtres. Mais si le temple de Neptune est plus parfaitement conservé et plus pur (on le dit) que les temples de Sicile, ceux-ci sont placés en des paysages si merveilleux, si imprévus, que rien au monde ne peut faire imaginer l’impression qu’ils laissent à l’esprit.
Quand on quitte Palerme, on trouve d’abord le vaste bois d’orangers qu’on nomme la Conque d’or ; puis le chemin de fer suit le rivage, un rivage de montagnes rousses et de rochers rouges. La voie enfin s’incline vers l’intérieur de l’île et on descend à la station d’Alcamo-Calatafimi.
Ensuite on s’en va, à travers un pays largement soulevé, comme une mer, de vagues monstrueuses et immobiles. Pas de bois, peu d’arbres, mais des vignes et des récoltes ; et la route monte entre deux lignes ininterrompues d’aloès fleuris. On dirait qu’un mot d’ordre a passé parmi eux pour leur faire pousser vers le ciel, la même année, presque au même jour, l’énorme et bizarre colonne que les poètes ont tant chantée. On suit, à perte de vue, la troupe infinie de ces plantes guerrières, épaisses, aiguës, armées et cuirassées, qui semblent porter leur drapeau de combat.
Après deux heures de route environ, on aperçoit tout à coup deux hautes montagnes, reliées par une pente douce, arrondie en croissant d’un sommet à l’autre, et, au milieu de ce croissant, le profil d’un temple grec, d’un de ces puissants et beaux monuments que le peuple divin élevait à ses dieux humains.
Il faut, par un long détour, contourner l’un de ces monts, et en découvre de nouveau le temple qui se présente alors de face. Il semble maintenant appuyé à la montagne, bien qu’un ravin profond l’en sépare ; mais elle se déploie derrière lui, et au-dessus de lui, l’enserre, l’entoure, semble l’abriter, le caresser. Et il se détache admirablement avec ses trente-six colonnes doriques, sur l’immense draperie verte qui sert de fond à l’énorme monument, debout, tout seul, dans cette campagne illimitée.
On sent, quand on voit ce paysage grandiose et simple, qu’on ne pouvait placer là qu’un temple grec, et qu’on ne pouvait le placer que là. Les maîtres décorateurs qui ont appris l’art à l’humanité, montrent, surtout en Sicile, quelle science profonde et raffinée ils avaient de l’effet et de la mise en scène. Je parlerai tout à l’heure des temples de Girgenti. Celui de Ségeste semble avoir été posé au pied de cette montagne par un homme de génie qui avait eu la révélation du point unique où il devait être élevé. Il anime, à lui seul, l’immensité du paysage ; il la fait vivante et divinement belle.
Sur le sommet du mont, dont on a suivi le pied pour aller au temple, on trouve les ruines du théâtre.
Quand on visite un pays que les Grecs ont habité ou colonisé, il suffit de chercher leurs théâtres pour trouver les plus beaux points de vue. S’ils plaçaient leurs temples juste à l’endroit où ils pouvaient donner le plus d’effet, où ils pouvaient le mieux orner l’horizon, ils plaçaient, au contraire, leurs théâtres juste à l’endroit d’où l’oeil pouvait le plus être ému par les perspectives.
Celui de Ségeste, au sommet d’une montagne, forme le centre d’un amphithéâtre de monts dont la circonférence atteint au moins cent cinquante à deux cents kilomètres. On découvre encore d’autres sommets au loin, derrière les premiers ; et, par une large baie en face de vous, la mer apparaît, bleue entre les cimes vertes.
Le lendemain du jour où l’on a vu Ségeste, on peut visiter Sélinonte, immense amas de colonnes éboulées, tombées tantôt en ligne, et côte à côte, comme des soldats morts, tantôt écroulées en chaos.
Ces ruines de temples géants, les plus vastes qui soient en Europe, emplissent une plaine entière et couvrent encore un coteau, au bout de la plaine. Elles suivent le rivage, un long rivage de sable pâle, où sont échouées quelques barques de pêche, sans qu’on puisse découvrir où habitent les pêcheurs. Cet amas informe de pierres ne peut intéresser, d’ailleurs, que les archéologues ou les âmes poétiques, émues par toutes les traces du passé. (…)
Gil Blas, 8 septembre 1885.


Lors de notre voyage en Sicile et dans les Ïles Eoliennes, nous avons visité le mardi 6 juin 2017 le site de Sélinonte qui couvre 270 ha.
Cette prospère cité grecque occupait un magnifique endroit situé sur un promontoire entre grandes deux rivières aujourd’hui ensablées. Longée par la mer dans sa partie sud, elle abrite huit temples et une acropole qui se trouve au coeur de la nature (fleurs des champs, herbes aromatiques, espèce de céleri sauvage (selinon en grec) qui a donné son nom à la colonie grecque).
La ville aurait été fondée en 628 av.J.C. par des Grecs venant de Megara Hyblaea, colonie situé au nord de Syracuse. Ils étaient attirés par la fertilité de la région qui produisait en abondance le blé et l’ huile. La colonie prospéra pendant 200 ans. Lorsqu’elle s’allia avec Syracuse contre Carthage, Ségeste, sa rivale, demanda l’aide des Carthaginois et en 409 av.J.C., Hannibal de Giscon ( v 471 av. J.-C. – 406 av. J.-C.) lança son armée de plus de 100 000 hommes sur Sélinonte qui tomba en neuf jours. Environ 16 000 habitants furent massacrés et 5 000 vendus comme esclaves. 2 600 personnes se réfugièrent à Agrigente. La cité avait compté jusqu’à 30 000 habitants à son apogée.
La cité ne retrouva plus jamais sa grandeur. Elle se maintint encore vaille que vaille un siècle et demi, puis le site fut abandonné. Plus tard, les Byzantins puis les Arabes s’installèrent dans ses ruines. Les nombreux tremblements de terre achevèrent sa quasi-destruction. Elle fut redécouverte par un moine dominicain au XVI siècle. Des archéologues anglais, Samuel Angell et William Harris, firent des recherches en 1823 et mirent à jour les premières métopes. Les fouilles sont systématiques depuis 1950. Elles se poursuivent aujourd’hui.
Le site se compose de trois zones: la première, sur la colline orientale, regroupe trois temples (E,F,G); la deuxième, l’ancienne acropole en regroupe cinq (Temples A,B,C,D et O); la troisième était une enceinte sacrée où s’élevait le Santuario della Malophoros (575 av.J.C.).
Les temples E et F sont les mieux conservés. Le temple E (480-460 av.J.C.), consacré à Héra et relevé en 1958, est un temple périptère, comportant six colonnes sur sa largeur et quinze sur sa longueur. Il est allongé par la présence d’un opisthodome. Le temple F (560-540 av.J.C.) était probablement dédié à Athéna. C’est le plus petit et le plus ancien des trois temples de la colline orientale. Il est entièrement en ruine. Ses colonnes cannelées gisent au sol. Le temple G, un des plus vastes du monde grec (113 m sur 30 m de haut), était inachevé au moment de l’attaque carthaginoise comme le montrent ses colonnes non cannelées. Ses fûts atteignent un diamètre de 3,40 m. Chaque tambour pèse au moins 100 tonnes. Il n’a plus aujourd’hui qu’une colonne encore debout. Aujourd’hui, c’est un impressionnant amas de fragments et de colonnes colossales renversées. Il était peut-être dédié à Apollon ou plus vraisemblablement à Zeus Olympien.
Un sentier mène à l’acropole où s’élevaient les bâtiments publics et religieux et quelques résidences appartenant aux classes aisées. De grands remparts, de 4,50 m d’épaisseur, furent construits après l’affrontement avec les Carthaginois en 306 av.J.C. sur une centaine d’hectares. Ils devaient protéger la ville. Le temple C, avec ses douze hautes colonnes, est le plus ancien (début du VI siècle av.J.C.) et le mieux conservé. De là, proviennent les superbes métopes qui ornaient ses frises et se trouvent maintenant au Musée archéologique de Palerme.


«Un signe nous sommes, et privé de sens…»
De Sélinonte en son Chaos se pourraient relever les pierres, mais le sens, à coup sûr, est perdu.
Les plus hautes figures d’art non plus n’échappent donc pas à la perte.
Cet avertissement est de ceux qui se peuvent mal entendre d’un vivant qui écrit.
L’oublier grèverait pourtant d’une lourde hypothèque le sérieux d’écrire, la qualité de savoir, le courage nécessaires à qui veut, du moins, enregistrer un peu de l’irrécusable réel.
Que «les poètes fondent ce qui demeure» est du petit nombre de ces vérités dont ne peut douter l’historien de cette surprise: qu’il y ait de l’être. Mais de ce que signifie ici, «demeurer», comment ne pas former une acception restreinte, dès lors qu’à ce point saisit l’énormité du Chaos?
Si Ségeste – son Théâtre -, pouvait témoigner d’une certaine résistance à l’effacement, Sélinonte, qu’elle travailla à détruire, témoigne, avec une éloquence presque excessive, de ce que la ruine n’épargne rien.
Chaos les piliers des temples!
Chaos les fortifications militaires cyclopéennes!
Chaos, l’agora perdue!
Chaos! Chaos! Chaos!
Qu’à ce point le sens se perde, des figures de la Prière, de l’Adjuration, de l’Appel, jette une ombre mortelle sur les architectures les plus hautes.
«Un signe nous sommes, et privé de sens». Sélinonte matérialise visiblement ce diagnostic. Rien de réel, sinon au prix de ce dernier savoir.
La vie profane en son entier se fait alors connaître pour ce qu’elle est: efforts émouvants pour éloigner la douleur, nier le mal, oublier le non-sens et la mort.
«Dansent et chantent les Génies de la légèreté, de la gaie volonté d’ignorer!» Du plaisir des formes! De la jouissance de la lumière! Des fruits savoureux du jour! «Oh sans doute est-il bon qu’ils dansent, chantent, oublient!» Cette gaieté, le temps qu’elle dure, dispense de pleurs, d’alarmes, allège, sauve.
L’art n’efface pas la perte. Il lui répond.
Route de Sélinonte. août 1994.
“Défends-toi, Beauté violente!” Poésie/Gallimard, 2019.
