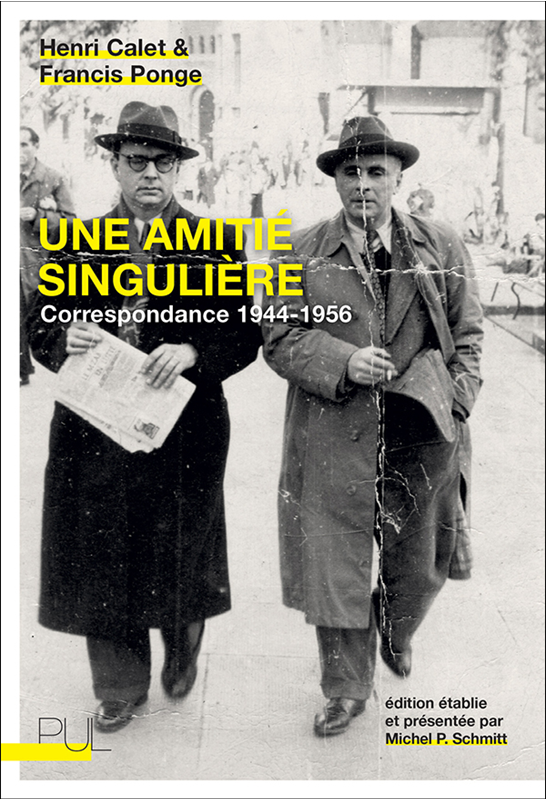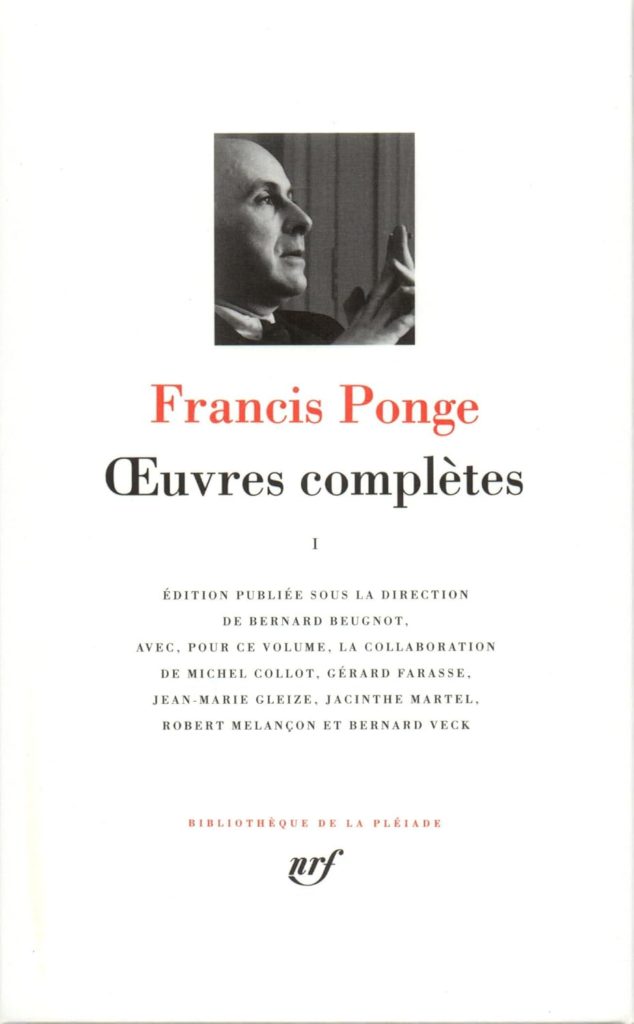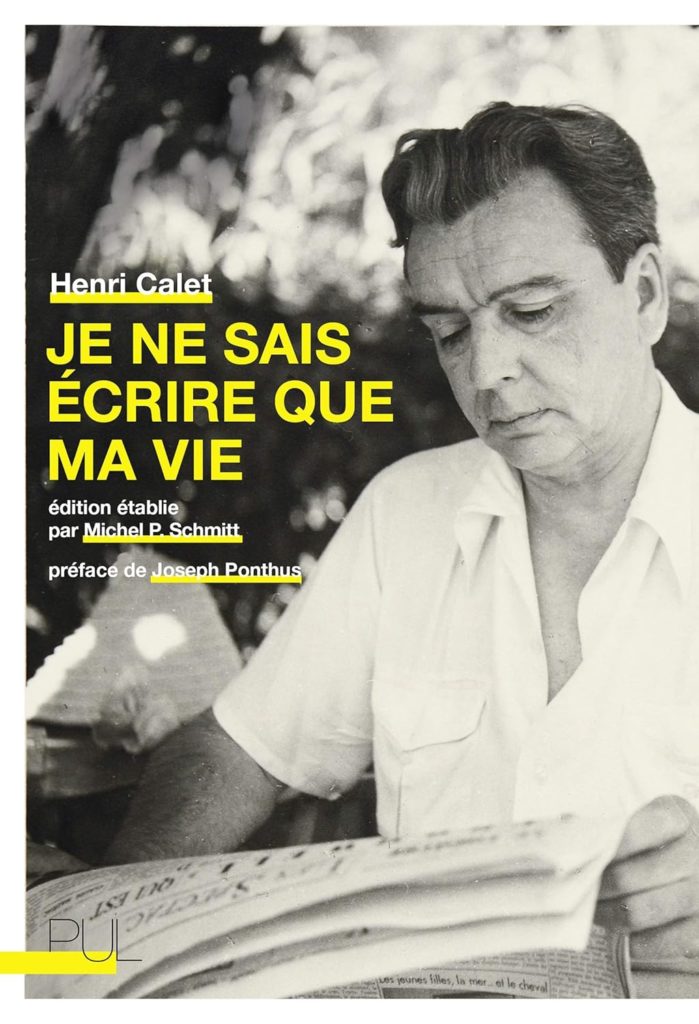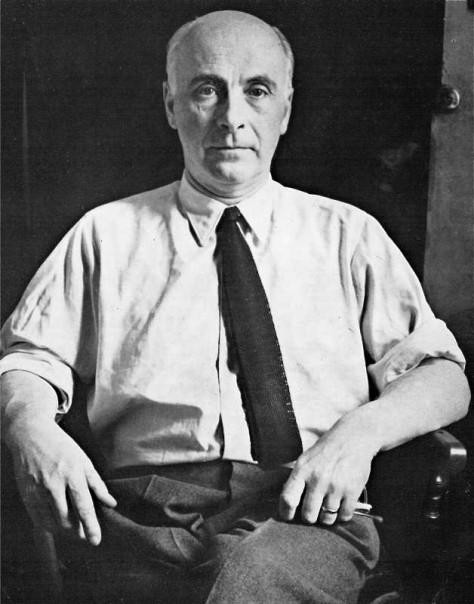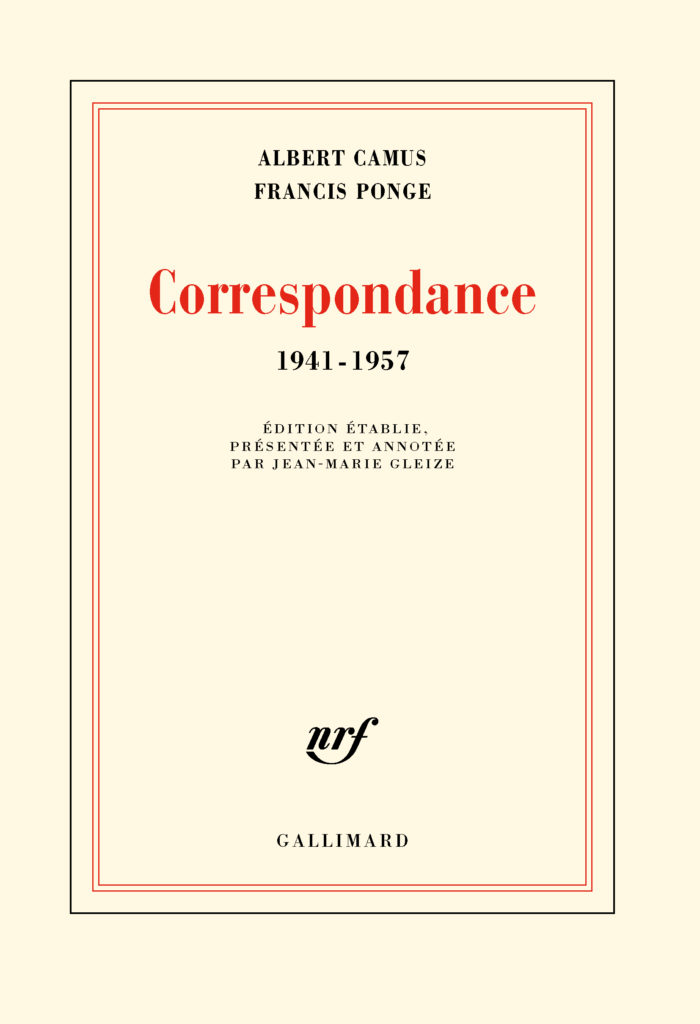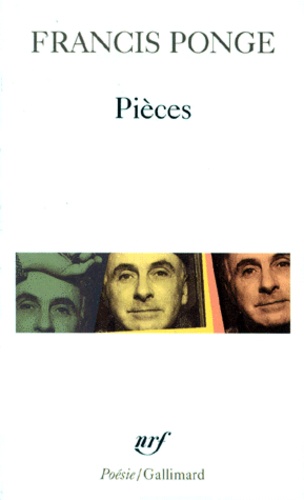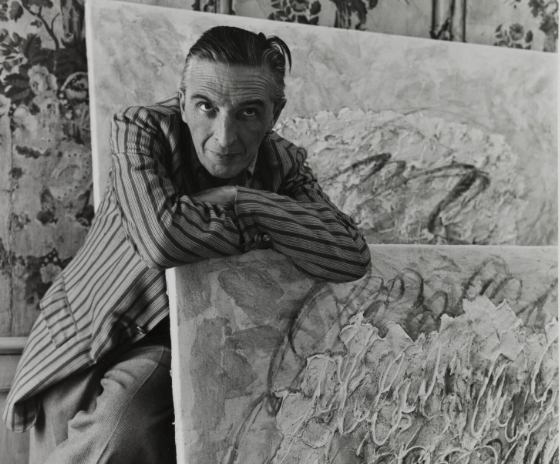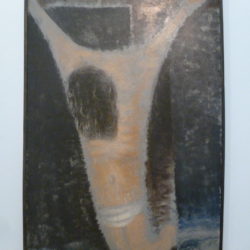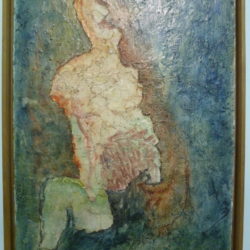Francis Ponge et Pablo Neruda, deux auteurs bien différents. Un point commun, l’éloge de la pomme de terre.

« Au Paradis, nous nous lasserons peut-être un jour de la musique des anges et pour leur expliquer qu’il y avait là-bas, sur terre, quelque chose qui en valait la peine, j’ai écrit ces textes sur les plus ordinaires des choses : la pomme de terre, le savon, le galet, – pour montrer aux anges ce que je veux dire » Jesper Svenbro. Rencontre avec Francis Ponge (1979).
La pomme de terre (Francis Ponge)
Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix.
Entre le gras du pouce et la pointe du couteau tenu par les autres doigts de la même main, l’on saisit – après l’avoir incisé – par l’une de ses lèvres ce rêche et fin papier que l’on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du tubercule.
L’opération facile laisse, quand on a réussi à la parfaire sans s’y reprendre
à trop de fois, une impression de satisfaction indicible.
Le léger bruit que font des tissus en se décollant est doux à l’oreille, et la
découverte de la pulpe comestible réjouissante.
Il semble, à reconnaître la perfection du fruit nu, sa différence, sa
ressemblance, sa surprise – et la facilité de l’opération – que l’on ait accompli
là quelque chose de juste, dès longtemps prévu et souhaité par la nature, que l’on
a eu toutefois le mérite d’exaucer.
C’est pourquoi je n’en dirai pas plus, au risque de sembler me satisfaire d’un
ouvrage trop simple. Il ne me fallait – en quelques phrases sans effort – que
déshabiller mon sujet, en en contournant strictement la forme : la laissant intacte
mais polie, brillante et toute prête à subir comme à procurer les délices de sa
consommation.
… Cet apprivoisement de la pomme de terre par son traitement à l’eau bouillante durant vingt minutes, c’est assez curieux (mais justement tandis que j’écris des
pommes de terre cuisent – il est une heure du matin – sur le fourneau devant moi).
Il vaut mieux, m’a-t-on dit que l’eau soit salée, sévère : pas obligatoire, mais
c’est mieux.
Une sorte de vacarme se fait entendre, celui des bouillons de l’eau. Elle est en
colère, au moins au comble de l’inquiétude. Elle se déperd furieusement en
vapeurs, bave, grille aussitôt, pfutte, tsitte : enfin, très agitée sur ces charbons
ardents.
Mes pommes de terre, plongées là-dedans, sont secouées de soubresauts,
bousculées, injuriées, imprégnées jusqu’à la moelle.
Sans doute la colère de l’eau n’est-elle pas à leur propos, mais elles en
supportent l’effet – et ne pouvant se déprendre de ce milieu, elles s’en trouvent
profondément modifiées (j’allais écrire s’entr’ouvrent…).
Finalement, elles y sont laissées pour mortes, ou du moins très fatiguées. Si
leur forme en réchappe (ce qui n’est pas toujours), elles sont devenues molles,
dociles. Toute acidité a disparu de leur pulpe : on leur trouve bon goût.
Leur épiderme s’est aussi rapidement différencié : il faut l’ôter (il n’est plus
bon à rien), et le jeter aux ordures…
Reste ce bloc friable et savoureux, – qui prête moins qu’à d’abord vivre,
ensuite à philosopher.
Paru dans Confluences n°18. Mars 1943.
Pièces. 1962. Poésie / Gallimard n°73 1971.

Francis Ponge lit “Le pain” et “La pomme de terre”. France Culture, 9 mars 2018. (Durée : 3’14) Archives INA – Radio France.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/francis-ponge-lit-le-pain-et-la-pomme-de-terre-6977360
https://www.youtube.com/watch?v=p9NhHzxdB4c
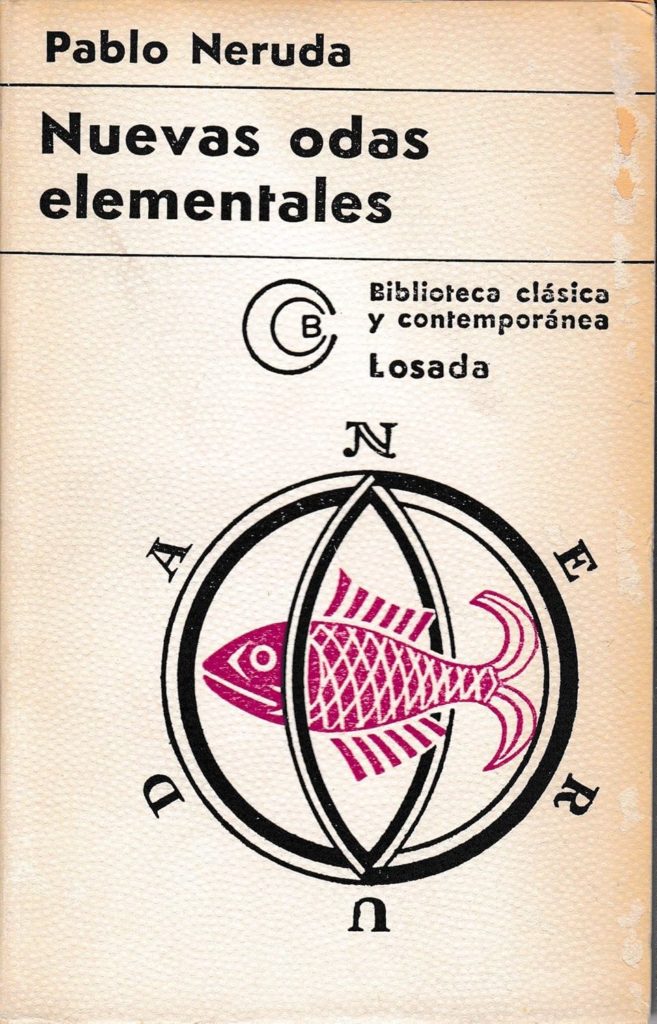
Oda a la papa (Pablo Neruda)
Papa
te llamas,
papa
y no patata,
no naciste con barba,
no eres castellana:
eres oscura
como
nuestra piel,
somos americanos,
papa,
somos indios.
Profunda
y suave eres,
pulpa pura, purísima
rosa blanca
enterrada,
floreces
allá adentro
en la tierra,
en tu lluviosa
tierra
originaria,
en las islas mojadas
de Chile tempestuoso,
en Chiloé marino,
en medio de la esmeralda que abre
su luz verde
sobre el austral océano.
Papa,
materia
dulce,
almendra
de la tierra,
la madre
allí
no tuvo
metal muerto,
allí en la oscura
suavidad de las islas
no dispuso
el cobre y sus volcanes
sumergidos,
ni la crueldad azul
del manganeso,
sino que con su mano,
como en un nido
en la humedad más suave,
colocó tus redomas,
y cuando
el trueno
de la guerra
negra,
España
inquisidora,
negra como águila de sepultura,
buscó el oro salvaje
en la matriz
quemante
de la araucanía,
sus uñas
codiciosas
fueron exterminadas,
sus capitanes
muertos,
pero cuando a las piedras de Castilla
regresaron
los pobres capitanes derrotados
levantaron en las manos sangrientas
no una copa de oro,
sino la papa
de Chiloé marino.
Honrada eres
como
una mano
que trabaja en la tierra,
familiar
eres
como
una gallina,
compacta como un queso
que la tierra elabora
en sus ubres
nutricias,
enemiga del hambre,
en todas
las naciones
se enterró su bandera
vencedora
y pronto allí,
en el frío o en la costa
quemada,
apareció
tu flor
anónima
enunciando la espesa
y suave
natalidad de tus raíces.
Universal delicia,
no esperabas
mi canto,
porque eres sorda
y ciega
y enterrada.
Apenas
si hablas en el infierno
del aceite
o cantas
en las freidurías
de los puertos,
cerca de las guitarras,
silenciosa,
harina de la noche
subterránea,
tesoro interminable
de los pueblos.
Nuevas odas elementales. Losada,1963.