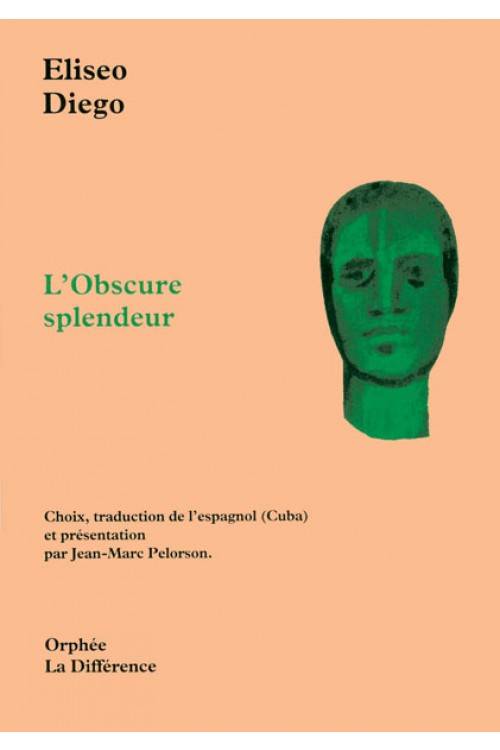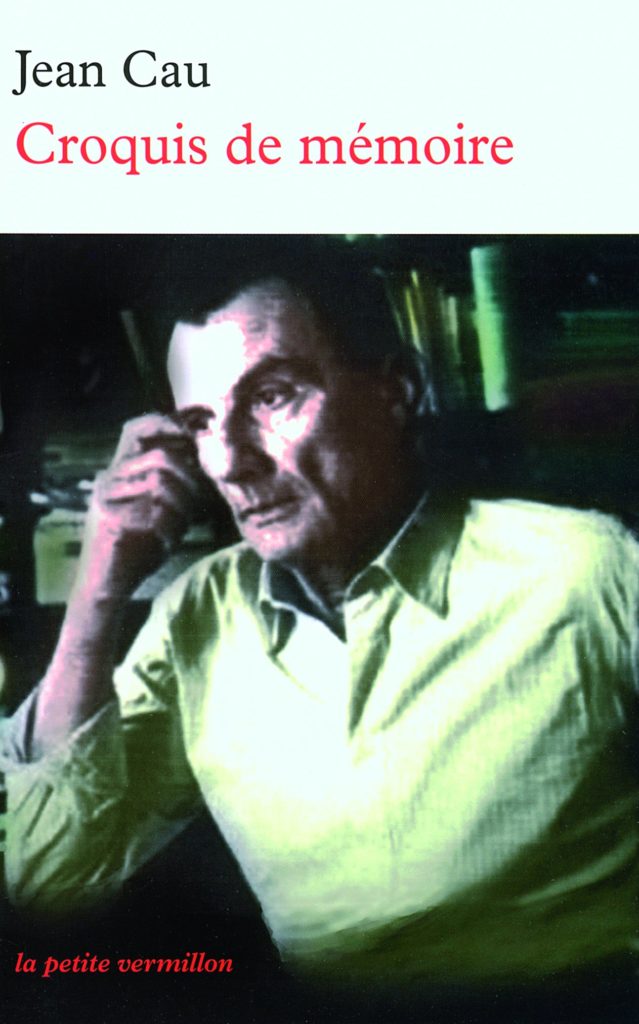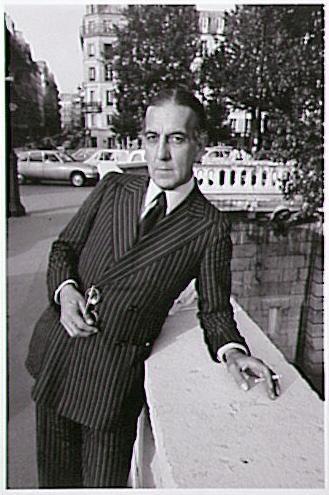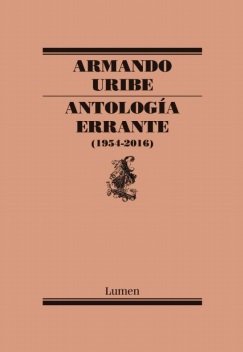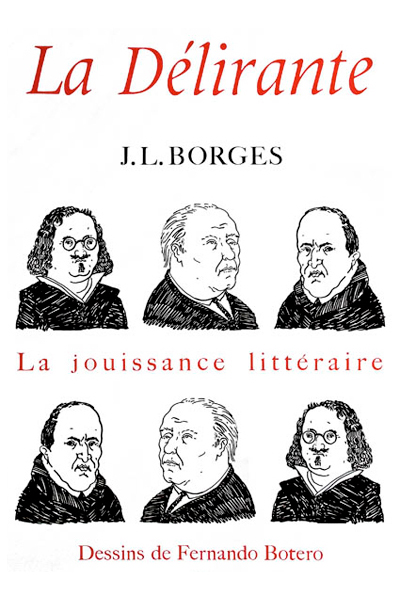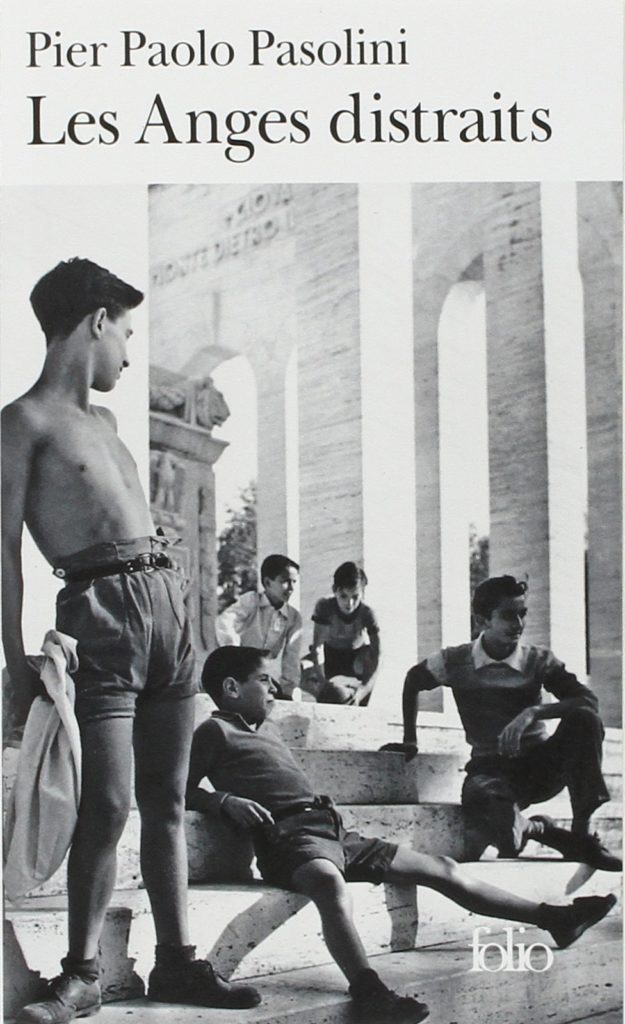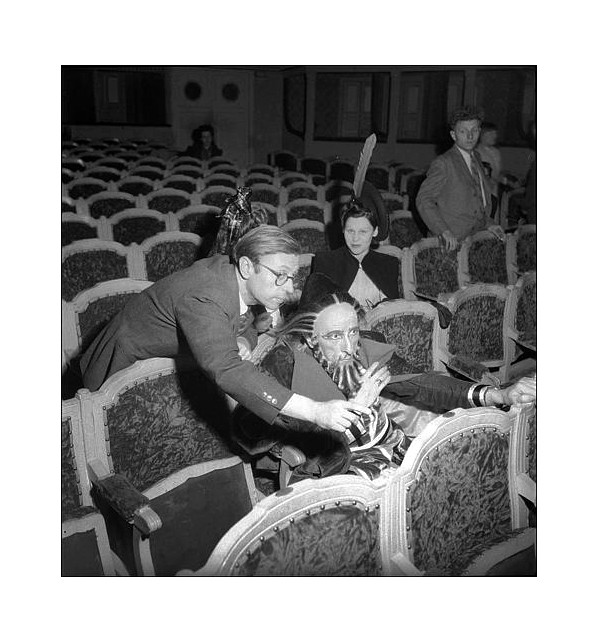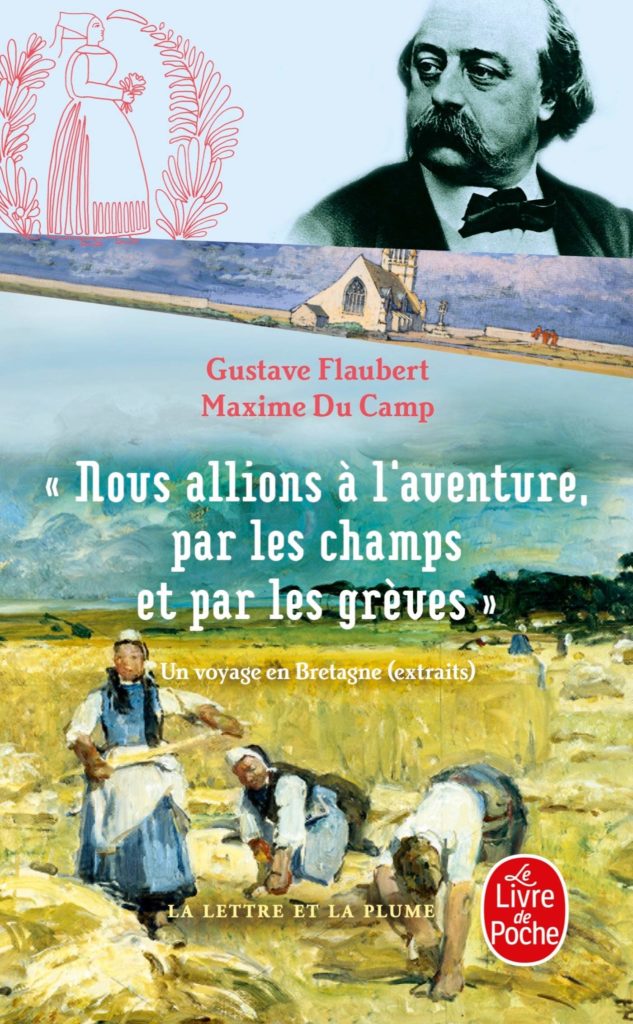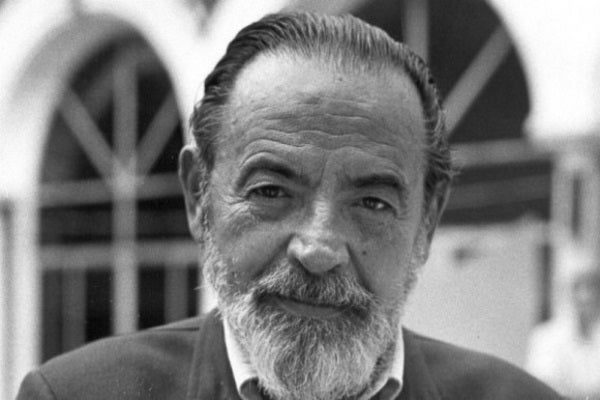
Je remercie une fois de plus M P. F. qui poste sur Facebook de magnifiques poèmes, toujours excellemment illustrés. Elle m’ a fait rechercher les recueils de poésies d’Eliseo Diego qui se trouvent dans ma bibliothèque.
Ce grand poète cubain fait partie d’une grande famille d’écrivains et de musiciens: sa femme, Bella García Marruz, son fils Eliseo Alberto (Lichi) (1951-2011), sa fille Josefina de Diego (Fefé), son beau frère, Cintio Vitier (1921-2009), sa belle soeur Fina García Marruz (1923), ses neveux musiciens Sergio Vitier (1948-2016) et José María Vitier (1954).
Eliseo Diego, Cintio Vitier, Virgilio Piñera (1912-1979) étaient parmi les fondateurs de la revue Orígenes, dirigée par José Lezama Lima (1910-1976) et José Rodríguez Feo (1920-1993). Quarante numéros furent publiés entre 1944 y 1956. C’était la publication culturelle cubaine la plus importante de cette époque.
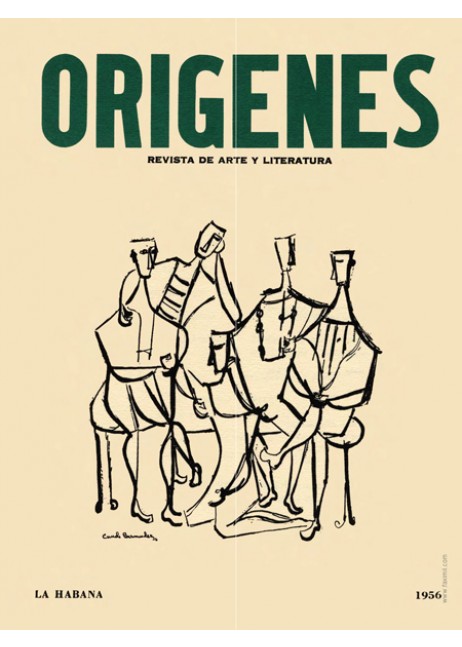
Eliseo Diego a obtenu le Prix national de Littérature de Cuba en 1986 et le Prix Juan Rulfo de littérature latino-américaine pour l’ensemble de son oeuvre poétique en 1993.
Trois exemples de sa poésie:
El oscuro esplendor
Juega el niño con unas pocas piedras inocentes
en el cantero gastado y roto
como paño de vieja.
Yo pregunto:
qué irremediable catástrofe separa
sus manos de mi frente de arena,
su boca de mis ojos impasibles.
Y suplico
al menudo señor que sabe conmover
la tranquila tristeza de las flores, la sagrada
costumbre de los árboles dormidos.
Sin quererlo
el niño distraídamente solitario empuja
la domada furia de las cosas, olvidando
el oscuro esplendor que me ciega y él desdeña.
El oscuro esplendor, 1966.
L’obscure splendeur
L’enfant joue avec quelques innocents cailloux
sur la plate-bande usée et trouée
comme un fichu de vieille.
Moi je demande
quelle irrémédiable catastrophe sépare
ses mains de mon front de sable,
sa bouche de mes yeux impassibles.
Et je supplie
le petit maître qui sait émouvoir
la tranquille tristesse des fleurs, la sainte
coutume des arbres endormis.
Sans le vouloir
l’enfant, distraitement solitaire, pousse
la fureur subjuguée des choses, sans se douter
de l’obscure splendeur qui m’aveugle et que lui dédaigne.
L’obscure splendeur. Edition de la Différence, Orphée. 1996. Traduit par Jean-Marc Pelorson.
No es más
por selva oscura
Un poema no es más
que una conversación en la penumbra
del horno viejo, cuando ya
todos se han ido, y cruje
afuera el hondo bosque; un poema
no es más que unas palabras
que uno ha querido, y cambian
de sitio con el tiempo, y ya
no son más que una mancha, una
esperanza indecible;
un poema no es más
que la felicidad, que una conversación
en la penumbra, que todo
cuanto se ha ido, y ya
es silencio.
El oscuro esplendor, 1966.
Ce n’est que
por selva oscura…
Le poème ce n’est
qu’une conversation dans la pénombre
du vieux fourneau, lorsque déjà
tout le monde s’en est allé, et que frémit
dehors le profond bois; un poème
ce n’est que quelques mots
qu’on a chéris, et qui changent
de place avec le temps, pour n’être désormais
qu’une tache, qu’une
indicible espérance;
un poème ce n’est
que le bonheur, qu’une conversation
dans la pénombre, que tout
ce qui s’en est allé, et n’est plus
que silence.
L’obscure splendeur. Edition de la Différence, Orphée. 1996. Traduit par Jean-Marc Pelorson.
Versiones
La muerte es esa pequeña jarra, con flores
pintadas a mano, que hay en todas las casas y que
uno jamás se detiene a ver.
La muerte es ese pequeño animal que ha
cruzado en el patio, y del que nos consuela la
ilusión, sentida como un soplo, de que es sólo el gato
de la casa, el gato de costumbre, el gato que ha
cruzado y al que ya no volveremos a ver.
La muerte es ese amigo que aparece en las
fotografías de la familia, discretamente a un lado,
y al que nadie acertó nunca a reconocer.
La muerte, en fin, es esa mancha en el muro
que una tarde hemos mirado, sin saberlo, con un poco
de terror.
Versiones, 1970.
Versions
La mort est cette petite jarre, couverte
de fleurs peintes à la main, qui est dans toutes
les maisons, et sur qui jamais ne s’arrêtent les yeux.
La mort est ce petit animal qui est
passé dans la cour et dont on se remet en se
disant dans une bouffée d’illusion que ce n’est
que le chat de maison, le chat de toujours, le
chat qui est passé et qu’on ne reverra plus.
La mort est cet ami qu’on voit sur les
photos de famille, discrètement marginal, et
que personne n’a jamais réussi à reconnaître.
La mort, enfin, c’est cette tache sur le
mur qu’un soir nous avons regardée, sans le
savoir, avec un soupçon de terreur.
L’obscure splendeur. Edition de la Différence, Orphée. 1996. Traduit par Jean-Marc Pelorson.